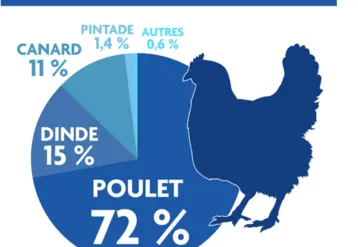Mangerons-nous tous la même chose en 2015 ?
Alors que l’exposition universelle, à
Milan, pose la question « Comment
nourrir la planète en 2050 »,
l’Observatoire Cniel des habitudes
alimentaires (Ocha) a montré que
si certains de nos modes de
consommation s’uniformisent,
d’autres habitudes alimentaires
résistent à la mondialisation. Car
se nourrir reste un acte de culture.

professeur à l'université de
Toulouse 2

directeur de recherche
émérite au CRNS
Sous le titre « Critique d’une uniformisation annoncée », l’Observatoire Cniel des comportements alimentaires (Ocha) a invité, courant mai, une soixantaine de scientifiques et de journalistes, à Milan, pour échanger sur la diversité des nos comportements alimentaires. Une critique de l’uniformisation qui fait aussi écho à une critique de la végétalisation affichée par l’exposition universelle. Sous couvert de développement durable, de gestion des sols et de l’eau, le rendez-vous mondial de l’innovation agroalimentaire fait en effet la part belle aux productions végétales au détriment des productions animales terriblement absentes.
« Nourrir la planète énergie pour la vie », l’exposition universelle pose la question du défi alimentaire mondial. En effet, comment nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050, soit un tiers de plus qu’aujourd’hui, alors que 70 % de la population mondiale vivra dans les villes contre 49 % actuellement ? Remarquant que, dans leur définition du droit à l’alimentation, les Nations unies prennent en compte la diversité des modèles alimentaires mais aussi le lien entre culture et alimentation, l’Ocha se demande: « Que mangeronsnous en 2050 ? Mangeronsnous tous ensemble ? Mangerons nous tous pareil ? Quelle place pour les modèles pluriels ? Quelle place pour les nourritures d’origine animale ? »
ÉVOLUER PAS FORCÉMENT CONVERGER
« Évoluer ne signifie pas converger tous vers le même modèle », a d’emblée souligné Véronique Pardo de l’Ocha constatant que plutôt que la généralisation d’un seul modèle alimentaire, les experts prédisent plutôt une évolution des différents régimes.
Pour Jean-Pierre Poulain, sociologue et anthropologue, professeur à l’université de Toulouse 2, loin d’être un frein, « les diversités alimentaires sont un atout pour répondre au challenge de nourrir la planète ». Car si la mondialisation des marchés entraîne le disparition de certains particularismes et la diffusion transculturelle de certains produits ou pratiques alimentaires, elle favorise aussi la relocalisation de certains produits et l’émergence de nouvelles formes alimentaires issues du métissage.
L’analyse des changements alimentaires dans le monde dépend, en effet, de l’échelle retenue. Ainsi qu’en témoigne Nicolas Bricas, socio-économiste au Cirad. « Si, à large échelle, les gens mangent la même chose du fait de la mon- dialisation des entreprises agroalimentaires et de la domination des représentations occidentales, plus on s’approche des individus et de leurs cuisines, moins l’uniformisation est au rendez-vous. L’uniformisation des comportements alimentaires marquera surtout les catégories jeunes aisées installées dans des mégalopoles et voyageant beaucoup, pour le reste de la population mondiale, la diversité alimentaire devrait perdurer. » Pour autant, les différents modèles alimentaires loin de rester figés vont continuer à évoluer.
LA VILLE N’EXCLUT PAS LES PARTICULARISMES
Au sein même des villes, le métissage alimentaire vu comme l’invention sur plusieurs générations d’un nouveau modèle mêlant sans les fusionner des mets d’origines diverses, prend de l’ampleur. Nicolas Bricas cite l’exemple du garba plat urbain de côte d’Ivoire, très populaire à Abidjan créé à partir de pâte de poisson et de manioc cuit dans de l’huile de récupération de beignet, en réaction à la nourriture saine et hygiénique imposée par l’Occident. Pour autant, dans les pays émergents, la transition nutritionnelle, c’est-à-dire le changement de régime alimentaire et de modes de vie lié à la montée en puissance de la classe moyenne influence fortement les habitudes alimentaires et intègre désormais les préoccupations de beauté et de santé.
LA CONVIVIALITÉ DU REPAS À LA FRANÇAISE…
Les Français sont très attachés à la convivialité du repas pris en commun. Le modèle français se définit notamment par des repas structurés pris à des heures régulières avec plusieurs plats et des prises ali- mentaires hors repas limitées. Ces dernières représentent 21,6 % des apports caloriques quotidiens aux États-Unis contre 9,8 % en France. Si les Français restent attachés aux trois repas par jour, on sait que le petit-déjeuner comme la fin de repas sont de plus en plus souvent remis en cause. Instauré dans les années 60, en lien avec l’organisation du travail autour de la semaine de 40 heures, cette structuration de la journée autour des trois repas pourrait évoluer sans remettre en cause l’importance accordée au plaisir, au goût et au partage toutes générations confondues.
…MAIS L’ALIMENTATION S’INDIVIDUALISE DE PLUS EN PLUS
« Actuellement, la privatisation, l’individualisation et la personnalisation de l’alimentation sont en train de devenir la règle », souligne Claude Fischler sociologue, directeur de recherches émérite au CNRS. L’objectif est devenu de trouver sa vérité alimentaire faisant passer le repas partagé de la communion (on mange tous la même chose) à la négociation (chacun revendique ses spécificités alimentaires). La montée en puissance des préoccupations de santé individualise les comportements. Même si, d’un autre côté, les dimensions psychologique et sociale de l’alimentation ont un impact sur la santé des individus comme en ont témoigné Giada Daniesi, sociologue qui a analysé les comportements des jeunes générations en Europe ou encore Laura Guerin, sociologue à l’Institut Paul Bocuse ceux des seniors en maison de retraite.
D’où la prudence des chercheurs vis à vis des innovations scientifiques. Sur la viande in vitro, Jean-François Hoquette de l’Inra explique que s’il y a un consensus scientifique sur la faisabilité théorique, la réaction initiale de répulsion risque de demander plusieurs générations avant que ce produit ne trouve sa place sur le marché. À l’heure où la naturalité est de plus en plus revendiquée comme une dimension de la qualité alimentaire, on trouve sur Internet des cocktails capables de couvrir tous les besoins nutritionnels et donc de se nourrir sans perdre de temps, sans décrocher de son écran d’ordinateur. Contradictoire, le consommateur n’a pas fini de surprendre. Une chose semble acquise : nous ne mangerons pas tous la même chose en 2050.