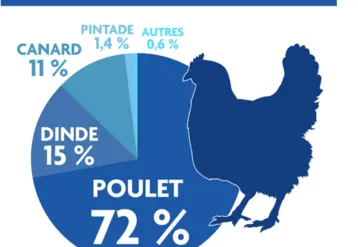Les agriculteurs disent « oui » au non-labour
De 21% en 2001, le pourcentage de grandes cultures semées sans labour préalable a atteint 34% cinq ans plus tard et ne semble pas devoir s'arrêter sur sa lancée. Dans le cas du blé dur, le non-labour semble la règle, avec 58% des surfaces françaises semées de cette manière, un chiffre qui n'a pas évolué de 2001 à 2006. Pour le colza (de 35 à 47%), le blé tendre (de 25 à 44%), et dans une moindre mesure les autres céréales et oléoprotéagineux, la tendance est au développement, compte tenu des nombreux avantages de la technique. Le gain de temps ainsi obtenu n'est pas négligeable, et permet de se consacrer à d'autres activités.
Les chiffres d'Agreste indiquent d'ailleurs une corrélation entre le taux de non-labour et la superficie des exploitations agricoles, avec une absence de retournement du sol qui devient majoritaire à partir de 300 hectares. En termes économiques, le non-labour permet un gain énergétique mesurable immédiatement, avec de 20 à 40 litres de fioul économisés par hectare. La pratique a également un avantage environnemental, en diminuant le risque d'érosion des sols. Les agriculteurs de Midi-Pyrénées, situés dans une région à fort risques d'érosion, ont été les précurseurs du non-labour, et l'adoptent aujourd'hui sur 85% des superficies de blé dur et 76% pour le blé tendre. Pour autant les données établies par Agreste, le service du ministère de l'Agriculture, révèlent des disparités dans l'exécution de cette pratique, déconseillée en monoculture. « Sans retournement des sols, les résidus de culture restent en surface et favorisent la transmission de maladies fongiques sur le blé » note l'étude.
Le non-labour favorise aussi l'augmentation des mauvaises herbes et en conséquence l'utilisation d'herbicides, En moyenne, toutes cultures confondues, 0,3 passage supplémentaire avec un herbicide est nécessaire par rapport aux agriculteurs labourant les sols. Une autre difficulté s'observe avec la culture de tournesol qui nécessite un enracinement rendu plus difficile par le non-labour, d'où un développement plus faible pour cette culture.
Enfin, le non-labour n'est pas une technique exclusive, et d'une année sur l'autre nombre d'agriculteurs ressortent temporairement la charrue. Sur les 34% des surfaces non retournées en 2006, seules 11% n'ont connu aucun labour depuis 2001, et pour cause : les parcelles sans aucun labour sur une longe durée accusent un rendement inférieur à une exploitation retournée tous les ans. La différence atteint 4% sur le blé tendre et le tournesol, 9% sur l'orge ou encore7% sur le maïs grain.