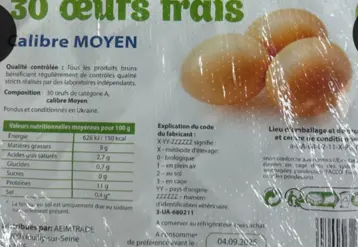Inao : « L'exigence et l'excellence doivent continuer à s'imposer à nous»

> Jean-Charles Arnaud, président de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les Marchés Hebdo : L'Inao est une structure unique au monde. Quelle est la particularité de cet organisme par rapport aux autres pays de l'UE ?
Jean-Charles Arnaud : Le sénateur Capus et le baron Le Roy, les pères fondateurs de notre actuel Inao, étaient des visionnaires. Cet institut, construit sur un modèle atypique en réunissant les services de l'État, les professionnels et les services de l'Inao, reste très pertinent. Il est un espace de prise de décision privilégié pour traiter chaque dossier avec suffisamment de recul et d'indépendance. À l'intérieur de chaque signe d'origine et de qualité, il permet de maintenir une cohérence globale conforme au cadre réglementaire et à une doctrine spécifique. Cette cohérence est aussi essentielle dans l'exercice délicat des questions/réponses avec l'Union européenne.
“ Regrouper les AOP et IGP amènerait à la banalisation
”LMH : À propos de Bruxelles, n'y a-t-il pas une volonté de minimaliser les cahiers des charges des AOP et IGP ?
J.-C. A. : Nous sentons, avec une certaine inquiétude, que Bruxelles souhaite aller de nouveau vers une fusion de l'AOP et de l'IGP dans un concept global d'indications géographiques (IG). Il est bien que l'Inao puisse réaffirmer ses valeurs et ses convictions. AOP et IGP sont complémentaires. Cette idée doit être défendue avec vigueur au niveau communautaire. AOP et IGP doivent être deux signes forts et utiles, car complémentaires et riches d'un contenu différent au sein d'un même concept global d'indications géographiques. Regrouper les AOP et IGP amènerait à la banalisation et affaiblirait le dispositif. Il faut absolument résister contre cette démarche et continuer à préserver les deux systèmes. C'est à l'inverse de notre culture et cela mènerait à faire de «l'indication de provenance» qui n'a rien à voir avec le concept d'appellations d'origine contrôlée et d'indications géographiques protégées. De plus, un tel système, qui globaliserait les deux protections, conduirait à établir des cahiers des charges a minima avec comme corollaire une perte de crédibilité vis-à-vis du consommateur. L'exigence et l'excellence doivent continuer à s'imposer à nous.
LMH : On parle beaucoup d'agroécologie. Comment cette notion peut-elle s'appliquer aux AOP et IGP ?
J.-C. A. : En matière d'AOP et IGP, notre terroir est le substrat sur lequel nos productions se développent. Il est évident que le respect de ce substrat s'impose à tout producteur. En la matière, la bonne décision ne doit être que locale. Entre Roquefort et ses causses désertiques et Beaufort, les conditions climatiques sont très différentes, et il ne peut exister une réponse globale. Ce sont les organismes de défense et de gestion (ODG) et les professionnels, qui les constituent, qui sont les mieux placés pour répondre à cette préoccupation. Pour autant, il est essentiel pour chaque produit AOP et IGP que cette problématique fasse l'objet d'un travail en profondeur. Les groupements d'intérêt écologique et économique (GIEE) peuvent être un outil adapté.
Quinze intervenants se sont succédé à la tribune du colloque de l'Inao à Avignon, qui réunissait le 16 avril les membres des six comités de l'Institut. Évènement clôturé par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Les interventions, comme les propos de Jean-Charles Arnaud (ci-dessus), ont révélé deux axes majeurs de travail : la protection des signes et les cahiers des charges. La protection afin de maintenir un système qui a fait ses preuves en matière de préservation des territoires et des actifs qui font vivre près de 250 000 exploitations ; et les cahiers des charges pour garantir la satisfaction du consommateur final qui ne doit pas être déçu par une démarche homologuée par l'État. Ces volontés ont été très clairement réaffirmées par Stéphane Le Foll : « Les signes sont essentiels à la conservation de nos valeurs. Je serai très vigilant à l'égard de la Commission européenne dans les accords que nous pourrions passer avec les États tiers, vous pouvez compter sur moi pour vous défendre. »
LMH : Dans le contrat d'objectif sur les trois ans à venir, qu'est-ce qui vous paraît fondamental ?
J.-C. A. : Les trois points les plus importants contenus dans ce contrat qui nous lie avec l'État sont la protection, l'international et l'engagement budgétaire. En 1905 et 1935, les AOC sont nées dans un contexte où la protection des noms au niveau national était vitale. Aujourd'hui, nous avons cette même problématique de protection mais au plan mondial, et malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas les réponses mondiales à cette question. En premier, il faut avancer et rester ferme sur la question à Bruxelles concernant une fusion entre AOP et IGP. Ensuite, nous devons veiller très fortement à Internet avec les propositions de l'Icann avec « .food » ou « .wine » qui permettraient de faire vendre nos noms de produit par des sociétés privées. C'est pour cela que je lie très fortement protection et international. Quid de l'accord de Lisbonne avec les vingt-huit pays qui l'ont signé ? Va-t-on arriver à les remotiver ? Et la Chine ? Et l'OMC ? On doit respecter les produits où qu'ils se trouvent avec leurs spécificités. Il reste beaucoup de travail à faire, tous les dossiers étant instruits au niveau de l'Union européenne. Nous devons travailler de concert avec le ministère de l'Agriculture pour mettre en place un correspondant technique de l'Inao auprès de la direction générale Agri.
“ Nous devrons nous faire entendre
LMH : La voix de la France est-elle entendue à l'international?”
J.-C. A.: Nous sommes la terre des appellations d'origine par excellence, et nous devons nous faire entendre. Nous avons besoin d'une cohérence. Je fais un mea-culpa concernant nos contacts avec les autres pays européens et plus particulièrement les États du sud de l'Europe. Il faut que nous développions ces contacts, car nous sommes malgré tout très proches, et nos convictions sont souvent identiques. Nous devons le faire tant au niveau des professionnels qu'avec les autres ministères. L'Inao est aussi une structure pertinente pour réaliser ces contacts, compte tenu de sa position « État/professionnels ». Cela serait très éclairant.
LMH : Concernant les dossiers français, la montée en puissance du nombre de dossiers à l'étude est-elle toujours d'actualité ?
J.-C. A.: Il est très clair que dans certains secteurs tels que le vin ou les produits laitiers, nous avons déjà beaucoup de dossiers, et l'évolution est plus réduite. Mais du côté des productions végétales, il y a de grandes possibilités de développement par le nombre de produits. D'autre part, en dehors des dossiers que nous étudions, nous développons les aspects juridiques de la protection qui deviennent de plus en plus importants ainsi que la protection des terroirs qui nous a été dévolue dans la loi d'orientation. L'Inao est le mieux placé pour le faire, c'est aussi un travail très prenant qui mobilise beaucoup d'énergies.
LMH : Les futures IG non alimentaires ont été confiées à l'Inpi. Pourquoi ce choix ?
J.-C. A.: Pour ma part, je respecte, mais je déplore ce choix. L'Inao avait toute l'expertise et les compétences pour intégrer cette facette spécifique des indications géographiques. Cela aurait été très cohérent. De plus, je doute que les dossiers concernés soient aussi simples et rapides à traiter qu'annoncé. Le cas du savon de Marseille semble en être la première illustration.