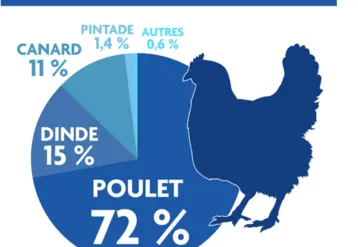Publicité sur les emballages : présentation trompeuse et concurrence déloyale
Une société ayant commercialisé des produits laitiers frais aromatisés dans des conditionnements comportant une représentation stylisée mais réaliste de produits naturels (fraises des bois, noix de coco, noisettes, grains de café…) avait été poursuivie à l’initiative d’un concurrent qui jugeait cette présentation trompeuse, pour concurrence déloyale. La Cour de cassation vient de confirmer l’arrêt de la cour d’appel qui avait interdit la commercialisation de ces produits. Analyse.
Rédaction Réussir
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 décembre 2010, avait donné raison au concurrent qui se disait victime, en interdisant la commercialisation des produits en cause dans leur présentation litigieuse. L’un des moyens de défense invoqués par la société prise en faute était de dire qu’elle n’avait violé aucune réglementation spécifique en matière de représentation des aromates, mais pour la cour d’appel de Paris, cette absence de texte spécifique était indifférente, et sa position justifiée.
Les principes généraux du droit peuvent toujours être appliqués par le juge en l’absence de texte spécifique. Dans le cas présent, le produit doit avoir une qualité « loyale et marchande » et « présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
L’industriel qui commercialise le produit doit fournir au consommateur l’information qui lui est nécessaire pour procéder à son achat en parfaite connaissance de cause, et s’abstenir de toute pratique commerciale trompeuse ou pouvant l’induire en erreur lors de l’achat.
L’arrêt de la cour d’appel a été rendu définitif par la Cour de cassation qui vient de rejeter un pourvoi.
Certes, la solution qu’il consacre n’est pas nouvelle sur le terrain de la publicité mensongère. La jurisprudence rendue sur le terrain de l’ancien article L.121-1 du code de la consommation reste totalement d’actualité et la cour d’appel l’applique aux aromates avec justesse.
Une éthique de loyauté commerciale
Une représentation même stylisée, dès lors qu’elle est réaliste, de produits naturels tels que des fraises ou des citrons, est de nature à emporter l’adhésion du consommateur et doit donc être proscrite si les produits en cause n’en contiennent pas, ou en quantité tellement minime qu’il est évident que l’aromatisation du produit est très majoritairement d’origine chimique.
C’est le premier apport de l’arrêt.
Le deuxième est procédural. Dans la majorité des cas, ce type de contentieux est élevé consécutivement à une enquête des services de la Répression des fraudes, de telle sorte que ce sont les juridictions pénales qui sont saisies.
En effet, les textes généraux dont il est question, et notamment l’article L.121-1 du code de la consommation, sont de nature répressive.
Le concurrent qui se dit victime de tels agissements peut donc se constituer partie civile sur l’action pénale. Mais l’objectif de celle-ci n’est pas tant l’indemnisation de la victime que la sanction du fautif et l’application des peines correspondantes. Or, ce n’est pas parce qu’un texte est de nature répressive qu’il ne peut être invoqué que devant une juridiction pénale.
L’obligation de ne pas tromper le consommateur a pour corollaire le respect d’une éthique de loyauté commerciale entre concurrents. Un manquement à cette obligation préjudicie non seulement aux consommateurs, mais aussi aux concurrents du fautif qui, eux, font l’effort de commercialiser leurs produits loyalement. Il s’agit donc bien d’un comportement déloyal qui peut être appréhendé comme tel par un juge civil.
L’avantage d’une telle voie civile est d’être axée en totalité sur la réparation du dommage subi par le concurrent victime. Il est donc bon que ce soit dans le cadre d’une action introduite dans ces conditions que la cour d’appel de Paris ait rappelé la pertinence des principes généraux du droit face à une dérive de celui-ci à l’anglo-saxonne.