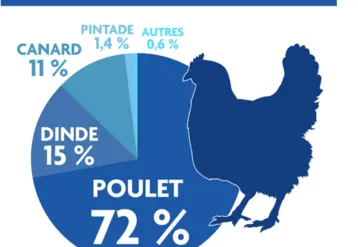Publicité pour le vin : une application très rigoureuse de la loi Évin
C’est un arrêt d’une extrême sévérité qu’a rendu la Cour de cassation le 23 février dernier, en cassant un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 février 2010 qui avait validé sept publicités par voie d’affichage élaborées sous l’égide du Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB). Le conflit portait sur le contenu même des affiches qui mettaient en scène des personnages levant un verre de vin « avec une impression manifeste de plaisir ». Analyse.
Rédaction Réussir
La publicité en faveur des boissons alcoolisées fait depuis longtemps débat. La loi du ministre de la Santé Michèle Barzach avait restreint le contenu de telles publicités, en visant notamment à limiter les incitations envers les mineurs. Mais en 1991, l’ambition de la loi Évin est bien plus grande. Elle réglemente le contenu que doit respecter la publicité autorisée, et impose un message sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Cette loi est un véritable carcan pour les publicitaires qui ne peuvent plus avoir recours aux mises en scène permettant au consommateur de s’identifier.
La publicité licite se limite au produit lui-même et aux informations nécessaires pour l’identifier.
Dans un tel contexte, une question taraude les publicitaires : faut-il considérer que tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit, ou que tout ce qui n’est pas expressément interdit est autorisé ? Jusqu’à une période récente, la jurisprudence va massivement pencher pour la première approche, c’est-à-dire une approche fermée, et ce n’est qu’en 2004 que le Bureau de vérification de la publicité (BVP) adopte une recommandation perçue par la pratique comme un élément d’ouverture.
L’usage professionnel
C’est sur la base de cette recommandation, qu’elle assimile à juste titre à un usage professionnel qui n’a pas la force d’une loi mais dont le juge peut être amené à tenir compte, que la cour d’appel de Paris valide la représentation figurative de professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation des vins de bordeaux. Et ce, dès lors qu’elle considère que cette représentation n’est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool et que les autres exigences de la loi sont respectées.
La cour d’appel ponctue son raisonnement en indiquant que, par essence, la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour en capter la clientèle et non pour l’en détourner, ce qui, effectivement, semble de pur bon sens.
Mais cela était beaucoup trop pour la Cour de cassation qui se fonde sur la représentation des professionnels dans les publicités litigieuses pour reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
L’arrêt de la Cour de cassation confirme donc que c’est l’approche fermée qui doit être privilégiée : tout ce qui n’est pas expressément autorisé par la loi Évin est rigoureusement interdit.
Cet arrêt pose ou repose plusieurs questions. Tout d’abord, comment faire œuvre de création pour communiquer sur les alcools ? Faut-il distinguer d’ailleurs le vin (qui est un aliment) des alcools dits forts pour la réglementation sur la publicité ? Ne faut-il pas réfléchir à une réglementation en ce sens ? N’est-il pas en outre paradoxal de présenter le vigneron comme une sorte de délinquant primaire, alors que la balance commerciale du secteur vitivinicole est bénéficiaire dans un contexte général de lourds déficits ?
Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation confirme que dans les rapports entre professionnels, le respect d’un usage professionnel n’est pas toujours un blanc-seing. En revanche, le manquement à un tel usage par un professionnel dans son rapport au consommateur est systématiquement synonyme de condamnation. Dura lex, sed lex.