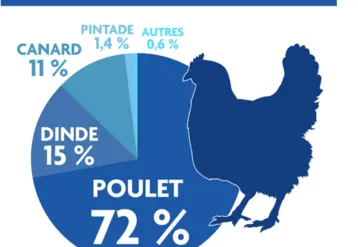Les systèmes herbivores sont source de biens publics
La FAO livre un constat alarmiste rapport « Livestock’s long shadow : environnemental issues and options », écembre 2006. au niveau mondial : un doublement de la demande en produits de l’élevage est attendu entre 2000 et 2030 ; l’élevage serait un des plus forts contributeur à la production de gaz à effet de serre, le principal consommateur d’eau et un danger pour la biodiversité.
Comment s’étonner qu’un tel diagnostic, illustré par un bovin qui jette une ombre portée sur la planète, fasse l’objet d’un succès médiatique facile, dépassant sans doute largement ce que les rapporteurs eux-mêmes ont voulu dire?
Les bovins comme cible
Le plus gênant réside dans la généralisation des conclusions tirées par les auteurs. Les cibles principales apparaissent être l’élevage bovin et la culture du soja d’Amérique du Sud qui entraînent la déforestation de l’Amazonie ; l’élevage extensif pastoral des savanes africaines, qui contribue à la progression du désert ; l’élevage porcin et avicole industriel d’Asie, qui s’accompagne d’une gestion désastreuse des effluents. Les constats dans ces zones sont certainement pertinents. Ils témoignent du développement anarchique et incontrôlé de l’économie mondiale.
Au lieu de prendre pour cible ces modes de développement, les auteurs du rapport accusent tout particulièrement l’élevage bovin. A celui-ci est fait le procès d’avoir le plus mauvais coefficient de transformation énergétique ; d’être le principal producteur de gaz à effet de serre à cause de ses fermentations entériques productrices de méthane.
Contradictoire, le rapport reconnaît pourtant le rôle positif, notamment dans les pays développés européens des prairies permanentes utilisées et entretenues uniquement par les herbivores : elles stockent du carbone, aident à préserver la biodiversité et la qualité de l’eau.
Le rapport contient d’autres contradictions comme :
- La proposition de développer les modes d’élevage intensifs alors que tous les constats faits dans le monde et en Europe témoignent des effets plus négatifs sur l’environnement de ces modes de productions par rapport aux modes d’élevage extensifs ;
- La proposition de diminuer de façon drastique le nombre d’éleveurs, ce qui ne fera qu’aggraver les déséquilibres entre zones rurales et zones urbaines
En occupant 30 % de la surface des terres de notre planète, l’élevage serait en concurrence avec l’homme, souligne le rapport. La question doit pourtant être posée de l’utilisation autre qui pourrait être faite des surfaces herbagères non cultivables, des parcours de montagne aux steppes arides en passant par les bocages, qui ne peuvent contribuer à nourrir l’humanité que par le truchement du ruminant !
Les bovins et les ovins, quand ils transforment de l’herbe et c’est bien majoritairement le cas dans de nombreux systèmes de production, ne mangent pas « le pain » des humains ! En complément des protéines nobles qu’ils fournissent, ces herbivores et les systèmes de production qui leur sont associés, assurent une production de biens publics véritables enjeux de société (qualité de l’eau, des territoires, stockage de carbone etc.). De plus, le retour direct des déjections au sol lors du pâturage a un effet positif sur la teneur en humus des sols et un moindre effet négatif sur les émissions de gaz à effet de serre.
En ce qui concerne les gaz à effet de serre, il y a toujours eu une production « naturelle » (zones humides, ruminants sauvages ou domestiques). Mais, pour ce qui concerne la France (données officielles du CITEPA), la contribution de l’agriculture aux émissions de ces gaz est en baisse (-10 % entre 2004 et 1990) quand celles des transports montent en flèche (+23%). Cette baisse de la production de gaz à effet de serre est à mettre en relation avec la baisse du cheptel d’herbivores qui se généralise aussi à l’échelle européenne. Il en est de même sur les consommations d’énergie fossile. Des études de la FAO soulignent le rôle positif de la prairie et donc des ruminants qui la valorisent.
Quant à la dégradation de la qualité de l’eau, ce ne sont pas les herbivores pâturant les prairies qui en sont les principaux responsables : les prairies ont au contraire un rôle positif d’assainissement de la qualité des eaux et de régulateurs des flux.
La situation et les politiques ne sont pas les mêmes selon les zones, et il est absurde de prétendre avoir une politique mondiale unique de l’élevage.
En Europe, des mesures vertueuses
Au plan européen, comme le reconnaissent les auteurs, un certain nombre de mesures ont été prises. Elles ont conduit à des pratiques et à des impacts positifs de l’élevage, non seulement en ce qui concerne la qualité et la sécurité des produits, mais aussi en ce qui concerne les enjeux sur l’environnement, objets de ce rapport.
Au dernier chapitre traitant des enjeux politiques et des moyens d’action, les auteurs du rapport créditent l’UE d’actions positives.
Le début de rémunération des services environnementaux, au travers des mesures du second pilier ou de la conditionnalité, sont plébiscités dans le rapport. Toute forme de soutien à l’élevage en tant que tel est par ailleurs condamnée. Les auteurs de ce rapport semblent regretter que l’augmentation du pouvoir d’achat soit synonyme d’une recherche de protéines à base de productions animales en général et de viande bovine en particulier. En revanche, la restructuration des élevages et leur concentration en zones de cultures sont vus comme des éléments positifs pour l’environnement.
Cette vision dichotomique, hyper techniciste d’un élevage industriel d’un côté, et de surfaces extensives vouées essentiellement à la production de services environnementaux dans les pays riches de l’autre, est-elle vraiment une vision d’avenir pour notre planète ?