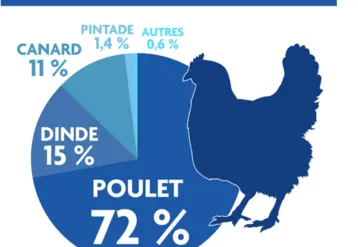Le périmètre de protection des Min face au commerce électronique
La création des Marchés d’intérêt national (Min) devait permettre la mise en concurrence en un seul lieu des différents réseaux d’acheminement des marchandises pour parvenir à la vente de produits de qualité, au meilleur prix. Cet objectif pourra-t-il être maintenu face aux nouvelles formes de commercialisation ?
Rédaction Réussir
S’implanter dans un périmètre de référence mais hors des Min afin de bénéficier de la proximité du lieu de livraison sans subir les contraintes de la législation (demande d’autorisation, paiement des redevances, contraintes réglementaires, propriété commerciale) est un but poursuivi par certains acteurs du commerce alimentaire. Mais, alors qu’un bilan du dispositif législatif français, déjà critiqué par Bruxelles, doit
être présenté avant le 31 décembre 2012 au Parlement, le développement du commerce électronique, qui permet l'échange de biens sur les réseaux informatiques et notamment Internet, vient apporter de nouvelles difficultés. Bien qu’aujourd’hui ce type de commerce concerne principalement les ventes au détail, la perspective de son développement, déjà engagé, dans le commerce de gros, ne saurait être écartée.
Il convient donc de déterminer si la réglementation actuelle permet ou non d’appréhender le phénomène. L’article L. 761-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit que dans le périmètre de référence, « les projets d’implantation ou d’extension de locaux ou d’ensemble de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m2, sont soumis à l’autorisation de l’autorité administrative (…) ».
La surface de vente
Il n’est donc pas possible, sans autorisation, d’installer dans le périmètre de référence des locaux destinés à recevoir des produits réglementés afin de les revendre autrement qu’au détail, dès lors que la surface de vente est supérieure à 1 000 m2. A priori, les modalités de la vente, qu’elle se fasse par confrontation physique du vendeur et de l’acheteur et par échange physique de la marchandise, ou par échange électronique du consentement et livraison ultérieure, sont indifférentes : ce que le texte vise pour imposer le régime d’autorisation, ce n’est pas le lieu de la vente, mais celui de la réception des marchandises destinées à être revendues. Ainsi, l’implantation dans le périmètre de référence d’un local de plus de 1 000 m2 par lequel transite la marchandise devrait impliquer une autorisation.
Mais c’est la notion de « surface de vente » qui vient troubler cette belle ordonnance : qu’en est-il si la surface concernée est exclusivement dédiée à l’entreposage à des fins logistiques, sans qu’aucune vente n’y soit consentie ? 3 000 m2 d’entrepôts restent des entrepôts, et non une surface de vente. Et si la réglementation ne définit pas ce qu’est la surface de vente, elle la distingue expressément des surfaces consacrées aux réserves, au stationnement, aux équipements spécifiques (y compris les frigos) ou à l’administration de l’entreprise (article A 761-11 du code de commerce). La surface de vente visée par la loi doit donc s’entendre comme celle où se confrontent l’offre et la demande d’un produit physiquement présent, ce qui, par définition, n’existe pas en cas de vente électronique. De même que la « zone des entrepôts » a pu se développer en dehors de l’enceinte du Min de Rungis, l’entreposage, quelle qu’en soit la surface, de marchandises destinées à être vendues par voie électronique n’est pas soumis à autorisation au regard de la réglementation des Min.
L’objectif initial visé par la création des Min se trouve ainsi mis à mal par de nouvelles méthodes de vente peu envisageables il y a cinquante ans, avec le risque d’entraîner des distorsions de concurrence.