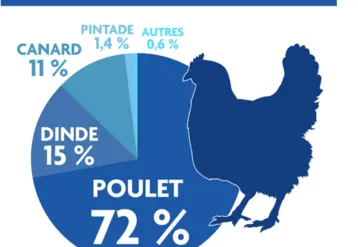Le CDD saisonnier : un contrat simple et adapté mais pas sans risque
L’emploi saisonnier constitue l’un des cas de recours autorisés au contrat à durée déterminée (CDD). En le requalifiant en contrat à durée indéterminée (CDI) avec le même salarié, lorsqu’il est successivement conclu, la Cour de cassation place l’employeur dans une certaine insécurité.
Rédaction Réussir
Un contrat simple et adapté
Le contrat saisonnier ne peut être conclu, comme tous les CDD, que par écrit et pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire (article L1242-2 3° du code du travail).
Il répond à un besoin de main-d’œuvre limité dans le temps, pour effectuer des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates prévisibles, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. L’activité est considérée comme saisonnière lorsqu’elle présente un caractère régulier, prévisible et cyclique.
Sont essentiellement concernés l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et le tourisme. Dans ces secteurs, les conventions collectives prévoient le plus souvent des dispositions spécifiques aux salariés saisonniers.
Le terme du contrat peut être fixé ou indéterminé (exemple : fin de récolte), et il n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité de précarité prévue pour d’autres types de CDD.
Afin de compenser l’absence d’indemnité de précarité versée à la rupture d’un CDD, la loi permet aux salariés saisonniers de bénéficier de certains avantages liés à l’ancienneté, comme la faculté de participer aux élections des représentants du personnel, ou de bénéficier d’une prime d’ancienneté conventionnelle, ou l’accès au congé de formation ou régime de prévoyance, ou encore le bénéfice de la participation et de l’intéressement et l’accès au régime de prévoyance.
Selon l’article L 1244-2 du code du travail, l’ancienneté du salarié est calculée par addition des durées des contrats de travail saisonniers successifs dans une même entreprise.
La conclusion de contrats saisonniers successifs, avec les mêmes salariés, pendant plusieurs années successives, n’est pas en elle-même de nature à créer entre les parties une relation de travail d’une durée indéterminée.
Un contrat risqué ?
Dans les secteurs d’activité concernés, le recours au CDD saisonnier s’effectue très fréquemment chaque année avec les mêmes salariés.
Cette pratique répond à une demande tant des employeurs désireux de retrouver un personnel fiable et déjà formé au travail à effectuer, que des salariés qui profitent d’une source de revenus récurrente.
Elle résulte parfois de la convention collective applicable, qui peut prévoir une simple priorité d’emploi en faveur des salariés saisonniers, ou une clause de reconduction automatique pour la saison suivante.
Le contrat de travail peut également prévoir des dispositions similaires.
La Cour de cassation a jugé que le renouvellement du contrat saisonnier crée entre les parties une relation de travail à durée indéterminée dès lors que s’applique une clause de reconduction automatique ou, dans le cas d’une entreprise ne fonctionnant qu’une partie de l’année, si le salarié est employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de celle-ci.
Cette jurisprudence ne fixe aucun critère précis pour déterminer les cas où une succession de contrats saisonniers avec le même salarié entraîne ou non une relation à durée indéterminée et établie.
Cette imprécision crée une véritable insécurité juridique pour l’employeur, et doit inciter à la plus grande vigilance tant au moment de la rédaction des contrats de travail, que lors de leur rupture, dont il conviendra d’apprécier au cas par cas si elle doit être traitée comme un licenciement ou comme l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminé.