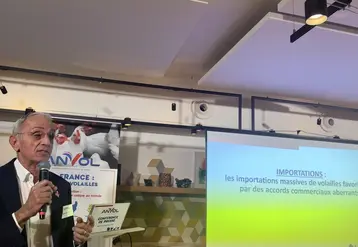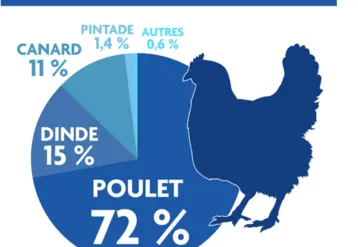La filière lait britannique menacée par la directive nitrate
L'Institut de l'élevage a mis un point final à son triptyque sur les filières animales britanniques, mardi lors du rendez-vous « 5 à 7 » à la Maison nationale des éleveurs (Paris). Après des dossiers consacrés aux ovins et aux bovins, un troisième est publié ce mois-ci sur le lait. Une particularité du Royaume-Uni est qu'il peine à produire son volume autorisé. Depuis 2000, le pays collectionne les sous-réalisations, dont l'ampleur tend à se creuser campagne après campagne, pour atteindre 2 % du quota national « livraisons » en 2005-2006. « Cette évolution traduit le manque de dynamisme et de confiance des éleveurs dans l'avenir », analyse l'institut. Leur production est mal valorisée, avec un prix parmi les plus bas des anciens États membres de l'UE. Et durant dix ans, ils ont dû encaisser la quasi-disparition du coproduit viande, consécutive à la gestion de la crise de l'ESB. Néanmoins, la situation économique et financière des élevages est dans l'ensemble plutôt bonne, avec des revenus courants parmi les plus élevés de l'Union, dus à l'effet taille, mais aussi à un très faible endettement.
Position attentiste
L'introduction du découplage en 2005 a eu des effets immédiats contrastés. Auparavant peu dynamique, le marché des droits à produire s'est effondré, tandis que les fermetures d'ateliers se sont ralenties, signe d'un certain attentisme des éleveurs. Ces derniers bénéficient d'une meilleure conjoncture, marquée par la résistance du produit lait à la baisse des prix d'intervention et le retour du coproduit viande. Mais, ils doivent envisager des investissements importants de mise aux normes de leur bâtiment d'élevage pour rester dans la production. « L'application de la directive nitrates, peu avancée au Royaume-Uni, va sans doute, dans le cadre de la conditionnalité des aides, être déterminante sur l'évolution des fermes laitières », estime l'institut. Elle oblige les exploitations, souvent localisées dans les zones vulnérables, à investir rapidement. Les élevages doivent en effet disposer d'une capacité de stockage des effluents d'au moins cinq mois, alors qu'elle ne dépasse pas en moyenne un mois.
Deux scénarii sont imaginés à l'horizon 2010. Dans l'hypothèse d'un prix quasi-stabilisé à son niveau de 2006, la production laitière pourrait décliner et se situer dans quatre ans près de 10 % sous le droit à produire du pays, avec un nombre d'exploitations ramené à moins de 15 000 (contre plus de 20 000 aujourd'hui). Les gains de productivité resteraient soutenus, de l'ordre de 150 à 160 kg/vache/an, ce qui ramènerait le cheptel laitier sous la barre du 1,8 M de têtes, 15 % de moins que fin 2005, soit un rythme de baisse de 3 % l'an. Dans un scénario pessimiste, basé sur un prix du lait inférieur de 15 % à celui de 2006, la collecte laitière pourrait tomber à 12 Mt et provenir, tout au plus, de 13 000 ateliers. Autrement dit, la sous-réalisation nationale serait quasi-doublée par rapport à celle du scénario précédent. Le cheptel serait ramené à 1,6 M de vaches, 22 % sous le niveau de 2005.