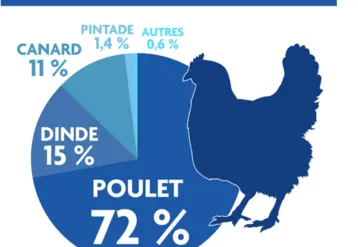La bataille contre le maïs OGM en France est-elle perdue ?
Certains diront que c’était écrit ! Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 septembre 2011, qui a considéré que le moratoire français sur la culture d’OGM n’était pas conforme aux normes européennes, il était clair que l’arrêté par lequel le gouvernement français avait suspendu, en février 2008, l’autorisation de culture du maïs MON 810 risquait l’annulation par le Conseil d’État.
Rédaction Réussir
Le coup de grâce a été porté lundi 28 novembre 2011 par la haute juridiction administrative, avec pour effet de rendre à nouveau licite la culture du maïs MON 810 sur le territoire français.
Dès septembre 2011, le gouvernement français avait annoncé qu’il adopterait de nouvelles clauses de sauvegarde si la suspension de février 2008 était annulée.
Si, sur le plan politique, le maïs Monsanto 810 fait en France l’unanimité contre lui, force est de constater qu’au plan juridique, les choses ne sont pas si simples. Tout d’abord, parce que les règlements communautaires eux-mêmes prévoient une procédure d’autorisation pour la mise sur le marché des produits issus de l’organisme génétiquement modifié, ou des OGM eux-mêmes, en distinguant selon les conditions de leur utilisation.
Dans le cas qui nous intéresse, le MON 810 avait été autorisé et c’est à l’occasion d’une demande de renouvellement de l’autorisation que le problème s’est posé.
L’autorisation accordée au niveau communautaire l’a été dans les conditions de la directive applicable alors, incluant notamment une étude scientifique poussée qui tenait compte des connaissances de l’époque.
En 2008, si la connaissance scientifique a pu progresser, néanmoins l’autorisation du MON 810 n’est pas remise en cause au niveau communautaire. Par conséquent, il s’agit d’un produit qui, comme tous les produits, doit bénéficier du principe de liberté de circulation, sauf exception liée notamment à un motif de santé publique.
L’actuel règlement communautaire relatif aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés envisage le cas d’un produit autorisé par le règlement qui serait « de toute évidence susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », et prévoit, dans ce cas, la possibilité de décider de mesures d’urgence.
Une question de preuve
Mais ce n’est pas sur ce texte (article 34 du règlement n° 1829/2003) que se fonde la position française, mais sur un texte permettant,
sous certaines conditions, l’adoption de clauses de sauvegarde par les États membres qui résulte de la directive précédant ce règlement.
La Cour de justice indiquait donc logiquement en septembre 2011 que l’article 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil n’est pas une base juridique suffisante.
Mais la Cour de justice va plus loin puisqu’elle affirme qu’en revanche, les dispositions de l’article 34 du règlement précité peuvent justifier des mesures d’urgence à la diligence d’un État membre, à condition de respecter la procédure et les conditions de fond.
Or, dans son arrêt du 28 novembre dernier, le Conseil d’État reproche notamment au ministre de l’Agriculture de n’avoir pas rapporté la preuve de l’existence d’un niveau de risque particulièrement élevé pour la santé ou l’environnement.
Ces conditions de fond ressortent non pas de l’article de la directive sur lequel le gouvernement français s’était fondé, mais de l’article 34 que, d’après la Cour de justice, il aurait fallu appliquer en l’espèce.
Autant dire que, sauf à pouvoir apporter la preuve d’un tel risque, il sera bien difficile pour le gouvernement français de prendre une nouvelle mesure de suspension à l’égard du MON 810 qui, encore une fois, continue de bénéficier de son autorisation de principe dans les territoires de l’UE.
Est-ce une bataille perdue, ou la guerre qui a pris fin ?