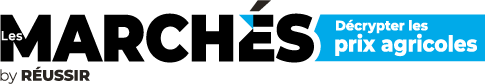« Il faut gérer en même temps sous-nutrition et surnutrition »

Yves Martin-Prével, épidémiologiste, médecin chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), évoque pour Les Marchés les multiples facettes de la faim dans le monde. Quand les problèmes de malnutrition ne touchent pas que les pays pauvres.
LMH : Lors de votre intervention aux Controverses de Marciac en août dernier, vous avez insisté longuement sur la complexité des questions de la malnutrition et de la faim dans le monde…
Yves Martin-Prével : Oui, la sous-alimentation n’est qu’un des facteurs de la sous-nutrition, tout comme la suralimentation n’est qu’un des facteurs de l’obésité. L’état nutritionnel est basé sur trois piliers, en anglais food, health, care, donc l’alimentation, la santé, et ce concept de « care », beaucoup plus complexe à définir en français mais qui tourne autour de la notion de soins et d’attention portés à l’enfant et à la femme, aux personnes vulnérables en général, donc pas seulement dans son acception médicale du terme, « soin de santé ». La situation est très variable selon les pays. Ainsi, le Niger, paradoxalement, est un pays qui commence à être confronté à l’obésité en milieu urbain, même si c’est encore la sous-nutrition en milieu rural qui reste le problème majeur. Dans la capitale d’à côté, à Ouagadougou, au Burkina Faso, une femme sur trois est en surpoids, c’est proportionnellement plus qu’à Paris. C’est là que réside toute la complexité du sujet : il faut gérer en même temps la surnutrition et la sous-nutrition. Mais il n’est pas politiquement correct de dire qu’il faut lutter contre l’obésité dans les pays pauvres, alors qu’elle induit des maladies également dévastatrices…
LMH : Il est en effet aujourd’hui beaucoup question d’obésité dans nos médias…
Y. M.-P. : Oui, nous sommes confrontés à une épidémie mondiale d’obésité. Elle concerne aussi les pays en développement. Elle est née dans les années 1970, avec la chute des prix agricoles, notamment le sucre et les huiles végétales… Ce sont deux produits qui flattent le palais et sont devenus accessibles aux classes moyennes de pays pauvres et aux classes pauvres des pays riches. Mais il existe aussi un second facteur indissociable, l’urbanisation et la perte d’activité physique qui y est liée, auxquels viennent se greffer d’autres phénomènes purement sociaux et comportementaux. L’obésité a touché les classes les plus riches chez nous il y a une soixantaine d’années, maintenant elle touche les classes les plus pauvres. Mais la mise en place du plan national nutrition santé a permis de limiter son extension.
LMH : Vous insistez beaucoup sur les différentes facettes de la sous-nutrition, quelles sont-elles ?
Y. M.-P. : Pour simplifier, disons qu’il existe deux types de malnutrition, la malnutrition aiguë et la malnutrition chronique. Dans sa forme aiguë, la malnutrition est un déséquilibre brutal chez le jeune enfant, souvent provoqué par une maladie infectieuse sur la base d’une insuffisance globale de son alimentation. Déséquilibre qui peut-être quantitatif mais aussi – et très souvent – qualitatif, c’est-à-dire lié au manque de micronutriments nécessaires dans des bouillies non adaptées à la digestibilité de l’enfant. L’enfant développe une succession de maladies, se nourrit moins, utilise une partie du peu de calories qu’il ingère pour combattre l’infection. Dès lors, une simple diarrhée peut conduire à une situation désespérée en trois semaines… La forme chronique est plus le résultat d’une accumulation. La ration de l’enfant n’est globalement pas suffisante, il tombe malade plus souvent, la famille n’a pas forcément le temps de s’occuper de lui suffisamment.
LMH : Quelles sont les conséquences ?
Y. M.-P. : Ce cycle provoque des retards de croissance qui ne sont pas forcément perceptibles. Lorsqu’on croise ces enfants dans la rue, on n'a pas l’impression qu’ils sont malades. Pourtant, ils sont un peu plus petits que la moyenne, cela influe beaucoup sur leur force physique mais également sur leurs capacités d’apprentissage. Ils seront moins productifs. C’est une problématique qui concerne 180 à 200 millions d’enfants dans le monde. Cela peut coûter d’un à trois points de produit intérieur brut dans les pays en voie de développement. En fait les questions de nutrition sont fondamentalement des questions de société. S’il y a crise alimentaire et nutritionnelle aujourd'hui, ce n’est pas uniquement parce que les récoltes sont mauvaises. Les problèmes surviennent parce qu’on a laissé de côté les questions de nutrition…
LMH : Et pour quelles raisons ?
Y. M.-P. : Cela tient beaucoup au jeu politique international. Les nutritionnistes, et le « Standing committee for nutrition » ont longtemps été inaudibles dans le concert des enjeux liés à l’alimentation et à la faim dans le monde. Toutes les grandes organisations, Organisation mondiale de la santé, FAO, programme alimentaire mondial, Unicef, sont en compétition sur les mêmes fonds. Il est donc souvent difficile de promouvoir et faire accepter des actions à long terme, multisectorielles, face aux secours d’urgence à apporter aux malnutris aigus, plus médiatiques. Nous avions eu bon espoir en 1992 avec la conférence internationale de Rome sur la nutrition, mais le travail a été balayé par le sommet mondial de l’alimentation organisé quatre ans après. Cela dit, l’Union européenne, qui est un gros bailleur des programmes de développement, s’intéresse de plus en plus aux questions de nutrition et pousse à remettre de l’ordre. La nomination de David Nabarro en tant que représentant spécial de Ban Ki-moon pour la sécurité alimentaire et la nutrition permettra peut-être de faire avancer les choses vers une meilleure prise en compte du facteur nutrition dans les débats et les actions à mener.