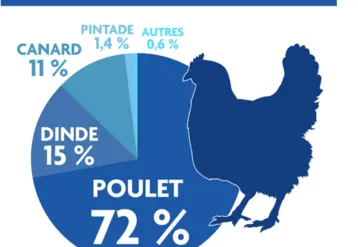Deux étapes majeures dans le statut des interprofessions
Le statut juridique des organisations interprofessionnelles agricoles fait depuis quarante ans l’objet de débats sur deux points fondamentaux : le statut des cotisations volontaires étendues, d’une part, la composition de ces interprofessions d’autre part. Deux étapes majeures viennent récemment d’être franchies.
Rédaction Réussir
Les organisations interprofessionnelles françaises bénéficient du concours de l’État pour assurer leur financement : c’est un arrêté interministériel qui rend obligatoires à tous les professionnels concernés les cotisations et règles volontairement établies entre les organisations les représentant. La Commission européenne a considéré en décembre 2008 qu’au regard des règles communautaires régissant les aides d’État, les cotisations devaient donc être assimilées à des ressources publiques de sorte que les actions menées par les interprofessions relevaient de son contrôle préalable, à peine de violation du traité.
Les interprofessions relèvent du droit privé français
L’État français et plusieurs interprofessions ont saisi le Tribunal de l’Union, tandis que le Conseil d’État, tenant le caractère privé des cotisations, a saisi la Cour de justice et que les procédures engagées, très minoritaires au regard du nombre de cotisants, ont été suspendues par les tribunaux et cours d’appel nationaux en attendant que ces juridictions européennes se prononcent.
Dans ce débat, une étape importante a été franchie avec la décision prononcée le 17 février 2012 par le Conseil constitutionnel. Saisi par quelques viticulteurs se fondant sur l’analyse de la Commission européenne, celui-ci a affirmé la conformité de l’article L 632-6 du code rural (régissant le mode d’établissement des cotisations) avec la Constitution, jugeant que les organisations interprofessionnelles et leur financement relevaient du seul droit privé. Les cotisations interprofessionnelles ne peuvent plus être qualifiées de ressources publiques au regard du droit français, et ce n’est donc plus que sur le plan communautaire, au regard du régime des aides d’État et pour la seule période antérieure à 2008 que la décision des juridictions européennes reste attendue.
Pluralité syndicale
L’article L 632-1 du code rural permet la reconnaissance des organisations interprofessionnelles dès lors qu’elles sont composées des organisations les plus représentatives des diverses professions de la filière. Le syndicat majoritaire FNSEA, à l’origine du système des interprofessions et de la création de beaucoup d’entre elles, considérait jusqu’à présent qu’il suffisait à représenter la production. La décision du Conseil constitutionnel ne pouvait que le renforcer dans l’idée que, contrairement aux organismes publics (les offices, par exemple), les interprofessions dont le caractère purement privé se trouvait consacré, organisent comme elles l’entendent la représentation des producteurs. Le 23 février, pourtant, le conseil d’administration de la FNSEA a ouvert la porte en décidant par un vote que les interprofessions organisées en collèges puissent désormais admettre en leur sein des représentants des organisations minoritaires, pour peu qu’ils soient représentatifs du secteur d’activité concerné. L’aval en fera-t-il autant ?
Alors que dans ses propositions pour la nouvelle Pac, la Commission européenne fait une large part à l’action des interprofessions agricoles, rendant ainsi hommage à cette invention française tout en souhaitant enserrer leur fonctionnement et leur action dans des règles strictement contrôlées par ses propres soins, tout le parti de ces deux étapes décisives doit être tiré pour les renforcer.