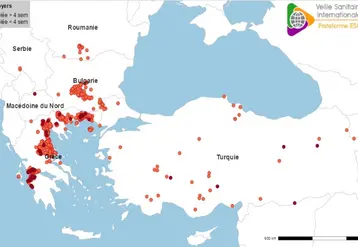Des analyses de lait de chèvre à chaque collecte
À partir de janvier 2026, chaque collecte de lait de chèvre sera analysée pour un paiement encore plus représentatif de la qualité du lait, davantage d’équité entre producteurs et la création de données utiles pour la gestion du troupeau. Explications des deux nouveaux accords interprofessionnels.
À partir de janvier 2026, chaque collecte de lait de chèvre sera analysée pour un paiement encore plus représentatif de la qualité du lait, davantage d’équité entre producteurs et la création de données utiles pour la gestion du troupeau. Explications des deux nouveaux accords interprofessionnels.


La filière caprine s’appuie sur deux accords interprofessionnels pour la collecte du lait de chèvre : celui sur le paiement du lait de 2012 et celui sur les analyses de 2021. Ces accords ont été mis à jour et les trois collèges de l’Association nationale interprofessionnelle caprine (Anicap) viennent de les signer.
L’accord sur les analyses fixe les critères analysés, leur fréquence, les modalités d’échantillonnage et d’acheminement, ainsi que des règles de gestion. « À partir du 1er janvier 2026, l’ensemble des livraisons feront l’objet d’analyses systématiques à chaque passage sur les critères de matière grasse, matière protéique, résidus d’antibiotiques (inhibiteurs), point de congélation (cryoscopie), cellules somatiques et urée », liste Marilyne Le Pape, la directrice de l’Anicap. Le paiement se fera sur la moyenne de tous les prélèvements validés.
Les germes à 30 °C continueront d’être analysés trois fois par mois minimum et les critères optionnels (indice de lipolyse, spores butyriques, IGG1) une fois par mois minimum. Pour les IGG1, la période d’analyse a été élargie de septembre à mars. À noter qu’une nouvelle règle encadre les écarts au-delà de 7 grammes par litre entre deux analyses pour la MG et la MP. Cet accord sur les analyses fait l’objet d’une demande d’extension auprès des pouvoirs publics. Une fois étendu, il deviendra d’application obligatoire pour tous les opérateurs de la filière.
Des classes à valeurs bornées et communes
Par ailleurs, l’accord sur la classification du lait remplace l’accord relatif au paiement du lait de 2012. Il définit des classes, bornes et seuils harmonisés pour les critères germes, cellules et IGG1 et préconise des modalités en cas de positivité aux inhibiteurs. Son application reste volontaire et relève des relations contractuelles entre le producteur de lait ou l’OP et la laiterie, coopérative ou privée. Tous ces acteurs pourront s’y référer dans le cadre de leurs relations contractuelles et décider des bonifications ou pénalisations à appliquer selon les différentes classes.

Les limites de classes sont indiquées dans le tableau ci-dessus. Concrètement, la teneur en cellules somatiques, qui indique les infections mammaires, vise un seuil à un million de cellules par ml. Pour la teneur en germes, l’objectif reste d’être à moins de 50 000 germes par ml. Indicateur de la présence de colostrum, la teneur en IGG1 est optimum à moins de 0,8 g/l, sur la base d’une analyse mensuelle de septembre à mars.
Pénalités pédagogiques
En cas de résidus d’antibiotiques, les modalités de pénalisation ont une logique pédagogique et distinguent si le producteur prévient la laiterie ou non. « Nous préconisons une indemnisation à 50 % de la valeur du lait livré lorsque le producteur détecte et signale l’erreur avant le pompage du lait », explique Mickaël Lamy, éleveur dans le Maine-et-Loire et président de l’Anicap, en précisant que cette indemnisation ne pourra s’appliquer qu’une seule fois sur 12 mois glissants par exploitation.
Dans le cas où l’échantillon est positif au ramassage pour la première fois en 12 mois, la réparation due à l’acheteur par le producteur sera de 50 % de la valeur du lait livré. En cas de récidive sur 12 mois glissants, le producteur de lait devra payer 100 % de la valeur du lait à sa laiterie. La pénalité sera de 150 % la troisième fois et les fois suivantes.
Plus de données pour une gestion plus fine

Du côté des éleveurs, l’intérêt est de pouvoir piloter plus finement l’alimentation du troupeau et de réagir plus rapidement en cas d’écarts. « Les producteurs qui sont déjà passés à l’analyse systématique ne reviendraient pas en arrière, assure Mickaël Lamy. Ça donne un outil de pilotage supplémentaire qui permet de mieux suivre l’évolution des taux, des cellules ou de l’urée. Le résultat revient tous les deux ou trois jours et on détecte plus vite un souci sanitaire ou un déséquilibre alimentaire. »
La montée en fréquence des analyses ouvre des perspectives en conseil d’élevage, outils connectés et aides au diagnostic. « Davantage de données, c’est plus de matière pour comprendre, conseiller et agir, apprécie Mickaël Lamy. Contrôle laitier, techniciens et éleveurs auront des indicateurs pour trouver plus vite l’origine d’un problème et le corriger. »
Recherche systématique des inhibiteurs
Multiplier les moments de mesure réduit aussi l’effet « coup de chance » ou « coup de malchance » pour le paiement sur la base de trois analyses mensuelles. « Quand une poussée de cellules survient, l’analyse ne pèsera plus pour un tiers du mois mais pour un dixième de la facture de lait dans le cas le plus fréquent d’une collecte à 72 heures. »
En fait, la filière caprine s’est inspirée des pratiques du lait de vache et du Cniel qui a signé un accord similaire en 2022. « La recherche systématique des inhibiteurs s’inscrit dans une démarche responsable, défend également la directrice de l’Anicap. Même si notre filière est peu exposée, étendre la recherche des antibiotiques à chaque enlèvement montre notre vigilance collective. »
Transparence et équité
Comme auparavant, les coûts d’analyses seront partagés entre producteurs et transformateurs, selon des clés fixées par les laboratoires interprofessionnels. « Le coût additionnel restera modeste, assure Mickaël Lamy, de l’ordre de la quinzaine d’euros mais variable d’une situation à l’autre. Si le nombre d’analyse est multiplié par dix, les tarifs ne seront pas multipliés par trois. La logistique des prélèvements existe déjà et les économies d’échelle jouent à plein quand on augmente le nombre d’analyses. Le rapport bénéfice/coût reste de toute façon très positif pour la ferme comme pour la filière. » Ces nouveaux accords présentent aussi l’intérêt d’homogénéiser les règles entre les régions et les laiteries. « C’est une harmonisation attendue qui apporte transparence et équité », conclut Mickaël Lamy
Philippe Bru, éleveur du Tarn et coopérateur Sodiaal : « Pour 180 € par an, j’ai un vrai outil de suivi du troupeau »

« Avec les autres coopérateurs caprins de Sodiaal, cela fait environ cinq ans que nous avons les analyses de matière grasse, matière protéique, cellules et urée à chaque collecte. À chaque prélèvement, on a toutes les infos sur la qualité du lait très vite, sans attendre jusqu’à parfois vingt jours comme avant. Je reçois les résultats par mail, SMS ou sur le site Infolabo, et ça me permet de réagir tout de suite. Si la matière grasse ne monte pas normalement ou si l’urée chute, je sais qu’il y a un souci dans la ration ou sur le matériel de distribution. Ça me coûte un peu plus d’une quinzaine d’euros par mois et c’est un vrai outil de suivi du troupeau. La façon de payer le lait devient plus juste. On est payé sur la qualité réelle du lait, comme quand on livre du blé et qu’on fait la moyenne de chaque remorque. »
Jean-Marc Ressegand, éleveur dans la Vienne et vice-président de Terra Lacta : « Plus personne ne veut revenir en arrière »

« Chez Terra Lacta, nous faisons l’analyse du lait à chaque collecte depuis deux ans. Quand ça s’est mis en place pour les vaches, nous l’avons fait en chèvre un an plus tard. Cela permet d’avoir les résultats dès le lendemain et, même si ça représente un petit coût supplémentaire, 11 euros par mois jusqu’à maintenant, personne ne veut revenir en arrière. En expliquant bien les choses, les éleveurs comprennent que c’est dans leur intérêt. On est censés livrer du lait conforme et ces analyses régulières nous aident à le garantir. Aujourd’hui, nous travaillons avec l’interprofession régionale pour redéfinir les classes et harmoniser les pratiques entre régions. En cas de présence d’inhibiteurs, l’idée est d’avoir de la progressivité dans les sanctions : frapper plus fort en cas de récidive, mais ne pas pénaliser tout le mois pour une seule analyse positive. »