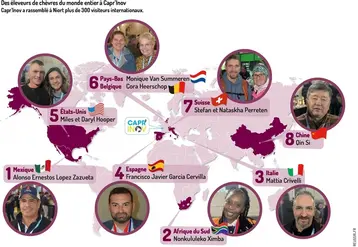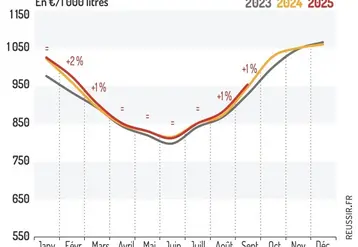Les fromagers fermiers veulent garder de la flexibilité
Alors que les outils d’inspection sanitaire évoluent, les producteurs fermiers continuent de défendre une approche adaptée à leurs réalités.
Alors que les outils d’inspection sanitaire évoluent, les producteurs fermiers continuent de défendre une approche adaptée à leurs réalités.


Lors de la journée d’échanges entre fromagers fermiers, administration et conseillers techniques du 20 mars dernier, les discussions ont mis en lumière un besoin partagé : produire des fromages de manière sécurisés, oui, mais sans alourdir les contraintes, ni standardiser à outrance.
Franck Louvet, représentant de la Direction générale de l’alimentation (DGAL), a présenté les outils à disposition des inspecteurs : vade-mecum général et sectoriel, fiches flexibilité, guides d’inspection… Autant de documents conçus pour harmoniser les pratiques de contrôle tout en intégrant la réalité des petites structures.
« Vade-mecum » et fiches flexibilité : un cadre en évolution
« Ces outils sont publics et téléchargeables sur agriculture.gouv.fr/les-vade-mecums-dinspection. Ils permettent aussi aux producteurs d’anticiper ce qui est attendu », a-t-il rappelé. Le vade-mecum général a été actualisé en 2024 ; celui pour les produits laitiers est en cours de révision. Objectif : « intégrer les évolutions réglementaires et mieux prendre en compte les dangers chimiques ».
Les mesures de flexibilité prévues s’appuient sur le droit européen et concernent surtout les locaux, les équipements et les méthodes traditionnelles. Il s’agit par exemple de permettre aux producteurs d’utiliser une planche d’affinage en bois, d’envelopper les fromages dans des feuilles ou d’avoir une cave naturelle. Mais attention, prévient Franck Louvet : « La flexibilité ne doit pas engendrer une compromission de la santé du consommateur. »
Une analyse mensuelle du lait cru : la ligne rouge ?
Le vade-mecum d’inspection évolue : l’ancien permettait l’utilisation d’eau propre dans certains cas en production fermière, et obligeait l’utilisation d’eau potable en atelier de transformation. À présent, il y aurait obligation d’utiliser de l’eau potable en production fermière dans tous les locaux où sont manipulés du lait ou des produits laitiers.
C’est sur la mise à jour de la flexibilité des autocontrôles que les débats se sont enflammés. Jusqu’à présent, les analyses autocontrôles de la matière première du lait cru devaient être a minima trimestrielles. Or, la proposition d’une fréquence mensuelle d’analyses microbiologiques du lait cru suscite incompréhension et inquiétude. Les producteurs et techniciens ont rappelé l’importance de l’esprit du Guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) européen dans la maîtrise des risques en production laitière fermière avec la responsabilité du producteur et de l’obligation de résultat, et non de moyens.
« Les fromagers fermiers n’auront jamais les mêmes capacités d’autocontrôles que les laiteries, reconnaît Jean-Philippe Bonnefoy, fromager fermier en Saône-et-Loire et vice-président de la Fnec. Mais, nous sommes tous les jours avec nos animaux, tous les jours en train de fabriquer, cela nous donne une vision globale de tout le parcours du fromage. Chaque fois que l’on indique un seuil dans le vade-mecum, cela crispe les producteurs, car il y a 6 000 fermiers, 6 000 façons différentes de faire des fromages et 6 000 seuils différents. C’est à chaque producteur de s’approprier sa fabrication et ses risques. » Le fromager rappelle aussi que 80 techniciens et 2 874 producteurs ont été formés au GBPH depuis 2018, dont presque 40 % des producteurs fermiers caprins.
Pas de standardisation excessive
« Multiplier les analyses va créer de l’activité pour les laboratoires mais cela sera contre-productif pour les fromagers fermiers qui vont empiler les analyses sans en avoir vraiment besoin », craint Sébastien Breton de l’Association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes (AFTAlp). Sans compter que, dans certaines zones, emmener un échantillon au laboratoire, c’est une demi-journée de perdue pour un producteur isolé. Et encore faut-il s’assurer du maintien de l’échantillon au frais pour que cela soit pertinent. Un technicien fromager propose une alternative : « Beaucoup utilisent des tests simples et peu coûteux à la ferme. Des petrifilms, une boîte d’incubation, et ils savent tout de suite si ça colle ou pas. »
Dans la salle, plusieurs témoignages ont pointé le risque d’une standardisation excessive : « Ce que l’on craint, c’est que l’inspecteur arrive avec sa grille, ses seuils, et ne regarde pas le contexte. » « On veut que le GBPH reste un outil vivant, adapté, pas un cahier de sanctions », lance une productrice. Pour Jean-Philippe Bonnefoy de la Fnec, « il faut redonner toute sa place au binôme technicien-producteur pour écrire ensemble le plan de maîtrise sanitaire. C’est cette appropriation qui garantit la qualité. »
500 ateliers fromagers contrôlés en 2025
Le ministère de l’Agriculture a établi son plan de surveillance 2025 pour les fromages au lait cru. 1 000 échantillons seront prélevés dans 500 ateliers, dont 60 % de fermiers. Un échantillon concernera la recherche d’Escherichia coli productrice de shigatoxines (Stec) et l’autre pour les Listeria monocytogenes et les salmonelles. À noter que les résultats de 2022 montrent des contaminations relativement faibles avec 0,3 % de fromages contaminées par des Campylobacter, 1,2 % par des STEC, 0,23 % par des salmonelles et 1,39 % par des Listeria monocytogenes.
Des contrôles sanitaires délégués
La mise en œuvre de la police sanitaire unique se poursuit, avec la délégation depuis janvier 2024 de certains contrôles sanitaires à cinq organismes privés sélectionnés par appel d’offres. Ces délégataires interviennent principalement en première intention sur les établissements de remise directe, sous la supervision des DDPP, qui conservent toutefois la main sur certaines filières sensibles comme la production fermière, la restauration collective ou les cas juridiques complexes. Cette réforme vise à augmenter le nombre de contrôle de 80 %.
Une fausse impression d’augmentation des alertes
Sophie Belichon, cheffe de la mission des urgences sanitaires à la DGAL, présentait la plateforme RappelConso (rappel.conso.gouv.fr) qui recense toutes les alertes de produits dangereux. Elle regrette la disproportion médiatique autour de certaines alertes bénignes, tandis que d’autres, bien plus graves, passent inaperçues : « On a parfois des alertes graves avec des cas humains hospitalisés, mais qui ne sont pas reprises médiatiquement. Ça nous pose un problème. » Elle rappelle la nécessité d’une juste mesure dans le niveau de signalement : ni trop peu, au risque d’être perçu comme une dissimulation, ni trop, au point d’affoler inutilement. Le Guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire est diffusé depuis deux ans auprès des services de l’État et des professionnels.
Quant à revenir sur la recommandation de non-consommation de fromage au lait cru pour les moins de cinq ans, le ministère ne semble pas près de faire marche arrière : « Chaque année, nous avons des enfants en réanimation après avoir consommé des fromages au lait cru, alerte Sophie Belichon. Ces produits sont excellents, mais pas pour les moins de cinq ans. »