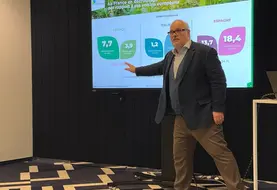Quelles règles d'épandage pour les boues et composts d'origine urbaine ou industrielle ?
Les épandages de produits résiduaires urbains et industriels sont soumis à une réglementation très stricte qui dépend du type de matière épandue, du site de production ou de traitement, et des règles environnementales et agricoles, nationales et locales. Entre plan d’épandage, norme, AMM, cahier des charges… on fait le point.
Les épandages de produits résiduaires urbains et industriels sont soumis à une réglementation très stricte qui dépend du type de matière épandue, du site de production ou de traitement, et des règles environnementales et agricoles, nationales et locales. Entre plan d’épandage, norme, AMM, cahier des charges… on fait le point.

Une des voies possibles d’élimination des produits résiduaires organiques (PRO) est leur recyclage agronomique comme fertilisant. La filière est très organisée et strictement réglementée. Deux situations peuvent se présenter selon le statut des PRO. Soit ils sont considérés comme des déchets au sens réglementaire du terme, et ils respectent alors une norme ou sont soumis à un plan d’épandage (c’est le cas pour deux tiers des volumes). Soit ils ont fait l’objet d’un changement de statut et doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges spécifique, de leur autorisation de mise sur le marché (AMM) ou du règlement européen de 2019.
La réglementation nationale prône deux principes fondamentaux : l’intérêt agronomique des matières épandues et leur innocuité pour l’homme et l’environnement. L’épandage des PRO est, dans la majorité des cas calé sur la réglementation applicable aux boues issues du traitement des eaux usées, à savoir le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, codifié depuis aux articles R211-25 à 47 du Code de l’environnement, et l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. Pour les matières d’origine industrielle, l’arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, fait foi. S’y ajoutent les différents textes dits de branches, pour les cendres de chaufferies biomasse ou les boues de papeteries, par exemple.
Les boues sont des déchets soumis à un plan d’épandage
« Les boues de stations d’épuration urbaines, de sites industriels classés ICPE, telles que des papeteries, relèvent généralement du statut de déchet sous plan d’épandage », indique Sandra Bapst, chargée de projets au sein du Syndicat mixte recyclage agricole du Haut-Rhin (SMRA 68). La réglementation nationale liste les documents à produire à l’élaboration initiale du plan d’épandage, puis, annuellement, au fur et à mesure des épandages du déchet. Les textes fixent un nombre et une fréquence d’analyses à réaliser sur des parcelles de référence (pH, oligoéléments et ETM tous les 10 ans) ainsi que sur les produits résiduaires, et déterminent les teneurs et flux décennaux à ne pas dépasser en termes d’éléments traces métalliques (ETM) et composés traces organiques (CTO). Ils imposent aussi au producteur du déchet, des prescriptions de stockage et d’emploi, selon les contraintes du terrain. À cela s’ajoutent les applications locales des réglementations telles que la directive nitrates, les périmètres de protection de captage, les zones Natura 2000, etc.
Sandra Bapst explique qu’il n’existe pas encore de seuils relatifs à l’efficacité agronomique des produits. « Le seul point qui est clairement mentionné, est que l’épandage est proscrit si le déchet n’a pas d’intérêt agronomique. Celui-ci est laissé au jugement des experts. » Les DDT (M), qui sont les réceptionnaires de l’étude préalable d’épandage et du répertoire des parcelles, font appel à des organismes indépendants du producteur de boues, comme le SMRA 68 ou ses homologues au sein des chambres d’agriculture. « Nous sommes sollicités pour avis lors du dépôt du dossier, puis chaque année lorsque le producteur de déchet réalise son programme prévisionnel d’épandage et enfin, lors de l’édition du bilan des épandages. » De son côté, l’agriculteur qui est volontaire signe un contrat écrit avec le producteur de PRO, pour une matière donnée et un ensemble de parcelles mises à disposition. Ensuite, chaque année, l’agriculteur propose les parcelles qui pourraient être épandues selon ses rotations et ses besoins (le choix est fait ensuite selon les tonnages disponibles). Jean-Philippe Bernard, référent national au sein de la chambre d’agriculture France, indique que « l’agriculteur n’est pas responsable du déchet épandu, et que cela reste de la responsabilité du producteur ou de son prestataire ». L’agriculteur doit respecter la directive nitrates si les parcelles épandues sont situées en zone vulnérable.

Les composts sont des produits normalisés
Les produits issus de plateformes de compostage sont généralement des composts normalisés. En fonction de leur origine, le responsable de la plateforme doit garantir qu’ils respectent les critères définis par la norme NFU 44-095 ou NFU 44-295 selon la teneur en phosphore (composts de boues urbaines et certaines boues industrielles) ou encore NFU 44-051 (composts de déchets verts, de biodéchets…). Ces normes ne permettent pas de sortir du statut de déchet, mais de s’affranchir d’un plan d’épandage. « La normalisation devait permettre à ces composts d’être commercialisés en tant que matière fertilisante, mais la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire l’a interdit. Ainsi, ils ont gardé leur statut de déchet, et restent de la responsabilité de leur producteur », explique Sandra Bapts. Le responsable de la plateforme assure le suivi des composts (analyses…) et leur valorisation (ils peuvent être épandus n’importe où, ou presque). L’agriculteur est, lui, responsable de leur utilisation. Jean-Philippe Bernard explique que la norme spécifie la nature du produit et la façon de l’obtenir, sa teneur en éléments minéraux, ETM, CTO, micro-organismes, éléments inertes et impuretés. Les seuils sont plus restrictifs que le plan d’épandage, mais la norme ne porte aucune exigence sur les caractéristiques des sols épandus.
Si l’industriel ou la collectivité fait les démarches nécessaires (demande d’AMM, respect d’un cahier des charges ou d’un règlement européen), son déchet peut passer sous statut de produit, c’est-à-dire de matière fertilisante, qui pourra être mise sur le marché. Dans ce cas, c’est l’agriculteur qui va l’acheter et l’épandre qui en est responsable et qui doit se conformer aux prescriptions de l’étiquette ou de la fiche produit. Les PRO concernés sont peu nombreux, essentiellement des digestats de méthaniseurs (voir encadré), tout comme ceux qui relèvent du règlement européen 2019/1009 (divers amendements, supports de cultures…).
Les produits sous cahiers des charges ou AMM
Le cas du cahier des charges est simple puisqu’il n’en existe qu’un seul qui concerne les digestats de méthaniseur. Établi par l’arrêté du 22 octobre 2020, le cahier des charges définit les « digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agroalimentaires en tant que matières fertilisantes », pour des usages en grandes cultures et sur prairies. L’AMM est également un cas rare pour les produits résiduaires en raison de son coût (taxation de 10 000 à 25 000 € selon les produits) et des délais de délivrance de l’AMM de 12 à 15 mois, par l’Anses. L’AMM repose sur un engagement de l’État dans la qualification d’un déchet en tant que produit à caractère de matières fertilisantes et supports de culture (MFSC), qui s’appuie sur des principes fondamentaux : innocuité, utilité agronomique et constance de composition. Jean-Philippe Bernard, indique qu'« il est très difficile de garantir une longévité spatiale et temporelle pour les produits organiques ». Ainsi, l’AMM concerne en France, seulement une douzaine de digestats issus de gros méthaniseurs.
Les règles d’épandage des boues
Les doses sont calculées par rapport aux besoins d’amendement des sols et de fertilisation des cultures. Elles tiennent également compte de la quantité de matière sèche et de micropolluants apportés (apports maximaux à respecter sur 10 ans imposés par la réglementation). En général, une même parcelle peut recevoir des épandages de boues tous les deux à trois ans.