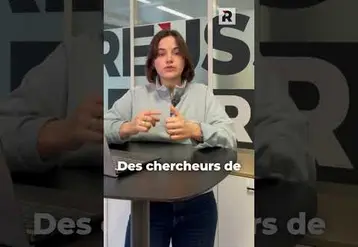Sciences - Quand la recherche participative devient un acte citoyen

Charte des sciences et recherches participatives. Ce nom bien savant est celui du document qui a été signé le 20 mars en présence de Thierry Mandon, qui n’est autre que le Secrétaire d'Etat en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une trentaine d'organismes de recherche et d'organisations de la société civile ont signé ce recueil de bonnes intentions, voire d’engagements. Il y est question de valeurs, de principes déontologiques, d’intégrité scientifique et de conditions de réussite. Autant de mots qui font plaisir à entendre par les temps qui courent.
Dans sa lettre aux entreprises, l’Inra, un des signataires de la charte, se dit « convaincu de la plus-value scientifique de cette approche, notamment pour répondre à certains enjeux de recherche liés à la complexité du monde actuel. » Christophe Roturier, Délégué aux sciences en société dans ce vénérable Institut national de la recherche agronomique, précise encore le vocable de « sciences et recherches participatives ». La définition donnée par les signataires est la suivante écrit-il : ce sont « des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent, avec des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée ».
Institut de recherche et association de consommateurs
Ca ne vous paraît pas encore clair ? Bon, alors, prenons un exemple concret, parmi les nombreux qui existent à l’Inra pour illustrer ce type de recherche.
Ce projet participatif a été présenté lors d'un colloque organisé le 27 février au Salon de l'Agriculture. Il a été mené conjointement par l'Inra et l'association de consommateurs CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie). Il s’agit d’une étude qui a mobilisé à la fois des chercheurs de l'Institut et des bénévoles de l'association. Il s’agissait d’évaluer la perception de l'étiquetage alimentaire par les consommateurs et leur demande et utilisation de l'information.
L’enquête révèle à la fois un usage limité de l’information lors des achats et un souhait quasi-unanime pour plus d’informations. Deux informations qui ne sont pas forcément contradictoires pour les rapporteurs de l’étude. Ce constat « peut révéler d’autres stratégies de la part des consommateurs : une utilisation future après achat, un usage délégué à des leaders d’opinion ou à leurs représentants », précisent-ils. Les consommateurs peuvent aussi supposer « qu’inciter les entreprises à afficher certaines informations, donc à plus de transparence, pourrait aller dans l’intérêt commun à long terme. »
Les détails de l’étude sont à lire dans l’article de l’Inra « Etiquettes : consommateurs cherchent repères ».
Pour l’institut agronomique, ce gros travail est un exemple, mais il y en a d’autres. Ce sujet autour de l’alimentation durable prouve que la recherche participative « est un moyen de progresser dans la connaissance des actions et des informations utiles aux citoyens ». CQFD