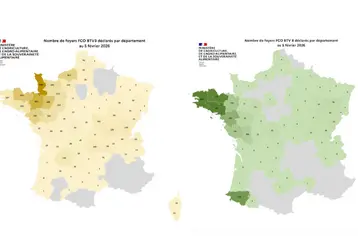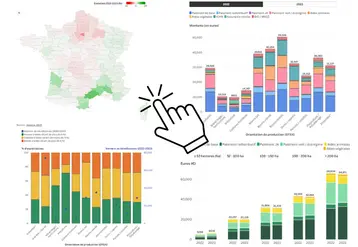« Les cours d’eau français sont en mauvais état » : quelles recommandations d’un rapport parlementaire concernent l’agriculture ?
L’état des cours d’eau français est encore loin d’atteindre l’objectif de bon état pour 2015, reporté à 2027, issu de la directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne. Pour y parvenir, un rapport d’information parlementaire dresse 19 recommandations de politiques publiques parmi lesquelles le soutien financier à l’agriculture biologique, aux Maec, ou encore le déploiement de PSE.
L’état des cours d’eau français est encore loin d’atteindre l’objectif de bon état pour 2015, reporté à 2027, issu de la directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne. Pour y parvenir, un rapport d’information parlementaire dresse 19 recommandations de politiques publiques parmi lesquelles le soutien financier à l’agriculture biologique, aux Maec, ou encore le déploiement de PSE.

« Les cours d’eau français sont en mauvaise état. » La première phrase du rapport d’information publié le 12 novembre 2025 par la mission d’information parlementaire sur l’état des cours d’eau donne le ton.
Créé par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, la mission d’information formule, après neuf mois de travaux et la rencontre d’une soixantaine d’experts, 19 recommandations dans l’espoir « d’améliorer les politiques publiques de l’eau et garantir une restauration des cours d’eau ».
Lire aussi : Qualité de l’eau : pour réduire les nitrates, faut-il manier la carotte ou le bâton ?
500 millions d'euros annuels pour restaurer les cours d'eau
Les rapporteurs Julie Ozenne (écologiste, Essonne) et Freddy Sertin (Ensemble, Calvados) identifient quatre « principales pressions » qui détériorent les cours d’eau, par ordre d’importance décroissant : l’artificialisation, les pollutions diffuses agricoles, les pollutions ponctuelles issues de l’industrie, et les prélèvements excessifs.
« La mission évalue le besoin de financement annuel pour restaurer les cours d’eau à 500 millions d’euros, ce qui reste faible par rapport aux bienfaits qu’apportent les cours d’eau », écrivent-ils. Pour financer cela, ils recommandent notamment de « rééquilibrer » les redevances des agences de l’eau « pour diminuer la part due par les usagers domestiques et rehausser la part pour pollutions diffuses et aux prélèvements ».
Relire aussi : Fact checking : le Comté est-il « un mauvais produit sur le plan écologique » comme l’affirme Pierre Rigaux ?
Seulement 43 % des cours d’eau français sont en « bon état »
En France, seuls 43 % des cours d’eau sont en « bon état » d’après les chiffres de l’OFB cités dans le rapport. Cette définition recouvrant à la fois l’aspect écologique (biodiversité, salinité, température etc.) comme l’aspect chimique (pollutions).
Ces résultats sont loin de l’objectif de 100 % des cours d’eau en bon état fixé par la directive-cadre sur l’eau de l’Union Européenne pour 2015, reporté à 2027. « L’objectif de bon état des cours d’eau ne sera pas atteint en 2027 et n’est pas près d’être atteint » peut-on lire dans le rapport.
Parmi les recommandations, les deux co-rapporteurs Julie Ozenne (EcoS, Essonne) et Freddy Sertin (EPR, Calvados) ainsi que la présidente de la mission d’Anaïs Sabatini (RN, Pyrénées-Orientales), certaines concernent directement le milieu agricole. Quelles recommandations de politique publique concernent l’agriculture dans le rapport ?
Renforcer les instruments de la politique agricole commune
La mission d’information sur les cours d’eau propose « d’encourager la transition vers l’agriculture biologique » avec la « hausse significative, de 340 millions d’euros » pour l’aide à la conversion à l’agriculture biologique dans la PAC 2023-2027. Soit une augmentation de 36 % par rapport à la programmation précédente. Dans le rapport, les députés estiment aussi que« l’agriculture biologique peut également être soutenue par des mesures foncières », avec l’intervention des Safer.
Lire aussi : Aides PAC 2023-2027 : quelles sont les productions affectées par la réforme ?
De la même façon, les rapporteurs souhaitent que le budget alloué aux mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec) soit renforcé « par une augmentation du financement de l’Union européenne au sein du Feader.» Actuellement, le dispositif de Maec bénéficie d’une enveloppe de 260 millions d’euros. Cette enveloppe est jugée insuffisante aux yeux du gouvernement : les groupes politiques avaient proposé entre 300 et 350 millions d’euros par an explique le rapport.
Ces dispositifs autour de pratiques agroécologiques, contribuent selon le rapport d’information, « à la réduction des niveaux de pollution des cours d’eau liées aux nutriments et aux produits phyto-sanitaires. » L’agriculture tient en effet un rôle important dans la pollution des cours d’eau. A l’échelle européenne, c’est 32 % des cours d’eau dans l’UE qui affectés par une pollution diffuse issu de l’agriculture d’après la Commission européenne. S’ajoutent aujourd’hui de nouveaux éléments polluants tels que les PFAS et les microplastiques.
Lire aussi : La directive nitrates encadre les rejets organiques des élevages
Développer les paiements pour services environnementaux (PSE)
Le développement des paiements pour services environnementaux (PSE) présente également des « résultats encourageants » selon le rapport. Ces paiements rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à protéger ou à restaurer des écosystèmes.
Pour les députés rapporteurs, les PSE favorisent une « dynamique d’engagement sur les territoires ». Ils doivent être soutenus mais, leur avenir « repose sur un financement renforcé et sur une plus grande implication des acteurs privés ». Le projet CAP’PSE vise d’ailleurs à structurer le développement de PSE privés avec 26 chambres d’agriculture.
Introduire la sobriété hydrique
Le rapport d’information propose également d’inscrire le principe de sobriété hydrique dans la loi « par l’instauration d’une trajectoire nationale hydrique fixant des objectifs de réduction des prélèvements et de consommations d’eau, déclinés dans les Sdage pour chaque secteur, y compris agricole ».
Relire : La consommation en eau pourrait doubler d'ici 2050 : quelle part de l’agriculture ?