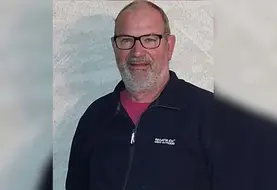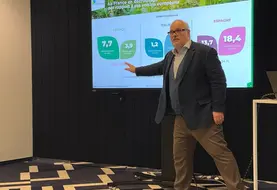Blé tendre et maladies fongiques : quels progrès dans la tolérance des variétés ?
Face aux contournements des résistances aux maladies et à l’apparition de nouveaux pathogènes, les sélectionneurs adaptent leur stratégie de création variétale pour apporter de la durabilité aux nouvelles variétés tout en préservant les rendements.

Le progrès génétique a permis d’augmenter l’offre en variétés tolérantes aux principales maladies fongiques du blé tendre. « L’agriculteur a aujourd’hui un choix bien plus important qu’il y a 20 ans », indique Romain Valade, chef du service adaptation des cultures aux agro-climats, génétique et phénotypage chez Arvalis. En 2022, plus de 70 % de la sole cultivée en blé tendre avait une note de tolérance à la septoriose supérieure à 6 contre seulement 30 % en 2005. « La protection contre la septoriose a beaucoup progressé de 2005 à 2022, gagnant 1,1 point de note de tolérance sur la période. » Les progrès sont plus anciens pour les rouilles, le piétin-verse et l’oïdium, maladies pour lesquelles les variétés présentent de bonnes notes depuis les années 1980, et qui stagnent depuis, en raison des contournements. Mais elles restent sur des niveaux élevés de tolérance. Lire aussi |
Les pathogènes contournent les gènes de résistance très répandus
Face à la pression des pathogènes, chaque année, des variétés voient leur niveau de tolérance diminuer, ce qui peut contribuer à leur retrait du Catalogue officiel des espèces et variétés végétales. « Plus un gène de résistance est utilisé sur un territoire, plus il exerce une pression de sélection importante sur les pathogènes et plus les risques de contournement sont élevés », explique Romain Valade, qui ajoute que « cela concerne surtout les gènes majeurs. » Le changement climatique complique aussi le travail des sélectionneurs. « Autrefois, les agriculteurs pouvaient espérer des gains de rendement importants grâce au progrès génétique, énonce Aurore Guilvert. Aujourd’hui, avec l’apparition de nouvelles maladies, en lien notamment avec le changement climatique, il permet plutôt de préserver le rendement. »
Le bon niveau de tolérance globale des variétés n’est maintenu qu’au prix d’un travail de sélection permanent. Depuis 2012, la rouille jaune est par exemple redevenue une cible de sélection prioritaire, avec l’arrivée des races Warrior en France. Le comportement moyen des variétés inscrites atteint un bon niveau (notes de tolérance de 6 à 7), mais « c’est une des maladies la plus difficile à travailler », indique Aurore Guilvert, chef marché céréales et protéagineux chez Limagrain Europe, car les races du pathogène sont nombreuses et évoluent très rapidement. La fusariose des épis est une autre maladie qui donne du fil à retordre aux obtenteurs. « Le catalogue des variétés résistantes s’est amélioré mais pas au même niveau que pour les autres maladies. L’une des raisons est que plusieurs champignons sont à l’origine de la maladie. Le déterminisme de la résistance à la fusariose est donc plus complexe à transférer en progrès génétique », explique Romain Valade.
Le pari des gènes mineurs de résistance
Les sélectionneurs ont beaucoup travaillé avec des gènes de résistance majeurs, au fort pourcentage d’efficacité sur le pathogène. « Ils ont été largement diffusés d’où un impact important en cas de contournement », précise Camille Wabinski-Dauchy, sélectionneur blé tendre chez Florimont Desprez. C’est l’exemple du gène majeur Stb16q de résistance à la septoriose, présent dans la variété Cellule, contourné par le pathogène en 2016. « Nous travaillons de plus en plus avec des pyramidages de gènes mineurs ou quantitatifs, c’est-à-dire des combinaisons de gènes qui ont chacun un peu moins de résistance, mais qui seront collectivement plus difficiles à contourner. » Le travail de sélection est dans ce cas plus compliqué, plus long et donc plus coûteux, mais la résistance est plus durable.
Les gènes majeurs restent une ressource précieuse, car ils ont l’avantage de procurer une résistance totale tout au long du cycle du blé (les gènes mineurs ne s’expriment parfois qu’au stade adulte du blé), mais il faut veiller à protéger leur efficacité en les diversifiant et en les associant à des gènes mineurs, indiquent les experts. Les nouvelles technologies, comme l’utilisation de la data, facilitent aujourd’hui l’identification de ces gènes mineurs.
Concilier tolérances et performances agronomiques
Le Catalogue français présente de plus en plus de variétés qui combinent la résistance à plusieurs maladies fongiques avec des résultats corrects en termes de productivité. La tolérance a plusieurs maladies est devenu un objectif important pour les obtenteurs dans un contexte climatique devenu instable et un cadre réglementaire de plus en plus contraint, explique Aurore Guilvert. Elle s’appuie en cela sur l’exemple de LG Absalon inscrite en 2016 et qui est encore en 2025 la première variété multipliée chez Limagrain. « Elle reste la référence en termes de tolérance sur l’ensemble des maladies, se comportant bien sur les rouilles et septoriose. Si côté rendement, elle n’est pas connue pour être dans le top 5, elle l’a été en 2023 et 2024, années à forte pression de septoriose. »
C’est l’exemple typique de la variété « sécuritaire », qui a un bon comportement maladie en pluriannuel et qui est recherchée aujourd’hui dans les zones intermédiaires où les potentiels de rendement sont limités, estime l’experte de chez Limagrain. Les obtenteurs recherchent de plus en plus des profils équilibrés entre qualité technologique et performances agronomiques.