Haut Conseil des biotechnologies
« L’innovation variétale est devenue un champ de mines » estime Christine Noiville
L’emprise croissante des brevets face au système ouvert du certificat d’obtention végétale entraîne un risque de concentration et de verrouillage de l’innovation dans l’amélioration variétale. Questions à Christine Noiville du Haut Conseil des biotechnologies
L’emprise croissante des brevets face au système ouvert du certificat d’obtention végétale entraîne un risque de concentration et de verrouillage de l’innovation dans l’amélioration variétale. Questions à Christine Noiville du Haut Conseil des biotechnologies
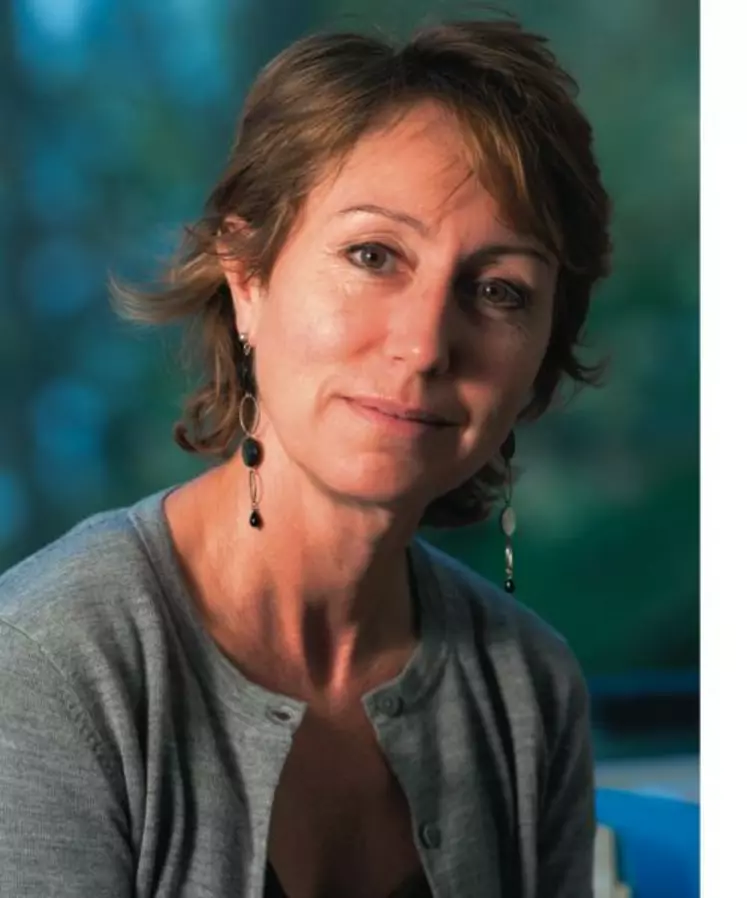
Le Haut Conseil des biotechnologies met en garde contre un risque de blocage de l’innovation variétale en raison de la montée en puissance des brevets. Pourquoi ?
À la fin des années 80, les semenciers qui développaient des plantes génétiquement modifiées (PGM) ont réclamé une protection juridique forte pour les procédés et les transgènes issus des biotechnologies modernes. Ils ont obtenu de pouvoir les protéger par brevet, car le certificat d’obtention végétal (COV), qui ne protège que des variétés, n’était pas adapté à cet égard. Mais, comme l’observent certains sélectionneurs conventionnels, la multiplication de brevets a transformé l’amélioration variétale en « champ de mines » pour ces derniers.
Comment cela ?
Malgré la récente mise en place d’une base de données publiques informant sur les variétés contenant du matériel breveté, il reste difficile pour ces sélectionneurs de savoir s’il y a des éléments brevetés dans les variétés qu’ils utilisent dans leur programme de sélection, leur nombre, ce qu’ils protègent précisément... Le risque est pour eux d’être considérés comme contrefacteurs si de tels éléments subsistent in fine dans les variétés qu’ils commercialisent. Ils peuvent alors être contraints d’abandonner leur projet ou de payer des redevances aux titulaires des brevets. Dans ce milieu largement composé de PME, habituées depuis toujours à travailler dans une logique de libre accès au matériel génétique, ce phénomène est très nouveau. C’est très lourd pour les institutions de recherche ou pour les entreprises qui n’ont pas les moyens de se doter d’une cellule de veille sur les brevets, étudiant la manière dont on peut les contourner, voire se défendre en justice si l’on est attaqué, ce qui arrive régulièrement. Cela renforce le risque de concentration de l’industrie semencière.
La coexistence entre brevet et COV est-elle possible ?
Elle l’est à deux conditions. D’une part, donner aux sélectionneurs une information fiable leur procurant une sécurité juridique. D’autre part, considérer qu’il y a deux champs bien distincts : celui de la sélection issue des biotechnologies modernes, avec tout ce qui relève de la transgénèse, et celui de la sélection conventionnelle qui reste protégeable par le COV. Le problème, c’est que le brevet étend désormais son emprise sur des champs qui se rapprochent de plus en plus de la sélection conventionnelle et devraient relever du COV, voire ne pas être protégés du tout. On voit ainsi de plus en plus de gènes ou de caractères naturels brevetés. Il s’agit de gènes présents dans la nature, non construits par des procédés techniques et qui devraient rester libres d’accès pour l’innovation.
Le brevet ne requiert-il pas une innovation ?
Pour certains, breveter des gènes naturels est en effet un détournement de l’orthodoxie du droit sur les brevets, comme l’a d’ailleurs jugé récemment la Cour suprême aux États-Unis à propos des gènes humains. Mais l’Office européen des brevets, qui s’appuie sur la directive européenne 98/44, est lui, bien plus conciliant à cet égard.
Il y a donc une jurisprudence à recadrer ?
Il y a même, plus fondamentalement, à préciser ou à modifier le texte de la directive 98/44. Il semble que les politiques prennent conscience que cette évolution très technique, qui s’est jouée de façon souterraine dans le cadre confiné des offices de brevets, rend l’avenir de la sélection végétale extrêmement compliqué. Nous sommes à la croisée des chemins. Un choix politique fort sur ce thème est indispensable et doit être opéré sans attendre.
Christine Noiville, chercheuse au CNRS et directrice du centre de recherche « Droit, sciences et techniques », est présidente du Comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies (HCB).











