Environnement
Le plan végétal est fait pour vous
2008 est l’année où le plan végétal pour l’environnement devrait trouver son rythme de croisière. Une mesure spécifique pour les exploitations de productions végétales. A découvrir absolument.
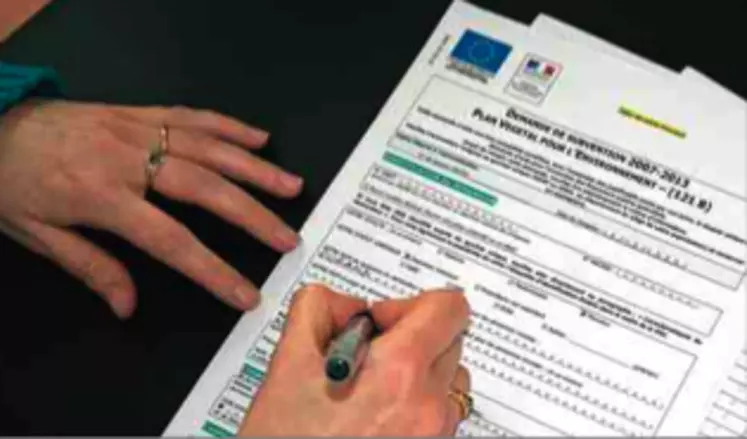
Le plan végétal pour l'environnement a pour objectif d'accompagner les agriculteurs dans la réalisation d'investissements spécifiques pour mieux répondre aux enjeux environnementaux. Le but principal est la reconquête de la qualité des eaux. Il s'agit par exemple d'équiper son pulvérisateur d'une cuve de rinçage ou d'un volucompteur programmable pour éviter les débordements de cuves, de se doter d'un système de pesée embarquée des engrais, d'acquérir un GPS et un logiciel lié à l'agriculture de précision, ou encore d'installer sur l'exploitation une station météorologique. Bref, toutes sortes d'équipements qui, tout en améliorant la qualité des interventions, peuvent aussi améliorer la sécurité de l'utilisateur voire la qualité et le confort de travail.
Chaque région définit ses critères
Le PVE se décline à l'échelle de chaque région. C'est la grande nouveauté de ce plan de développement rural 2007-2013 par rapport à la période précédente. Chaque région a donc défini ses propres priorités en se référant tout de même à un cadrage national bien strict. Ce travail est en cours de finalisation. Ainsi, le plan végétal s'articule autour de quatre axes : la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires, celles par les fertilisants, la baisse de la pression des prélèvements existants sur la ressource en eau et enfin la lutte contre l'érosion. Mais une région peut ne retenir qu'un seul axe et fixer la liste des équipements pouvant être subventionnés en conséquence. Elle peut resserrer le cadre national selon ses propres critères en ciblant par exemple des types d'exploitation ou en subventionnant davantage des équipements bien spécifiques.
Autre particularité : le PVE a fait l'objet, dans chaque région, d'une cartographie pour déterminer les zones d'action prioritaire selon les enjeux prédéfinis localement. Dans la majorité des régions, cela a consisté à superposer la carte des zones vulnérables aux nitrates, celle des zones à risque phytosanitaire fort et éventuellement une troisième issue de Natura 2000 (protection de la biodiversité), ce qui peut couvrir une grande partie du territoire régional. C'est bien l'esprit du PVE : faire en sorte que, sur des zones jugées à risque, le plus grand nombre d'agriculteurs s'équipent pour éviter les pollutions ponctuelles.
Pour compliquer le tout, le dispositif est abondé par plusieurs financeurs. L'Etat apporte 10 %, de même que l'Union européenne par du cofinancement (puisqu'il s'agit du deuxième pilier de la Pac) et le conseil régional, les conseils généraux ou les agences de l'eau peuvent apporter des subventions complémentaires. Mais chacun d'entre eux pose en général ses conditions car il a ses propres exigences sur les enjeux, les territoires à protéger ou encore les équipements à subventionner. « Comme l'enveloppe budgétaire du premier pilier de la Pac a diminué, cela nous a obligé à rechercher des financements additionnels », reconnaît-on au ministère de l'agriculture.
Un dossier très simple à réaliser
Cela engendre quelques désagréments, notamment le sentiment pour un agriculteur d'une certaine injustice lorsqu'il se trouve en limite d'une zone inéligible alors que son voisin a droit aux subventions. Donc prudence, il s'agit de bien se renseigner avant de se lancer dans la réalisation d'un dossier : @(Texte_courant_ital « selon mon projet, le PVE est-il fait pour moi ou non ? » Si oui, pas d'hésitation, le dossier est très simple à réaliser.
Une cohérence avec les MAE
Le plan végétal pour l'environnement est un outil de plus par rapport aux mesures agroenvironnementales. Mais, dans les deux cas, les dispositifs ne sont accessibles que si l'exploitation agricole se situe dans la zone à risque qui a été répertoriée. @(Texte_courant_ital « Le principe est de concentrer les moyens financiers sur un même territoire pour un objectif unique : celui de la reconquête de la qualité de l'eau, explique-t-on au ministère de l'agriculture. On joue sur la cohérence locale. Les actions de formation financée par le PDRH peuvent aller dans le même sens ». On parle désormais de MAE territorialisées (MAET). Elles sont élaborées par des organismes agricoles locaux (comme les chambres d'agriculture) afin de répondre à une problématique bien particulière, comme par exemple des risques de pollutions autour d'un point de captage ou une préoccupation autour de la biodiversité. La MAE territorialisée ne peut démarrer que si le nombre d'agriculteurs prêts à s'engager est suffisant. Ceux-ci doivent alors mettre en œuvre la mesure retenue selon l'enjeu local (par exemple réduire de 50 % les produits phyto) et bénéficient d'une compensation financière. Dans certaines régions, les agriculteurs qui s'engagent dans une MAET peuvent bénéficier d'un niveau de subvention supérieure dans le cadre d'un PVE de la part des agences de l'eau. Cohérence locale oblige !
Les grands principes du PVE
Chaque région a éléboré son plan végétal pour l’environnement, qui est lui-même zoné. Renseignez-vous auprès de votre DDA.
- L’aide de l’Etat au titre du PVE est plafonné à 20 % du montant des investissements éligibles. 10 % proviennent de l’Etat membre et 10 % correspondent au cofinancement de l’Union européenne ;
- Les collectivités territoriales et les agences de l’Eau peuvent financer à la place ou en complément de l’Etat. Le taux maximal global de l’aide est limité à 40 % ;
- Le seuil minimal d’investissement est fixé à 4 000 euros. Le plafond par dossier s’élève à 30 000 euros, avec une transparence pour les Gaec ;
- Il est interdit de démarrer les travaux tant que vous n’avez pas reçu une réponse favorable pour votre demande de subvention, au risque de l’annuler ;
- Un délai de réalisation d’un an est accordé. Des contrôles sont prévus ;
- L’auto-construction constitue un poste finançable ;
- Les Cuma ont aussi accès aux aides du PVE. Le pafond s’élève alors à 100 000 euros. En plus des listes finançables pour les exploitations individuelles, les Cuma peuvent solliciter une aide pour acheter du matériel d’implantation et d’entretien des haies ou zones enherbées, un pulvérisateur ou des équipements de gestion des eaux résiduaires (si la région les a retenus).











