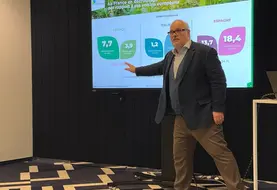Gestion de l´interculture
Détruire les cultures intermédiaires sans pénaliser la culture suivante
Gestion de l´interculture
Technique de travail du sol, espèce utilisée dans le couvert végétal, conditions climatiques, législation, culture qui suit. Nombreux sont les paramètres à prendre en compte pour une destruction convenable d´une culture intermédiaire.
Une culture intermédiaire ne doit pas être détruite trop tardivement. Il ne faut pas risquer une immobilisation de l´azote du sol par cette culture qui engendrerait des carences sur la culture suivante. Le couvert végétal consomme de l´eau, ce qui peut également occasionner un manque. S´il est détruit après montée à graines, évidemment, les relevées dans la culture provoqueront des soucis de désherbage.
Excepté dans le cas d´une protection contre des risques d´érosion, il n´est pas nécessaire de garder trop longtemps une culture intermédiaire piège à nitrates. La règle générale est de la détruire à partir du 15 novembre. A ce stade, on peut considérer que le couvert a suffisamment joué son rôle de piège à nitrates. Au-delà, la plante devient moins efficiente - surtout quand l´on arrive aux portes de l´hiver - et peut se lignifier. Résultat : si l´on tarde trop, les plantes devenues ligneuses sont difficiles à détruire et leur décomposition dans le sol est plus lente.
Par ailleurs, il semble que des plantes aient un effet dépressif sur certaines cultures sans que les causes soient clairement identifiées. « Il faudra veiller à détruire un seigle assez tôt (décembre) avant une orge de printemps. En situation de non-labour, il a été constaté des problèmes de croissance de l´orge après un seigle détruit début février », donne en guise d´exemple Jérôme Labreuche d´Arvalis Arvalis.
La moutarde a l´avantage d´être facile à détruire
La moutarde est de loin la culture intermédiaire la plus utilisée dans les campagnes françaises. « C´est une espèce très facile à détruire. C´est un point fort incontestable, explique Jérôme Labreuche. La destruction mécanique est le meilleur moyen de stopper le développement de la moutarde, mieux que le traitement chimique. C´est une particularité de la moutarde par rapport aux autres couverts végétaux. Il ajoute : L´agriculteur peut opter pour le broyage mais cela s´avère assez coûteux, de l´ordre de 38 euros par hectare (250 francs) car le travail est lent et il demande de la puissance. Il faut lui préférer le déchaumage quand c´est possible sur les sols, voire le labour en direct si la moutarde n´est pas trop développée. » A noter que la moutarde est sensible au gel, dès - 5ºC.
Dans la famille des crucifères, le radis fourrager ne présente pas du tout les mêmes caractéristiques que la moutarde blanche. Il est peu sensible au gel et les traitements avec des herbicides totaux (Gramoxone plus, glyphosate) donneront plus satisfaction que l´intervention mécanique. Le colza présente des caractéristiques voisines avec de bonnes efficacités du glyphosate à un stade jeune.
 |
| ©C. Gloria |
 |
Privilégier la solution chimique sur les graminées
La phacélie est assez sensible au gel. « Mais si elle est peu développée et pauvre en eau, elle gèlera mal », remarque Jérôme Labreuche. Les moyens mécaniques que chimiques se montreront aussi efficaces pour la destruction de cette culture.
Parmi les graminées, « le seigle est plus coriace à détruire qu´une avoine ou un blé, constate l´ingénieur d´Arvalis. Pour le seigle, la dose de désherbant à appliquer ne doit pas être trop réduite. Il faut compter au minimum 1000 grammes par hectare de glyphosate (soit 3 l/ha de spécialité à base de 360 g/l de la matière active) tandis que sur avoine ou blé, on peut se contenter de 500 à 700 grammes par hectare (1,5 à 2 l/ha). » Toutes ces doses sont à adapter aux conditions climatiques. La destruction mécanique peut stopper la croissance d´une graminée mais ce ne sera pas forcément suffisant en situation de non-labour. Dans ce cas, la destruction chimique sera la seule alternative. D´une façon générale, la destruction des cultures intermédiaires devra être très rigoureuse chez les agriculteurs adeptes des techniques sans labour. Le labour, lui, se montre souvent radical pour finir la destruction d´un couvert végétal.
Dans le choix de l´espèce en couvert végétal et, par la suite, dans l´efficacité de la destruction, l´agriculteur peut prendre en compte les possibilités de rattrapage dans la culture suivante. Si l´on retient le simple exemple du radis avec l´hypothèse d´une destruction partielle, il sera plus facile de rattraper le coup dans une orge avec une sulfonylurée que dans du pois sur lequel les sulfonylurées sont proscrites. Sur betteraves, on peut toujours parvenir à détruire des repousses de radis mais avec un investissement herbicide coûteux. De même, l´utilisation du trèfle incarnat en interculture ne doit pas faire oublier, qu´il est très difficile voire impossible à traiter dans des cultures comme le tournesol, le pois ou la betterave.
La question du rattrapage est à considérer pour chaque couple culture intermédiaire/culture suivante. « La nécessité d´avoir une destruction à 100 % n´est pas obligatoire s´il y a un labour derrière, fait remarquer Jérôme Labreuche. Le but à rechercher est d´arrêter le développement de l´interculture, de stopper sa croissance. En non labour, pour avoir un sol propre au moment du semis de la culture suivante, il faut être très vigilant sur le niveau de destruction des couverts, qu´elle soit mécanique, via le gel ou chimique. »
 |
 |