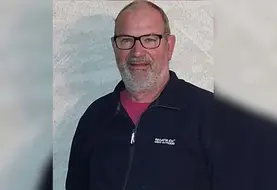Chamboule-tout dans les techniques avec le retrait du glyphosate
Se passer de glyphosate ne laissera pas le sol au repos. Les techniques de destruction mécanique semblent la seule alternative, mais à quel coût ? Les systèmes en non travail du sol strict sont remis en cause.
Se passer de glyphosate ne laissera pas le sol au repos. Les techniques de destruction mécanique semblent la seule alternative, mais à quel coût ? Les systèmes en non travail du sol strict sont remis en cause.

C’est tout un système de production que l’on remet en cause, celui qui consiste à semer sans reprise mécanique », entend-on dans le camp des producteurs en semis direct. « On ne peut pas se passer du glyphosate. En tous cas, pas durablement… » Le sujet est brûlant dans les campagnes. Un organisme de conseil qui ne souhaite pas afficher un quelconque positionnement vis-à-vis du glyphosate a étudié quelques pistes pour les destructions de couverts ainsi que d'adventices en interculture en se passant de l’herbicide banni. Cette destruction nécessite d’avoir recours à du travail mécanique du sol, du déchaumage, du scalpage ou du roulage. « Dans les systèmes d’agriculture de conservation du sol, sans le glyphosate, il faudra par exemple densifier au maximum les couverts végétaux pour qu’ils jouent pleinement le rôle de contrôle du salissement, mentionne un expert de cette organisation. La destruction de ces couverts peut s’effectuer avec un rouleau hacheur. Un semis direct derrière est possible si le couvert est suffisamment propre vis-à-vis des adventices. Si ce n’est pas le cas, une reprise très superficielle du sol sera nécessaire. » Certaines successions avec interculture courte peuvent se passer du glyphosate comme un blé suivant un maïs si celui-ci est propre. Ce sera plus délicat en cas d’interculture longue, dans une succession blé - maïs.
L’efficacité de destruction mécanique dépend de la météo
« Il y aura probablement une relance du labour avec la disparition du glyphosate », selon Jérôme Labreuche, ingénieur travail du sol et interculture chez Arvalis. Si c’est un bon moyen de détruire des plantes, le labour n’est pas envisageable pour les agriculteurs qui ne veulent plus revenir à un retournement du sol. « Un travail superficiel du sol pourra suffire pour gérer des adventices en interculture, mentionne Jérôme Labreuche. Il y a de nombreux exemples de techniques efficaces. Avec un déchaumeur à dents pattes d’oie, on peut faire un scalpage du sol, ce qui signifie déraciner les plantes en veillant à ce qu’elles ne gardent pas de grosses mottes de terres sur les racines. Cette technique fonctionne bien en été, en période sèche quand la terre ne colle pas aux racines. Par rapport à l’application de glyphosate, c’est ce qui coûtera le moins cher — entre 15 et 30 euros/hectare(1) — mais l’efficacité est dépendante de conditions météorologiques séchantes. » La technique n’est donc pas envisageable en hiver avant une culture de printemps.
En ce qui concerne la destruction des vivaces, le spécialiste d’Arvalis se reporte à des expériences menées en agriculture biologique qui consistent à réaliser des déchaumages profonds pour épuiser les rhizomes de ces espèces. « Pour le chiendent, les rhizomes sont extirpés du sol et laissés en surfaces pour qu’ils se dessèchent. Pour le chardon, les plantes sont détruites au stade 'élongation' avec une stratégie d’usure sur plusieurs années. »(2)
Des couverts ingérables sans le glyphosate
Outre la gestion des adventices, le glyphosate est utilisé en non labour pour détruire les couverts d’interculture. « Sans cet herbicide, il y aura des couverts ingérables, notamment ceux comprenant des graminées, estime Jérôme Labreuche. Il faudra choisir un couvert en conséquence, facile à détruire avec des espèces gélives et sensibles au roulage sur gel (moutardes, phacélies, fenugrec…). Ces plantes seront plus faciles à détruire que des espèces qui résistent au gel comme les radis, avoine, seigle, trèfle incarnat, navette… En système de non labour, le choix du couvert sera primordial. » Les graminées sont pointées du doigt mais parmi elles, des variétés précoces pourront être adaptées à une destruction sans glyphosate, comme chez les avoines rudes. La précocité variétale sera un élément de choix important pour avoir des graminées qui atteignent rapidement le stade épiaison où la destruction est plus efficace. La date de semis jouera également sur le niveau de développement du couvert au moment de sa destruction.
Le choix des espèces du couvert a son importance. « Le sorgho est une plante très compétitive des adventices estivales avec un effet allélopathique en plus. Un couvert comportant cette espèce peut être implanté juste après la moisson d’un blé, donne comme exemple un expert d’un organisme de conseil. Très utilisée en semis direct, la féverole s’avère moins compétitive. Mais en la semant très dense, on peut limiter la concurrence des mauvaises herbes, souligne-t-il. La féverole est facile à détruire mécaniquement au printemps. Cela coûte entre 20 et 50 euros/hectare contre 30 euros/hectare pour l’association d’un glyphosate + 2,4 D en comptant le coût du passage », précise-t-il. Le retrait du glyphosate est lourd de conséquences, économiquement parlant, pour les adeptes du semis direct notamment. Des dérogations seraient envisageables.
(1) Passage en tenant compte de l’amortissement de l’équipement.(2) Voir n°318 de notre revue, novembre 2017, page 36.
Du désherbage à l’énergie
Électrique, thermique, à la vapeur… des techniques de désherbage atypiques vont être testées en situation de grandes cultures par Arvalis. « Le désherbage thermique peut être efficace à condition de l’appliquer sur des adventices très jeunes. Se pose la question du coût énergétique en gaz et fioul », remarque Ludovic Bonin. Le désherbage électrique avait été testé il y a une dizaine d’années. Le principe est d’envoyer un choc électrique qui fait exploser les cellules des tissus aériens et racinaires. Pas d’information sur l’énergie dépensée, la sécurité, ni même l’efficacité pour le moment. La vapeur d’eau pulvérisée à très haute température est une technique déjà employée dans certaines communes. À voir à l’échelle de grandes parcelles. Des équipements originaux vont être mis en démonstration avec aussi des destructions par infrarouge ou au laser.