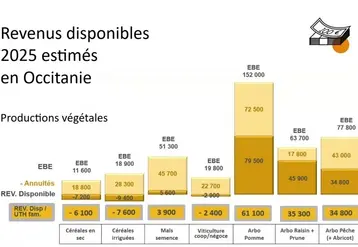Mâche : les méthodes de désherbage en question
Le désherbage est une problématique essentielle de la culture de la mâche. Les méthodes actuellement utilisées ne donnent pas pleinement satisfaction.
Le désherbage est une problématique essentielle de la culture de la mâche. Les méthodes actuellement utilisées ne donnent pas pleinement satisfaction.


Destinée aux marchés de 1re et 4e gammes, la production de mâche doit satisfaire à une exigence de zéro défaut. Plus particulièrement, une absence totale de corps étrangers est requise à la récolte : brindilles, feuilles et surtout brins d’herbe sont proscrits. Outre une perte de rendement, la présence d’herbe dans les cultures pourrait entraîner des risques sanitaires pour les consommateurs. Certains séneçons contiennent en effet des alcaloïdes, les pyrrolizidines, qui sont très toxiques. Les mourons peuvent également présenter une toxicité. La mâche étant un produit prêt à consommer, le risque d’intoxication est important si ces herbes se retrouvent dans le produit final. « Le stock semencier des herbes a pour origine d’une part l’historique de la parcelle, avec notamment les autres cultures de la rotation, et d’autre part les abords de la parcelle », indique Cyril Pogu, producteur de mâche en Loire-Atlantique et référent technique du Comité départemental de développement maraîcher (CDDM), lors des entretiens techniques du Ctifl au dernier Sival. Les haies et les jachères peuvent ainsi constituer des sources de contamination extérieure. Il faut donc être très vigilant sur la gestion des abords de parcelles. Et quand les adventices sont dans la parcelle, il faut agir vite et ne pas les laisser monter à graines, sous peine d’une multiplication incontrôlée.
L’avenir des solutions chimiques incertain
Si l’on maîtrise mieux l’enherbement aujourd’hui que par le passé, le désherbage reste la première problématique de la culture de la mâche. Juste avant la récolte, la méthode la plus pratiquée est sans doute le désherbage manuel. A ce stade, il n’est pas possible de faire autrement que de désherber à la main, avec toute la pénibilité que cela engendre pour les travailleurs. Le coût du désherbage manuel est aussi un frein à la rentabilité de l’exploitation. « Au-delà de vingt brins d’herbe au mètre de planche, il vaut mieux détruire la culture », révèle Cyril Pogu. Les solutions chimiques de désherbage en culture de mâche se limitent à deux molécules, la napropamide et le métobromuron, ce dernier étant en dérogation d’usage. L’herbicide Proman à base de métobromuron a reçu une AMM 120 jours le 3 avril 2018, valable jusqu’au 1er août 2018. « Deux substances, ce n’est pas beaucoup mais c’est mieux que rien, estime le spécialiste de la mâche. Mais l’avenir des solutions chimiques est très incertain ». La désinfection du sol à la vapeur est une autre possibilité. Mais elle a l’inconvénient de consommer beaucoup de fuel, 4 000 litres à l’hectare. La solarisation, en élevant la température du sol pendant une longue durée, permet de détruire les graines des adventices avec une efficacité variable. « En Loire-Atlantique, cette technique n’est possible que sous grands abris plastique, il ne fait pas assez chaud pour la pratiquer en plein champ, informe Cyril Pogu. C’est une technique coûteuse, qui mobilise l’abri pendant dix semaines et qui demande de lourds investissements. De plus, la solarisation peut favoriser certaines adventices comme le pourpier ».
La parcelle reste le meilleur endroit pour intervenir
Pour le référent technique du CDDM, la pratique du faux semis ou celle des couverts végétaux montrent aussi plus de désavantages que d’atouts, notamment à cause du risque d’apports de corps étrangers. En station, les trieurs optiques fonctionnent bien pour séparer la mâche des brindilles et feuilles d’arbres. Le système n’est cependant pas encore au point pour les résidus de couleur verte comme les herbes. « La parcelle reste le meilleur endroit pour intervenir, mais la durée pendant laquelle on peut agir est courte », estime Cyril Pogu. La mécanisation du désherbage serait-elle une piste d’avenir ? Actuellement, la densité de semis est généralement de 1 000 plants par m², ce qui permet d’obtenir un bon équilibre entre rendement et qualité des plantes, mais empêche le passage de machines dans la culture. La mécanisation du désherbage ne sera donc possible que par une modification en profondeur des techniques de production, notamment avec une augmentation des distances entre les rangs et une diminution des densités de semis. La robotique est une piste prometteuse, qui progresse rapidement. Un de ses enjeux cruciaux est la détection des adventices par rapport à la culture. « J’ai des doutes vis-à-vis de la vitesse d’avancée des robots, car à la récolte la fenêtre d’intervention pour le désherbage est très réduite », avance le maraîcher.
Une spécialité nantaise
La mâche est arrivée dans la région nantaise dans les années 1980, en remplacement de la carotte nantaise. Elle continue à se développer aujourd’hui. Environ 30 000 tonnes sont produites chaque année en Loire-Atlantique, soit 85 % de la production française et 50 % de la production européenne. Produite toute l’année, la mâche se cultive sous grands abris plastique (qui permettent de produire d’autres légumes), sous petits tunnels nantais (système de culture toujours courant aujourd’hui) ou en plein champ. La production est mécanisée du semis à la récolte.