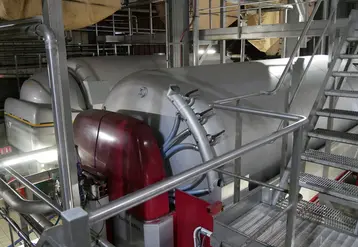Drone en viticulture : des utilisations à des niveaux de maturité distincts
Bien que la pulvérisation soit la plus prometteuse, les potentielles utilisations du drone en viticulture sont nombreuses. Voici le point sur leur état de maturité actuel.
Bien que la pulvérisation soit la plus prometteuse, les potentielles utilisations du drone en viticulture sont nombreuses. Voici le point sur leur état de maturité actuel.

Tout comme le quad, le drone se situe à la limite entre le loisir et le professionnel et séduit de ce fait de nombreux viticulteurs. Il faut dire que ses usages potentiels sont multiples. De la mise en avant du patrimoine viticole, en passant par les épandages ou encore par les cartographies, ces petits engins high-tech ont plus d’un tour dans leur sac. Et ils pourraient à l’avenir devenir incontournables dans certaines situations, lorsque l’arrêté autorisant leur emploi en pulvérisation dans les vignes en pente sera sorti.
Pour l’heure, de nombreux organismes les testent et accumulent des données. C’est par exemple le cas de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or, qui s’est penchée sur la pulvérisation des vignes en pente, avec de bons résultats. « Nous avons eu une moyenne de 111 impacts par cm2 sur les faces supérieures du feuillage et de 69 sur la zone des grappes, ce qui est plutôt bien, détaille Thomas Gouroux, conseiller viticole de la chambre bourguignonne. Cette bonne couverture des grappes n’est pas étonnante lorsque l’on regarde de près l’épandage : les gouttes rebondissent au sol et remontent dans les grappes. » Seul bémol : la face inférieure des feuilles, qui ne compte que 57 impacts par cm2. « Mais on veut au minimum 50 impacts, donc ce n’est pas si mal », nuance le conseiller.
Une protection comparable à celle d'un pulvé terrestre
En Gironde, Adel Bakache, conseiller en agroéquipement à la chambre d’agriculture, a lui aussi mené des essais de pulvérisation et confirme la bonne efficacité des drones. « C’est très prometteur, se réjouit-il. Sur vigne vigoureuse, avec un feuillage établi, et sans réaliser de réglages, nous avons obtenu des résultats vraiment bluffants. Le drone brasse bien le feuillage, et contrairement aux résultats obtenus dans le cadre du projet PulveDrone il y a quelques années (voir plus bas), je n’ai pas observé de gradient de dépôts haut-bas ni de difficultés à atteindre la zone des grappes ou les faces inférieures. Le résultat a été comparable à celui de certains pulvérisateurs terrestres. »
La détection des maladies n’est pas au point
De son côté, l’ATV 49 expérimente les drones pour reconnaître les symptômes de flavescence dorée, une fonctionnalité qui n’est pas encore au point. L’objectif serait non pas de reconnaître précisément la maladie, mais de déterminer les zones à risque, afin d’orienter prioritairement les prospections sur ces secteurs, seul 3 % du vignoble étant prospecté annuellement. « Les résultats sont pour l’instant mitigés, reconnaît Antoine Cuegniet, conseiller viticole de l’association. C’est un outil très prometteur, mais il y a des limites à dépasser. Cela demande un sacré traitement des images au bureau. Pour le moment, nous ne sommes pas arrivés à la solution parfaite. »
Et il en va de même pour toutes les maladies. « La détection des maladies par drone est un fantasme, prévient Adel Bakache. Déjà, sur un tracteur, on a du mal à les repérer et on ne les aperçoit qu’à partir du moment où elles sont visibles et qu’il est déjà trop tard. Alors au drone, c’est peine perdue. De plus, l’hyperspectral est très sensible à la luminosité. »
Le semis des couverts au drone n’est pas optimal
En Gironde et Lot-et-Garonne, la Fédération des Cuma s’est pour sa part intéressée au semis de couverts végétaux, mais là aussi, sans le succès escompté. « Les drones sèment en plein des bandes de 6 m, ce qui n’est pas recherché en viticulture, témoigne Thibault Chakrida, conseiller en agroéquipement de la fédération. Nous avons fait des tests en rajoutant des descentes pour semer en localisé, mais cela alourdissait trop le drone. » Par ailleurs, une fois dans le bol du drone, les graines subissent une ségrégation, les grosses remontant vers le haut. Il n’est donc possible de semer que des graines de taille homogène.
Adel Bakache abonde dans son sens, pour une raison complémentaire. Selon lui, en semis, le point clé est le rappui de la graine après le passage du drone. « Sans cela, rien ne se passe », insiste-t-il. Ce qui ôte tout intérêt pour cet outil. La fertilisation au sol n’est guère plus adaptée. « Les engrais organiques s’apportent à environ 1 tonne par hectare, ce qui est beaucoup trop lourd pour les drones, résume Augustin Navarranne, directeur associé d’Agribio Drone, entreprise de prestation de services et de commercialisation de drones. Il faudrait faire de nombreux pleins, ce qui prend beaucoup de temps. Un apport en tracteur est bien plus adapté. »
L’emploi du drone en cartographie multispectrale (indice foliaire NDVI) est une autre application possible mais plutôt réservée aux gros domaines ou aux conseillers viticoles. Ils s’en servent par exemple pour comparer l’évolution de la surface foliaire de plusieurs modalités d’essai au sein d’une même parcelle. D'autres usages pourraient se développer, à l'image de l'éffarouchement de gibier (drone Belver), ou encore du lâcher de guêpes parasitoïdes, à l’instar de ce qui est réalisé sur le maïs ou en Afrique du Sud sur la cochenille. Gageons que l’emploi de drone dans les vignes n’en est qu’à ses prémices.
Les enseignements de PulveDrone
Conduit de 2019 à 2021, le projet PulveDrone, piloté par l’IFV, avait pour but d’engranger des références techniques sur la pulvérisation par drone. Si ces résultats sont intéressants, ils sont pour partie obsolètes à ce jour, car en quatre ans, les drones ont connu des évolutions technologiques importantes. Pour autant, certains aspects ne changent pas. L’IFV a en effet constaté que le drone « permet un très bon respect des consignes de pulvérisations : débit, vitesse, trajectoire (positionnement et vitesse). L’électronique embarquée sur les drones permet aussi l’enregistrement du plan de vol et des débits ».
Au niveau de la qualité de traitement, l’institut avait observé de bons résultats (« pulvérisation satisfaisante ») avant floraison et sur gobelet. En revanche, la qualité semblait moindre aux stades végétatifs plus avancés, avec des résultats « généralement inférieurs aux références terrestres ». En outre, l’IFV signalait avoir observé « un gradient de dépôts haut-bas et des difficultés à atteindre le cœur de la végétation et les zones de grappes, et des dépôts plus faibles sur la face inférieure des feuilles ». Par ailleurs, en bio, l’IFV rapportait des « résultats contrastés suivant les contextes de pression maladie » et préconisait des traitements complémentaires au sol en encadrement de la floraison.
Une réglementation en évolution
Jusqu’à cette année, les traitements par drone étaient totalement interdits. Mais la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 les a autorisés dans certaines situations : « pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens » et « sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol », avec des produits de « biocontrôle, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque ». Le texte précise par ailleurs que des dérogations peuvent être accordées dans le cadre d’essais encadrés par un organisme de recherche, sur une durée maximale de trois ans.
Une première autorisation a été émise cette année pour les vignes varoises, suite aux inondations. Mais du fait de ses conditions d’application très restrictives, aucun viticulteur n’a pu y avoir recours. Les autres utilisations (situation de pente) ne sont pas encore autorisées, tant que le décret d’application n’est pas sorti.
Découvrez les autres articles de notre dossier "Le drone prend son envol" ici :
Drone en viticulture : des utilisations à des niveaux de maturité distincts
Quelle stratégie d’investissement pour un drone viticole ?
Les clés pour bien choisir son drone viticole
« Le drone peut détecter les fils cassés et les fuites de goutte-à-goutte dans mes vignes »
« Pulvériser des thés de compost au drone sur les couverts végétaux dans les vignes fonctionne »