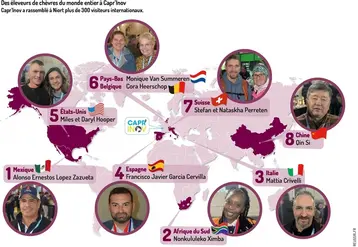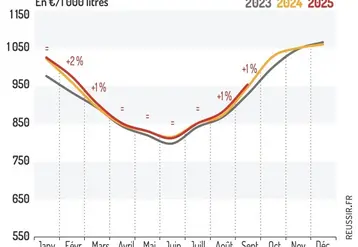« Les chèvres peuvent valoriser les sous-produits de l’industrie agroalimentaire »
Lors de la conférence européenne caprine de l’IGA (International Goat Association) qui s’est tenu à Tenerife en Espagne, Anna Nudda, de l’université de Sassari en Italie, a rappelé l’intérêt des chèvres pour valoriser les sous-produits de l’agro-industrie.
Lors de la conférence européenne caprine de l’IGA (International Goat Association) qui s’est tenu à Tenerife en Espagne, Anna Nudda, de l’université de Sassari en Italie, a rappelé l’intérêt des chèvres pour valoriser les sous-produits de l’agro-industrie.

Pourquoi utiliser des sous-produits agro-industriels en nutrition animale ?

Anna Nudda - Les sous-produits agro-industriels représentent une part importante des déchets de la chaîne alimentaire et leur gestion appropriée est essentielle pour réduire les impacts environnementaux. En recyclant la biomasse non comestible pour l’homme dans l’alimentation animale, nous pouvons réduire les coûts d’élimination, diminuer la pollution et favoriser les pratiques d’économie circulaire. En particulier, nombre de ces sous-produits sont riches en polyphénols, qui présentent des avantages pour la santé animale et améliorent le profil nutritionnel des produits d’origine animale.
Lire aussi : Les ruminants valorisent les coproduits agroalimentaires
Quels sous-produits se sont révélés les plus prometteurs pour l’alimentation des chèvres ?
A. N. - Nous avons étudié plusieurs sous-produits non conventionnels, notamment le marc de raisin, les noyaux d’olive, le marc de tomate, la pulpe d’agrumes, les coques de café, les déchets d’artichaut et les résidus de grenade. Les sous-produits du raisin, de l’olive et de la grenade, en particulier, sont riches en polyphénols bioactifs qui influencent positivement la qualité nutritionnelle des graisses et réduisent le statut oxydatif.
Pourquoi les chèvres sont-elles particulièrement adaptées aux régimes riches en polyphénols ?
A. N. - Les chèvres sont anatomiquement et physiologiquement adaptées à la consommation de plantes riches en tanins. Les tanins font partie de la famille des polyphénols et sont présents dans les sous-produits et en grande quantité dans les arbustes et les plantes ligneuses. Comparées aux ovins et aux bovins, les chèvres possèdent des glandes salivaires plus grandes contenant des protéines liant les tanins, un système de détoxification hépatique plus efficace et un microbiote ruminal plus tolérant aux tanins. Ces adaptations permettent aux chèvres de mieux bénéficier des sous-produits riches en polyphénols sans effets néfastes sur la digestibilité ou l’ingestion.
« Les chèvres ont des glandes salivaires, un microbiote et des reins plus à même de valoriser les sous-produits riches en tannins »
Comment ces sous-produits influencent-ils la production et la composition du lait ?
A. N. - La production laitière est souvent restée stable mais quelques légères diminutions ont été notées avec l’inclusion de marc de raisin ou d’ensilage d’artichaut. Des effets positifs ont été observés sur la qualité des matières grasses du lait avec la réduction des acides gras saturés et l’augmentation de l’acide linolénique conjugué, de l’acide vaccénique et des oméga-3. Certains sous-produits ont également amélioré le statut antioxydant des animaux et du lait. Cependant, les réponses varient selon le type, la dose et le stade physiologique de l’animal.
Y a-t-il un impact sur les émissions de méthane ?
A. N. - Oui, certains sous-produits, notamment ceux riches en tanins condensés, peuvent moduler la fermentation ruminale et réduire la production de méthane en inhibant les bactéries méthanogènes. Cela constitue une stratégie précieuse pour réduire l’empreinte carbone de l’élevage de petits ruminants.
Quels sont les défis liés à l’utilisation de ces sous-produits ?
A. N. - Les teneurs en nutriments peuvent varier et les sous-produits ont souvent une disponibilité saisonnière. Leur forte teneur en eau peut entraîner des coûts de transport élevés. De plus, il est nécessaire d’établir des méthodes de conservation optimales pour garantir des bénéfices constants et éviter les impacts négatifs sur l’ingestion ou les performances. À l’avenir, nous axerons nos recherches sur les techniques de conservation, les niveaux d’inclusion optimaux et le transfert des polyphénols ou de leurs métabolites dans le lait et les produits laitiers.
Curriculum
Professeur de sciences animales à l’Université de Sassari en Sardaigne (Italie), Anna Nudda est éditrice de la revue Italian Journal of Animal Science. Elle est autrice d’une centaine de publications scientifiques et techniques portant notamment sur l’alimentation des petits ruminants.