Euro-Méditerranée-Prospective
Vers une intégration régionale de l’agriculture en Méditerranée
Euro-Méditerranée-Prospective
L’agriculture pèse lourd dans les économies méditerranéennes et les produits agricoles et alimentaires ont une place importante dans les échanges commerciaux. La région doit se préparer à relever un défi alimentaire majeur.
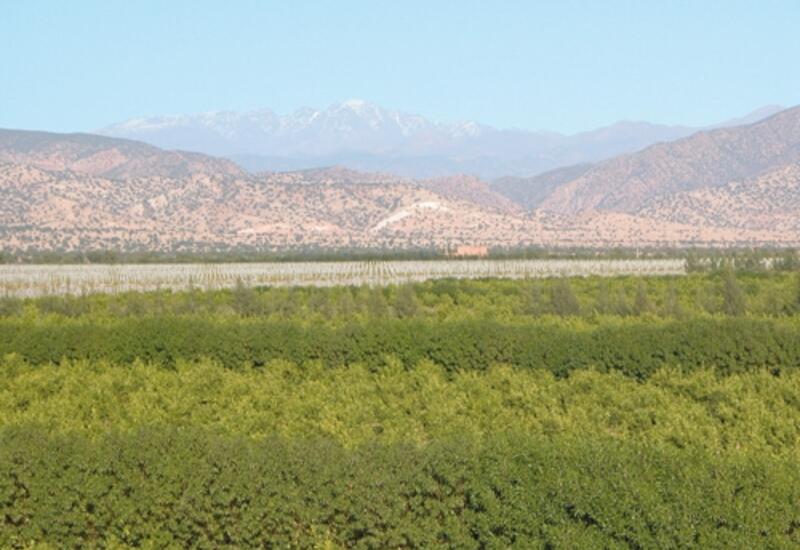




La question agricole en Méditerranée gagne en acuité dans un contexte économique et politique difficile : hausse des prix alimentaires, financiarisation des marchés des matières premières agricoles, réforme de la Pac, blocage agricole du cycle de Doha à l’OMC, révoltes arabes, crises sanitaires... (.) Mais au-delà des aspects conjoncturels, l’agriculture reste un des piliers fondamentaux des économies de la région. Malgré de nombreux atouts dont jouit la Méditerranée – notamment l’originalité du climat, la richesse de la biodiversité, un modèle alimentaire exemplaire et des réserves pétrolières au Sud – son agriculture connaît des fragilités structurelles qui creusent l’écart de développement entre les deux rives. (.)
Malgré le déclin de sa contribution dans le PIB et l’emploi, l’agriculture pèse toujours lourd dans les économies méditerranéennes : de 9 % à 13,7 % du PIB sur la rive Sud et jusqu’à 21 % en Albanie, 20 % en Syrie et 17,2 % au Maroc. Il s’agit de l’activité économique dominante chez les ruraux, qui représentent 35 % à 40 % de la population totale, soit environ 173 millions de personnes. Le secteur emploie 20 % de la population active des Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) contre 5 % au Nord, plus de la moitié de ces actifs étant des femmes (66,3 % en Turquie, 56 % en Syrie et 50 % au Maroc). Au total, la région compte 40 millions d’actifs agricoles et environ 17 millions d’exploitations, dont 70 % sur la rive Sud.
La situation agro-commerciale révèle une place importante des produits agricoles et alimentaires dans les échanges. L’agriculture (y compris les produits alimentaires) compte pour 5 % à 10 % du panier des importations des pays du Nord, alors qu’elle représente entre 10 % et 25 % du total des approvisionnements des PSEM (sauf pour Israël et la Turquie). La part agricole et alimentaire dans les exportations est tout aussi importante pour de nombreux pays (.).
Le caractère stratégique de l’agriculture en Méditerranée s’apprécie mieux au regard des besoins de la région et des efforts des gouvernements, notamment au Sud, pour la sécurité alimentaire quantitative à travers des politiques de régulation. Malgré le retrait progressif de l’Etat par l’application des plans d’ajustement structurel des années 1980, des mesures d’administration de prix ont été maintenues dans de nombreux pays du Sud. Les interventions publiques dans les pays arabes ayant connu ou non des manifestations, suite aux flambées des prix alimentaires en 2007-2008, témoignent de l’importance du secteur pour les gouvernements souhaitant maintenir la stabilité sociale dans la région. (.)
Les fruits et légumes, seule filière en excédent commercial
Des situations contrastées sont observées en Méditerranée en fonction des sous-régions. Au Nord, la construction de l’Europe, les orientations de la Pac et la modernisation de l’agriculture ont permis la diversification de l’économie rurale, l’augmentation de la productivité agricole et l’instauration d’une sécurité quantitative et qualitative. Les économies des PSEM, depuis les années 1970, se sont tournées principalement vers l’exportation de pétrole et les services, au détriment de l’agriculture. Cette fragilité structurelle des économies du Sud et de l’Est, se combinant à une utilisation controversée des richesses nationales, s’est traduite par une progression de la faim et de la malnutrition suite à la flambée des prix alimentaires de 2007-2008.
A l’origine de cette situation, on trouve un déficit commercial qui se creuse dans les PSEM depuis près d’un demi-siècle, à l’exception de la Turquie (seul pays excédentaire de la sous-région) et des f&l (seule filière en excédent commercial). 50 % de la nourriture de ces pays est importée et ces importations agricoles représentent une fraction importante des flux commerciaux totaux (9 % contre 6 % en moyenne mondiale), avec une très nette progression pour la part des céréales (12 % des importations mondiales). L’Afrique du Nord pèse à elle seule pour 6 % de la consommation mondiale de blé (18 % du total mondial des importations) avec en tête l’Algérie et l’Egypte. (.) Cette dépendance croissante dans les approvisionnements alimentaires s’explique, entre autres, par une productivité agricole insuffisante pour répondre à l’explosion de la demande engendrée par une croissance démographique soutenue sur la rive Sud. Entre 1970 et 2010, la population au Sud est passée de 82 à 214 millions d’habitants et une hausse de 17 % pour l’ensemble de la Méditerranée est attendue à l’horizon 2030 (essentiellement imputable aux PSEM). (.)
Outre la pression de la demande, la dépendance de la Méditerranée méridionale vis-à-vis des marchés extérieurs s’explique historiquement par les orientations politiques et macroéconomiques des gouvernements. Favorisant les importations au détriment des investissements dans les agricultures nationales, ces politiques ont dégradé la compétitivité de nombreuses filières (à l’exception des f&l), qui souffrent aujourd’hui d’une sous-productivité contrastant avec le Nord. A ce sous-investissement s’ajoutent des contraintes structurelles liées aux ressources en terre et en eau et aux conditions climatiques qui handicapent fortement la production agricole. La croissance démographique et la forte urbanisation réduisent la disponibilité de la terre par actif agricole. Le morcellement des exploitations et les difficultés d’accès au foncier rendent plus complexe la modernisation de l’agriculture. Par ailleurs, la Méditerranée est aujourd’hui considérée comme une des zones les plus vulnérables au réchauffement climatique, totalisant 60 % des populations de la planète “pauvres en eau” (moins de 1 000 m3/habitant/an) (.). La région a déjà atteint la limite d’utilisation de ses ressources disponibles en terre, ce qui explique que des pays largement déficitaires comme l’Egypte ou la Libye, à l’instar de leurs voisins du Golfe, cherchent à investir dans des terres arables en Afrique pour assurer leurs besoins alimentaires.
Des divergences sont également observées entre pays en termes de libéralisation agricole, de développement rural et d’organisation des filières. Si le processus d’intégration progressive du bassin avait pris naissance en 1995 avec la Déclaration de Barcelone, l’agriculture et les questions sociales et écologiques relatives au développement rural sont restées périphériques dans les négociations sur la création d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne (ZLEEM). L’espace euro-méditerranéen s’est depuis fracturé, malgré les relations privilégiées établies entre l’UE et les pays partenaires méditerranéens et le lancement du projet d’Union pour la Méditerranée (UpM). Cette fracture se traduit tout d’abord par la structure très asymétrique des échanges entre l’UE et les pays méditerranéens, sachant que les marchés de ces derniers représentent en moyenne 13,6 % des exportations agricoles et alimentaires de l’UE en valeur mais ne dépassent pas 8,5 % de ses importations. Seuls la Turquie et le Maroc parviennent à conclure leurs échanges avec l’UE avec un solde positif.
A l’heure où les pays méditerranéens entrés dans l’UE ou candidats se sont rapprochés de leurs voisins européens pour mettre à niveau leurs agricultures, les PSEM connaissent encore une intégration régionale insuffisante de leurs productions. A défaut d’accompagner le processus de libéralisation de manière adaptée, les choix politiques dans ces pays ont induit un “biais urbain” se traduisant par un développement inégal des territoires et un enclavement de certaines zones rurales, qui se sont répercutés sur l’organisation des filières agricoles. Seule une minorité de grandes exploitations tournées vers l’export est capable de se positionner sur les marchés internationaux, alors que l’agriculture traditionnelle familiale, dominante dans les PSEM, peine à rivaliser avec un système agroalimentaire mondialisé qui approvisionne les marchés nationaux. (.)
Opter pour une “Méditerranéisation” de la Pac
La période est cruciale pour de nouvelles orientations en faveur de l’agriculture méditerranéenne : la future Pac européenne se prépare et les PSEM connaissent des transformations profondes qui auront un impact fort sur leur économie rurale. Les analyses fondées sur la doctrine libre-échangiste, qui voient dans la seule ouverture commerciale de l’espace euro-méditerranéen une stratégie permettant le développement économique attendu dans les PSEM et la stimulation de la croissance au Nord, sont de plus en plus contestées. En 2011, les négociations sur la libéralisation des produits agricoles et agroalimentaires du Sud se heurtent à des arguments sanitaires et concurrentiels et le démantèlement des systèmes de protection à effet distorsif est loin d’être atteint. (.)
Les enjeux de la sécurité alimentaire en Méditerranée imposent une logique de coopération qui s’affranchirait de la seule dynamique commerciale pour répondre aux défis alimentaire, rural, territorial, social et environnemental. En optant pour une “Méditerranéisation” de la Pac, la région pourrait emprunter à cette dernière ce qu’elle avait favorisé au Nord en termes de sécurité alimentaire, en stimulant les changements structurels dans les agricultures des PSEM (politique foncière, renforcement des structures en amont et en aval) et en améliorant les facteurs de productivité (progrès technique, gestion des sols et de l’eau).
Un tel scénario supposerait la relance des politiques agricoles et alimentaires nationales et la création d’un cadre institutionnel de coopération pour la mise en œuvre de partenariats et la mutualisation des moyens (économiques, scientifiques et techniques). Raisonner en termes de sécurité quantitative au niveau régional se traduirait par la promotion des ressources alimentaires locales mais aussi par la répartition de la chaîne de valeur entre les deux rives. Profitant de la complémentarité des productions (céréales au Nord, f&l au Sud), la mise en place d’un système régional de stocks stratégiques est une option qui s’offre comme levier d’action, à condition de faire émerger un consensus politique sur cet outil et sa gouvernance.
Mais le défi alimentaire en Méditerranée dépasse les seuls aspects quantitatifs. Entre l’abandon de la diète méditerranéenne, au profit d’une nourriture importée, et la promotion d’un régime traditionnel favorisant le développement des territoires et des filières locales, ce sont les choix politiques qui façonneront le futur alimentaire des PSEM. La mise à niveau de la sécurité sanitaire des aliments sera également un facteur déterminant dans la cartographie des échanges commerciaux. Face à des exigences communautaires fortes, les PSEM pourraient se tourner vers les puissances asiatiques, les pays du Golfe ou encore le Brésil, où les normes sont relativement moins contraignantes. Le choix de s’aligner sur les normes européennes et l’émergence d’une demande alimentaire centrée sur la qualité et la durabilité imposeraient des formes d’organisation susceptibles de structurer les filières ou, à défaut, d’exclure les petites agricultures. (.)
Pour l’Europe, des choix s’imposent également entre la poursuite du dialogue agricole bilatéral, ouvert en 2006, et une coopération multilatérale en vue d’instaurer une ZLEEM. Plutôt que de se focaliser sur le commerce, cette coopération pourrait s’établir à travers des priorités d’action axées sur le développement durable, notamment dans le cadre de l’UpM. Même si, à court terme, la détérioration des équilibres budgétaires européens pèsera sur l’aide financière envers la Méditerranée, les moyens ne manquent pas pour établir une politique ambitieuse de coopération. Une volonté politique est indispensable, de part et d’autre, pour une action concertée vers la pacification et la démocratisation, conditions nécessaires pour le co-développement de la région.
Ce texte est un extrait de l’article “L’agriculture : une voie vers l’intégration régionale en Méditerranée ?” (http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no34-septembre-2011-L) rédigé par Hiba El Dahr, chargée de mission Agriculture, développement et échanges internationaux au Centre d’études et de prospective, ministère de l’Agriculture.
Titre, chapo, intertitres et photos sont de la rédaction.
Titre, chapo, intertitres et photos sont de la rédaction.










