Programme européen Isafruit
Un bilan positif sur le long terme
Le programme de recherche européen qui a mobilisé quarante instituts publics ou privés durant quatre ans vient de se terminer. Tour d’horizon des travaux les plus prometteurs.




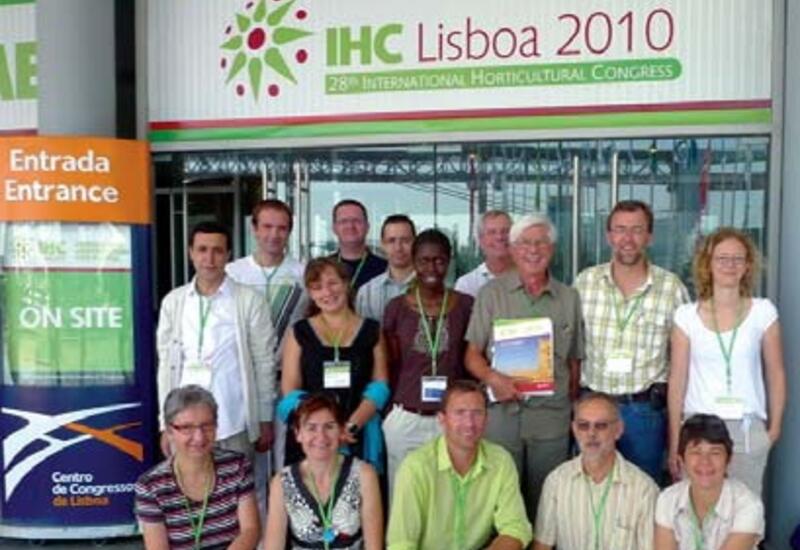
Comment consommer davantage de fruits et légumes ?”, le thème central du programme européen Isafruit – coordonné par une équipe scientifique danoise qui a débuté en 2006 – vient de s’achever. En août 2010, ce programme a donné lieu à Lisbonne à un compte rendu final d’une soixantaine d’interventions sans compter la centaine de posters affichés au Centre des Congrès de la capitale portugaise. Plus de 200 chercheurs de quarante instituts européens publics et privés dont en France l’INRA, le CTIFL, le Cemagref, le Grab et des pépiniéristes regroupés au sein de Novadi ont été impliqués dans ce projet. Il aura coûté 21 millions d’euros.
Pour la première fois sans doute dans l’histoire européenne, des généticiens, des agronomes, des qualiticiens, des cancérologues, des sociologues et des économistes ont travaillé de concert durant quatre ans. Présenté déjà en 2003 à Bruxelles, le projet essentiellement tourné vers la qualité intéresse la Commission européenne. Mais cette dernière demande à revoir la copie pour y intégrer le volet consommateur. Finalement, lors du 6e programme-cadre européen, Isafruit sera plébiscité face à six autres projets concurrents.
Que retenir de ce vaste programme initié plusieurs années auparavant grâce à un groupe informel de scientifiques appelé Eufrin (European Fruit Research Institute Network) ?
« Isafruit est un projet de filière, analyse Yves Lespinasse, biogénéticien à l’INRA d’Angers, spécialiste de la pomme et responsable de la partie génétique et qualité des fruits, l’un des sept piliers du projet. Contrairement aux précédents travaux de recherche européens, Isafruit n’est pas sectoriel. Il a permis de décloisonner les divers secteurs, de se faire rencontrer l’économiste et le généticien. Et il impulse une dynamique qui a démarré dans les années 90 et qui, j’espère, devrait se poursuivre. Le programme européen FruitBreedomics (cf. fld hebdo du 31 août 2010) qui mobilise vingt-cinq partenaires pour les quatre ans à venir et dont l’objet est d’optimiser le travail du sélectionneur résulte en partie des travaux d’Isafruit. »
Des innovations techniques
D’emblée, quand vous lui posez la question de savoir quel est le programme qui vous a le plus impressionné, Yves Lespinasse parle du pulvérisateur prototype Casa (Crop adapted spray application). Muni de divers capteurs, il permet de réduire jusqu’à deux fois la dose de pesticides sans diminuer l’efficacité du traitement. Des démonstrations ont été effectuées dans plusieurs régions d’Europe dont une en France sur le centre CTIFL de Lanxade en Dordogne. Catherine Lagrue, directrice scientifique fruits et légumes au CTIFL et qui représentait la France au sein d’Isafruit, a elle aussi été séduite par cet appareil futuriste : « Il ne peut pas être utilisé en tant que tel aujourd’hui mais il donne des perspectives intéressantes pour les prochaines années. » D’autres projets ont retenu l’attention. Concernant les techniques culturales proprement dites, de nouveaux produits d’éclaircissage ont été proposés ainsi que des systèmes physiques comme l’ombrage qui ont été testés pour limiter l’emploi d’éclaircisseurs chimiques. Si une soixantaine d’interventions ont concerné l’amélioration de la production, une quarantaine de travaux ont été spécifiquement dédiés à la qualité et à la post-récolte.
Plusieurs exposés ont décrit des méthodes non destructives d’évaluation de la qualité en post-récolte. Nous pouvons citer les travaux italiens sur le matériel portatif DA-Meter qui mesure la régression de la chlorophylle dans un fruit en le reliant à un indice de maturité. Selon Sébastien Lurol du CTIFL qui le teste, cet outil serait bien adapté aux abricots, pommes et pêches très colorés pour lesquels la notation visuelle à l’aide d’un code couleur est difficile.
Le programme informatique Peaple, destiné à prévoir une tendance de l’évolution de la qualité des pommes et des pêches après récolte, est aussi novateur puisqu’aucun outil de ce genre n’existait auparavant.
De nouveaux produits
Chapitre peut être le moins développé, seulement une dizaine de travaux présentés, la recherche de nouveaux produits a donné lieu à quelques idées innovantes comme le cassis ou la cerise séchés par déshydratation osmotique. Cette technique consiste à immerger des produits végétaux, parés et découpés, dans des solutions concentrées contenant un ou divers solutés (sel, sucre). Cela conduit à une déshydratation rapide du produit, ainsi qu’à son imprégnation par les substances contenues dans la solution. Ils sont ensuite soit séchés par convection durant 8 heures à 60 °C, soit lyophilisés (congélation à moins 30 °C durant 24 heures puis séchés à 50 °C durant 2 heures). Des études qualitatives ont montré que certaines substances comme les polyphénols ou vitamine C du cassis étaient stables après la transformation par lyophilisation. Ceux qui sont issus du séchage convectif contiennent deux à trois fois moins de vitamine C que les produits lyophilisés. Ces derniers pourraient trouver un débouché dans le snacking. Ont été aussi testés des quartiers de pommes en frais contenant un probiotique, du calcium ou d’autres additifs. Des études ultérieures détermineront l’effet de ces bactéries sur la teneur en polyphénols et composés volatils.
Le développement de ces nouveaux produits sur le marché dépend évidemment des industriels. Il n’est pas sûr que le consommateur les retrouve dans les rayons. Des tests effectués dans le cadre d’Isafruit montrent que c’est encore la salade de fruits qui remporte les suffrages. Toutefois, l’innovation est perçue différemment selon les pays. Le Polonais serait plus réceptif et le Danois plus conservateur. Selon une équipe néerlandaise, la clé de la réussite réside dans la réalisation d’un plan commun stratégique tout au long de la filière, du producteur au consommateur. Les “variétés club” sont ainsi plébiscitées. C’est en tout cas les conclusions d’une étude effectuée sur le lancement de variétés de pommes comme Junami et Rubens.
Une trentaine de publications avait pour objectif de traiter de l’influence des fruits sur la santé. Aucune information nouvelle dans le domaine n’a été publiée mais plutôt une confirmation des connaissances déjà acquises. Les pommes par exemple ont bien un réel effet sur l’obésité. Pour le montrer, des chercheurs danois ont effectué leur étude sur des individus de poids normaux contrairement aux expérimentations habituelles où ce sont des personnes en surpoids qui sont testées. L’impact des pommes sur les maladies cardiovasculaires a elle aussi été confirmé par les Danois avec des précisions intéressantes. La pomme entière, non pelée, a plus d’effet que le jus de fruit trouble qui lui-même a un avantage sur le jus de fruit clair. Autre résultat : l’impact allergène des pommes. Près de 2 à 4 % de personnes sont allergiques aux pommes. Parmi les 75 variétés étudiées par une équipe néerlandaise, trois cultivars, Elise, Santana – appelée encore Modi – et Pink Lady, ont donné des résultats négatifs aux tests effectués sur trente-trois hollandais contrairement à Golden Delicious déclarée parmi les plus allergènes. Ces expérimentations ont été complétées par une recherche génétique effectuée sur la pomme par des généticiens néerlandais, à savoir quels étaient les gènes de la pomme impliqués dans les allergies.
La génétique au menu
Les travaux génétiques au sens strict du terme ont d’ailleurs donné lieu à près d’une quinzaine de publications. Les équipes françaises de l’INRA de Montpellier, d’Avignon, de Bordeaux et d’Angers-Nantes ont planché sur l’impact du génome sur la qualité des fruits. Des sujets très diversifiés ont été abordés, de la régulation de la production par la taille, de la recherche de gènes de tolérance aux maladies et ravageurs en passant par la découverte des composés inhérents à la qualité gustative et nutritive. Ces recherches vont permettre aux obtenteurs de créer des variétés adaptées. Par exemple, les centres de Bordeaux et d’Avignon, en lien avec d’autres unités de recherche d’Italie et d’Espagne, ont déterminé les critères relatifs aux changements climatiques pour la pêche, l’abricot et la cerise afin que les obtenteurs puissent les prendre en compte dans leur programme de sélection. Autre exemple, les équipes de Montfavet ont coordonné des travaux sur l’héritabilité des critères liés à la production de composés phénoliques pour la pêche et l’abricot. Une équipe allemande a identifié les gènes intervenants dans l’élaboration des arômes des fruits. Dernier exemple : désormais, grâce aux travaux de l’équipe de Charles-Eric Durel et François Laurens d’Angers, il est possible de piloter la résistance aux maladies comme la tavelure tout en sélectionnant des fruits de qualité grâce à la sélection assistée par marqueurs. Cette technique, largement utilisée pour les potagères pour son efficacité et sa faculté à réduire le temps de sélection, est employée pour repérer des caractères agronomiques intéressants grâce à des gènes identifiés au préalable. Tous ces travaux devraient révolutionner la sélection des fruits. Selon Yves Lespinasse : « La connaissance de l’hérédité des principaux caractères liés à la qualité du fruit, qui a été traitée grâce à Isafruit et le séquençage du génome publié cette année (1), vont permettre de démarrer de nombreux programmes d’amélioration génétique sur la qualité des fruits. »
Pour guider leur choix et adapter leur recherche, les sélectionneurs devraient s’appuyer sur les tests de consommation menés sur la pomme et la pêche par différents pays dont la France et que nous avons largement relatés dans fld (octobre 2008 et février 2010). Ces tests ont été effectués avec un objectif d’harmoniser les méthodologies au sein de l’Europe. Selon Catherine Lagrue, ces travaux qui auront des conséquences pour la pomme et la pêche vont être poursuivis pour multiplier les cartes de préférence.
Le vaste programme Isafruit va-t-il donc finalement encourager la consommation de fruit et légumes ? Sans doute serait-on tenté de répondre par l’affirmative. Catherine Lagrue estime comme Yves Lespinasse que les bénéfices ne sont pas tous directement mesurables et que les travaux auront un impact sur le moyen et long termes. En tout cas, une chose est sûre. L’augmentation de la consommation ne peut passer aujourd’hui que par plus d’informations et de communications.
(1) La séquence du génome a été publiée dans Nature Genetics par une équipe internationale le 30 août 2010 (cf. fld hebdo du 7 septembre 201).












