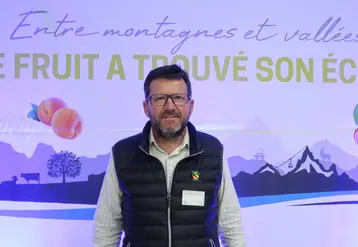L’installation au cœur du renouvellement des générations
L’installation est au cœur du renouvellement des générations d’agriculteurs qui se fait de plus en plus hors-cadre familial, notamment dans le secteur maraîcher et fruitier. De ces nouveaux dirigeants d’exploitation dépendent toute la dynamique du secteur agricole et une part de notre autonomie alimentaire.
L’installation est au cœur du renouvellement des générations d’agriculteurs qui se fait de plus en plus hors-cadre familial, notamment dans le secteur maraîcher et fruitier. De ces nouveaux dirigeants d’exploitation dépendent toute la dynamique du secteur agricole et une part de notre autonomie alimentaire.

L’enjeu du renouvellement des générations en agriculture et du maintien de la production agricole nationale est étroitement lié à celui de l’installation de nouveaux agriculteurs. En 2016, 14 146 installations d’exploitations ont été recensées par la MSA. Un chiffre qui s’établit dans une moyenne avec une certaine « stabilité » puisque plus 15 000 installés avaient été recensés l’année précédente et 13 000 en 2013. Ces installations se répartissent en trois catégories : – de 40 ans ; + de 40 hors transfert entre époux et + de 40 ans avec transfert entre époux.
Des salariés qui deviennent à leur tour des exploitants
« Les installations s’effectuent majoritairement entre 25 et 40 ans car les nouveaux agriculteurs peuvent bénéficier des aides à l’installation », mentionne Xavier Heinzlé, conseiller Renouvellement des générations chez les Jeunes Agriculteurs. Mais peu importe l’âge, car depuis le 1er janvier 2015, tous les porteurs de projets ont accès au même dispositif d’accompagnement, gratuit car financé par l’Etat ou les fonds Vivea. Le public des nouveaux installés en agriculture est de plus en plus large. Le nombre d’installation par transmission familiale de l’exploitation régresse alors que les installations hors-cadre familial dépassent maintenant plus d’un tiers des situations, avec un grand nombre de repreneurs issus du milieu agricole. « Le développement de l’agriculture urbaine qui progresse et se pérennise permet également l’arrivée d’un nouveau public d’installation hors milieu agricole », constate le responsable des JA. A Légumes de France, syndicat spécialisé, l’installation est un sujet à part entière avec notamment l’existence d’une section jeune maraîcher. « Nous avons constaté une diminution de l’âge des dirigeants qui s’installent passant de 32-37 en 2004 à 30-35 ans », se satisfait Hélène Boucherie, Légumes de France. « En revanche, sur les sept principaux départements producteurs de légumes, le nombre d’installation a diminué de 22 % au cours de cette période », s’inquiète-t-elle. C’est donc au travers de la promotion des métiers, celui de producteurs mais également de salariés, qui deviennent à leur tour des exploitants, que Légumes de France souhaite s’orienter.
Beaucoup d’énergie de la part du candidat
« Produire des légumes, des métiers d’avenir » affirme le dernier document de production de cette filière présentant l’usage de techniques diversifiées et innovantes, son engagement dans le respect de l’environnement, sa contribution à une alimentation plus saine, l’importance de ses relations humaines… Pour Luc Barbier, président de la FNPF, Fédération des arboriculteurs, le niveau d’engagement financier et le retour d’investissement, même en dehors du foncier est un frein à l’installation dans son secteur. « La remise à niveau des vergers ou l’outil de travail est parfois très lourde lors d’une reprise d’exploitation si le cédant a trop levé le pied », constate-t-il. D’où les opérations de formation et d’accompagnement de plus en plus nombreuses vis-à-vis des agriculteurs en fin de carrière. « Le regard porté par la société sur notre métier, notamment ses défiances sur nos pratiques agricoles mais aussi l’engagement personnel parfois difficile à concilier dans un cadre familial » sont aussi des freins à l’installation. De ces contraintes, certains y voient des avantages : « être son propre patron », « travailler avec du vivant », « bénéficier d’un cadre de vie », « nourrir des gens »… sont des motivations partager par les candidats à l’installation. Ainsi dans la Drôme, département dynamique, 214 installations, hors transfert entre époux, ont été recensées en 2016. Cependant, « malgré des niveaux élevés de formation, les candidats au métier d’agriculteur (trice) manquent fréquemment d’expérience en matière de gestion agricole et de pratiques professionnelles », observe Sandrine Roussin, directrice du CFPPA de Die lors de la dernière session de la Chambre d’agriculture présentant, ses ambitions en faveur du renouvellement des générations, comme en témoigne L’Agriculture drômoise. D’où la nécessité d’améliorer le professionnalisme des porteurs de projets en particulier ceux s’installant hors cadre familial, nombreux en maraîchage et plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans ce département.
L’accès au foncier est un point clé
Toutefois si l’installation demande beaucoup d’énergie de la part du candidat, son parcours est bien jalonné dans le cadre d’un dispositif national d’aides à l’installation. De nombreuses structures sont impliquées et parfois partie prenante de l’installation : Point accueil Installation Transmission, Chambre d’agriculture, Safer, MSA, Banques, Centres de gestion, Conseil départemental… « Même si ce dispositif aidé peut paraître contraignant de prime abord, il permet au jeune de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pendant la construction de son projet, une étude prévisionnelle économique sur quatre années, des conseils et un plan de formation permettant d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’exploitant agricole (gestion, commercialisation ou encore références techniques), des aides financières pour démarrer son activité et assurer son développement », précisait récemment Bérénice Walton, présidente des JA33, lors d’une journée sur l’installation organisée en Gironde (voir encadré). Néanmoins, l’accès au foncier est un point clé d’une installation. Sur les 400 jeunes reçus au Point Accueil Installation de la Drôme, 160 avaient du foncier. « Même si les jeunes sont prioritaires pour l’attribution de terres au sein du schéma des structures, chaque projet d’installation doit être bien étudié », considère le premier vice-président de la Chambre départementale en faisant part des difficultés d’arbitrer entre consolidation des exploitations et installation.
Le dispositif national d’aides à l’installation permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
En chiffres
Portrait des nouveaux installés
30,2 ans âge moyen
12,4 % de femmes
61,2 % dans le cadre familial
97 % ont le bac
89 % ont une formation agricole
90,1 % étaient salariés agricoles avant l’installation
S’installer et durer
En 2016, 778 installations en maraîchage (et fleurs) et 344 en arboriculture ont été recensées par la MSA. Avec plus de 1 100 installations, les fruits et légumes assurent 5 % des installations en maraîchage et 2,5 % en arboriculture. Le secteur se place derrière les grandes cultures, l’élevage bovin et la viticulture. Toutefois, les filières agricoles qui installent beaucoup en rapport avec leurs nombres d’agriculteurs ont un taux de renouvellement faible. Alors que la moyenne nationale situe à 3,3 %, l’élevage bovin ne renouvelle que 2 % de ses exploitations pendant que le maraîchage assure 5,5 % de renouvellement et 3,9 % en arboriculture. Toutefois le taux de maintien des structures d’exploitation à cinq ans est plus difficile à assurer notamment dans les cultures légumières. Il est proche de 75 % dans ce secteur. Ainsi, une installation maraîchère sur quatre est abandonnée, alors que l’arboriculture est légèrement au-dessus de la moyenne nationale avec un taux de 87 %.
Un choix de vie
Marie Brunel et son mari Laurent se sont installés en 2013 en reprenant une exploitation en Gironde dans la plaine de la Garonne. Pour Marie et Laurent, l’agriculture est un vrai choix qui s’est imposé comme une évidence après leurs premières expériences professionnelles qui les ont amenés à travailler en Afrique dans des projets de développement ou bien dans le secteur agricole en Gironde. Ils ont bénéficié du dispositif de portage foncier de la Safer. Dès leur installation, ils ont diversifié les activités : 2,5 ha de maraîchage en plus d’un verger de kiwis et une vingtaine d’hectares en céréales, le tout en agriculture biologique. Ils ont fait le choix dès le début des circuits courts pour écouler les productions maraîchères et une partie de leurs kiwis. Ils livrent le vendredi trois « Ruches qui dit Oui » sur Bordeaux, une AMAP en périphérie de la métropole régionale et sont présents le mardi à la gare de Langon. En tout, ils préparent en moyenne 150 paniers par semaine, un choix de commercialisation qui leur impose une grande variété dans les légumes produits, une cinquantaine. Aujourd’hui, leur EARL a embauché deux personnes à temps partiel sur la partie maraîchage car leur objectif est aussi de se dégager du temps pour profiter de leur famille et de leurs enfants. Marie et Laurent Brunel font partie des 95 % de jeunes agriculteurs qui ont choisi le parcours aidé et qui sont toujours en activité après les cinq premières années, preuve de l’intérêt du dispositif. « Il ne faut pas hésiter à pousser les portes et aller rencontrer tous les acteurs de l’installation », a insisté Bérénice Walton, présidente de JA33, lors d’une journée sur l’installation organisée en Gironde.
André Monget
Trente ans et déjà associé
Après avoir été salarié, Thibaut Chesneau s’est installé depuis septembre 2016 à Saint-Gemmes-sur-Loire dans l’entreprise de maraîchage dont il est aujourd’hui associé.
Après trois ans de salariat en tant que responsable de culture, le jeune homme a racheté les parts de Pierre Beaujean, un des deux frères associés de l’EARL Beaujean production, exploitation spécialisée en maraîchage. « Je ne pensais pas m’installer aussi rapidement », confie le maraîcher de 30 ans. En 2013, son diplôme d’ingénieur agronome passé en alternance dans une entreprise du Loir-et-Cher, Thibaut Chesneau souhaite passer par la case salariat. Une opportunité s’est offerte à lui. Thibaut Chesneau contacte un ami, qui n’est autre que le fils de Pierre Beaujean. « Antoine m’a expliqué que son père cherchait quelqu’un en renfort pour gérer la partie production ». Tout de suite, il apprend que Pierre Beaujean a l’intention de partir à la retraite et qu’il y a une possibilité de s’installer…
Faire face à une grosse charge de travail
Le jeune homme rejoint l’entreprise en décembre 2013. « Dès le départ, je m’investis à 300 % », espérant trouver sa place en tant que nouvel associé. L’entreprise lui plaît. « C’est une grosse entreprise mais avec une entité familiale. Même si on emploie beaucoup de salariés, elle garde une dimension humaine ». Autres atouts : son indépendance commerciale et des chiffres sains. « J’avais tout à prouver. Je me suis intégré tout en douceur. Il m’a fallu les écouter pour ensuite pouvoir m’imposer. Les deux frères ont été transparents avec leurs salariés et ont fait part de ma possible installation ». Aujourd’hui, Thibaut Chesneau assume pleinement son rôle de chef d’entreprise. Il s’occupe avec son associé Pascal Beaujean de la production. Le jeune homme avoue faire face à une grosse charge de travail. « Je ne compte pas mes heures. Il faut trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle ». L’entreprise se cale surtout par rapport à la production de salades. L’été, il se contente de week-ends prolongés. « On arrive à avoir deux à trois semaines de vacances ». Des projets pour l’entreprise ? La conversion de quelques terres en agriculture biologique. « Nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion », précise l’agriculteur. Solarisation, utilisation des stimulateurs de défense naturelle, d’engrais vert, investissement dans une bineuse autoguidée avec caméra… L’entreprise travaille depuis des années sur la réduction des phytos.
Hélène Rongier