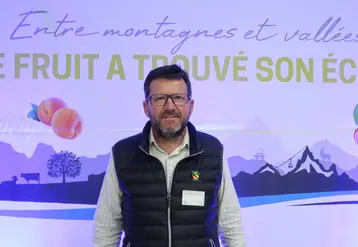Energie
De nouvelles sources d’énergie pour les serristes
Chaudière à bois, récupération de chaleur de sources diverses, les substituts ne manquent pas pour réduire les coûts de l’énergie. Tour d’horizon des serristes français.



Pour les serristes, confrontés à des hausses spectaculaires du coût de l’énergie (30 à 70 % entre 2005 et 2008), la recherche d’alternative devient une nécessité pour pérenniser l’outil de production. Jean-François Vinet, adhérent d’Océane, producteur de tomates en Loire-Atlantique et responsable de la commission énergie à Légumes de France confirme : « Dans notre région, une serre aujourd’hui chauffée au gaz naturel revient à 100 000 euros par hectare. Pour baisser les coûts de production, nous devons faire appel à d’autres énergies qui, malheureusement, ne peuvent remplacer totalement l’énergie fossile. Conséquence, nous ne pouvons plus nous contenter d’une seule source d’énergie. Cela entraîne de nombreuses contraintes et change complètement le métier du maraîcher. »
Depuis plus de dix ans, des serristes tentent de réduire leur facture énergétique et ont opté pour la cogénération (cf. fld mars 2009) dont les premiers contrats de rachat d’électricité par un fournisseur d’énergie comme EDF arrivent à terme en mars 2010. Il n’est pas sûr que ces contrats soient reconduits. « Avec les fluctuations importantes du cours du gaz, les serristes qui ont acheté le gaz au prix fort en 2009 n’ont pas obtenu de bilan positif de la cogénération », regrette le maraîcher nantais.
Les serristes cherchent donc une source d’énergie dont les coûts et la disponibilité sont stables dans le temps. Chaudière à bois, récupération de chaleur de sources diverses – voire pompe à chaleur –, les divers substituts ne manquent pas. Mais sont-ils viables économiquement ? Le choix dépend essentiellement de la technique utilisée mais aussi de la proximité de l’approvisionnement afin de réduire les coûts de transport. Depuis de nombreuses années, des serristes récupèrent ainsi l’eau chaude des centrales nucléaires. Plus récemment, l’installation de chaudières à bois est privilégiée dans les zones proches des centres urbains ou des ports où les palettes sont facilement recyclées et broyées. En région nantaise, à la fin de l’année, six chaudières à bois auront été installées depuis 2006. Chez Savéol en Bretagne, 34 ha sur plus de 200 ha de production sont également chauffés au bois. Cette alternative, qui paraît pourtant la plus simple, exige des investissements financiers importants, de l’ordre de 1 million d’euros mais aussi une implication importante dans la négociation pour l’approvisionnement.
Les maraîchers bretons réalisent d’ailleurs des commandes groupées pour limiter toute spéculation. Leur facture énergétique est ainsi divisée par deux. Dans les Pyrénées-Orientales, une étude de faisabilité économique est en cours à la Chambre d’Agriculture qui devrait être suivie par une autre étude sur la disponibilité des déchets bois du département. Parallèlement à Alénya (Pyrénées-Orientales), l’Inra (Institut national de recherche agronomique) étudie le bois de taillis courte rotation pour chauffer des serres. Mais les conclusions ne sont pas attendues avant 2014.
Lorsqu’alternatives riment avec contraintes
La récupération de chaleur de sources diverses demande des investissements en temps et en moyens financiers encore plus conséquents. Selon un serriste, ceux qui se lancent dans ce type d’alternative sont courageux. On peut citer, par exemple, le projet d’installer une unité de biométhanisation dans le secteur d’Orléans (Loiret) : la méthanisation de déchets d’industries agroalimentaires dégagera de la chaleur qui sera récupérée pour chauffer toute l’année 4,5 ha de nouvelles serres de concombres. Cette unité de biogaz, qui devrait entrer en activité cette année, a demandé quatre ans d’investissement en étude de faisabilité technique et économique avec plusieurs cabinets spécialisés, de démarches administratives et de négociations diverses. « Face à une technique délicate, nous avons dû créer une société spécifique avec un gestionnaire de déchets qui prendra en charge tout le processus », relate Jean-Michel Gallier, producteur à 20 km d’Orléans et initiateur du projet.
Cette unité de méthanisation qui va “avaler” 40 000 t de déchets par an et “recracher” un digestat qui sera épandu sur 5 000 ha demande 4 millions d’euros d’investissement. Le producteur devrait voir sa facture réduite de 40 % pour un amortissement sur quinze ans.
D’autres récupérations de chaleur sont à l’étude ou viennent de démarrer. Elles exigent l’installation de nouvelles serres proches des unités industrielles. Mais la concurrence est vive pour ce type d’alternative, les industriels eux-mêmes souhaitant récupérer les sources de chaleur dégagées. Le coût du foncier peut également être important. A Briec de L’Odet (Finistère), 5 ha en 2010 puis 7 ha de serres en 2012 seront construites et bénéficieront de la récupération de chaleur d’un incinérateur d’ordures ménagères. Au final, le coût de l’énergie dépensée reviendra entre 5 et 7 euros/m2/an en prenant en compte le complément au gaz nécessaire durant les périodes d’entretien de l’incinérateur. Dans la région, le chauffage au gaz revient à 12 euros/m2/an contre 8 à 10 euros/m2/an dans les zones plus méridionales.
Autre exemple, trois adhérents de la coopérative Rougeline utilisent depuis décembre 2009 l’eau rejetée par un puits pétrolier à Parentis-en-Born (Landes) pour chauffer, dans un premier temps, 6,5 ha de serres pour arriver à 17,5 ha en 2013. Conjointement, du gaz est capté pour alimenter une cogénération servant elle aussi de source de chaleur pour la serre avec production d’électricité. A terme, ce sont 8 500 t de tomates qui seront produites avec ce système. Le projet demandera au total 32 millions d’euros d’investissement avec 120 emplois à la clé. Les premières tomates de Parentis-en-Born seront commercialisées au printemps 2010. Au-delà de la nécessaire recherche d’économies, le projet de Rougeline s’intègre parfaitement dans une démarche marketing : « Notre but est de cultiver à Parentis-en-Born des tomates qui correspondent aux attentes des consommateurs en termes d’engagement citoyen, de goût, de plaisir, de bénéfice santé... Alors que très peu de paysans ne prennent aujourd’hui le risque, en France, de créer des serres de production de fruits et légumes, ce nouveau projet, parmi d’autres, prouve que les Paysans de Rougeline ont des convictions et l’audace de croire que demain les consommateurs exigeront des fruits et légumes locaux, issus de productions responsables et parfaitement respectueuses de la nature, produites par des femmes et des hommes fiers de leur métier », explique-t-on chez Rougeline.
Des projets ambitieux
On assiste aujourd’hui à une multitude d’essais. Savéol en Bretagne teste depuis deux ans l’intérêt d’utiliser des pompes à chaleur. La coopérative se donne encore une année supplémentaire pour valider ce type d’alternative, les résultats techniques étant concluants sur les quatre sites mais pas forcément sur le plan économique.
Le CTIFL a construit en décembre 2009 trois serres de 1 000 m2 chacune, dont l’une sert de témoin. Il s’agit d’étudier, d’une part, la récupération de la chaleur émise par une serre verre et son stockage dans des ballons et dans l’aquifère et, d’autre part, d’observer l’impact de l’isolation avec des parois en F-Clean-Téflon d’une serre plastique pour limiter le chauffage en plein hiver.
Par ailleurs de nombreux producteurs étaient intéressés par l’installation de panneaux photovoltaïques pour compléter leurs revenus. Mais au vu des derniers dispositifs (baisse du rachat d’électricité de moins 30 %) et des difficultés techniques que cela entraîne, il n’est pas sûr que les serres de tomates ou de concombres issues de cette technologie “fleurissent” dans les années à venir. Mêmes dans les régions les plus méridionales, le manque de luminosité qu’ils peuvent engendrer dans la serre ne convient pas aux cultures de tomates et concombres implantées toute l’année.
En revanche, un projet innovant, de 20 millions d’euros d’investissement, est à l’étude dans les Bouches-du-Rhône. Il s’agit de cogénération non pas avec le gaz mais avec le soleil. Des fours solaires concentreraient l’énergie qui, transformée en vapeur, alimenterait une turbine produisant de l’électricité. Le serriste récupère la chaleur pour chauffer ses serres et l’électricité est vendue à un fournisseur d’énergie. Des négociations sont en cours actuellement avec la société productrice d’électricité sur les coûts de chaleur attribués aux serristes. Enfin, dans des régions appropriées comme Istres (Bouches-du-Rhône), les maraîchers étudient avec les collectivités locales la possibilité d’utiliser l’eau des nappes souterraines, ce qu’on appelle la géothermie.