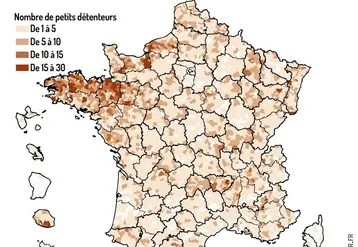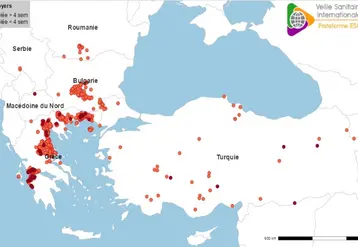« Mon hangar à fourrage est parti en flamme »
En septembre 2024, un incendie a ravagé le bâtiment de stockage de Jean Barou, éleveur de chèvres et viticulteur en Dordogne. Si aucune perte animale n’est à déplorer, les pertes matérielles et financières restent conséquentes. Retour sur le sinistre.
En septembre 2024, un incendie a ravagé le bâtiment de stockage de Jean Barou, éleveur de chèvres et viticulteur en Dordogne. Si aucune perte animale n’est à déplorer, les pertes matérielles et financières restent conséquentes. Retour sur le sinistre.



Ce dimanche matin là, après la traite, Jean Barou était rentré chez lui lorsqu’une voisine l’a alerté : son hangar de stockage était en feu. Les pompiers sont arrivés en moins d’un quart d’heure et se sont positionnés autour du bâtiment pour éviter que le feu ne se propage. Le hangar a entièrement brûlé mais, grâce à leur intervention rapide, la chèvrerie a été épargnée et aucun animal n’a été perdu. « Quand ils sont repartis le soir, je me suis dit : au moins, les chèvres et la plupart du matériel sont saufs. C’est surtout le stock qui est parti en fumée », confie l’éleveur de 57 ans qui élève 200 chèvres à Boisse, en Dordogne.
Une cause accidentelle liée à l’humidité du foin
Les experts et gendarmes ont conclu à un incendie accidentel. L’été 2024 ayant été particulièrement humide, Jean Barou suppose avoir stocké du foin qui n’était pas suffisamment sec, pris par la hâte entre deux périodes de pluie.
Le phénomène de combustion spontanée, dû à l’échauffement provoqué par la fermentation de la matière végétale, survient généralement dans les deux premiers mois suivant l’entreposage. Conscient du risque, l’éleveur avait pris soin d’espacer les bottes pour limiter l’effet de four. Ayant déjà vécu un incendie similaire en 2002, il avait repensé son bâtiment afin d’améliorer l’aération et de réduire les risques de surchauffe, notamment en espaçant les colonnes de stockage de ses bottes carrées pour limiter l’accumulation de chaleur. Malgré ces précautions, le danger restait présent.
Des pertes amorties par une entraide locale
Le hangar de près de 700 mètres carrés, abritant du foin, de la paille, de la luzerne déshydratée et deux palettes de lait en poudre pour l’engraissement des chevreaux, a été entièrement détruit. Un petit nourrisseur circulaire pour les chevrettes a également été perdu.
« L’incendie a consumé l’intégralité de mon stock d’alimentation pour l’année. Heureusement, j’avais quelques bottes d’avance dans la chèvrerie, ce qui m’a permis de tenir deux ou trois jours, mais il a fallu réagir vite », explique-t-il.
Face à l’urgence, Jean Barou a pu compter sur la solidarité de ses voisins et amis qui lui ont fourni du foin et de la paille en dépannage. « Grâce à cet élan de solidarité, j’ai pu tenir plusieurs semaines, mais il fallait trouver un approvisionnement durable. La pénurie de paille dans la région a compliqué les choses mais j’ai fini par trouver deux fournisseurs pas très loin et j’ai pu reconstituer mon stock. » Le temps de la reconstruction du bâtiment, l’éleveur trouve de la place pour son approvisionnement dans un petit hangar où il stocke du matériel.
Un sinistre estimé à 150 000 euros
L’assurance Pacifica souscrite par l’éleveur a rapidement indemnisé les pertes. « L’expert mandaté par l’assurance est venu sous quatre jours pour évaluer les dégâts et, dès la première semaine, des fonds ont été versés pour financer les premiers réapprovisionnements », raconte-t-il.
Pour justifier ses pertes, Jean Barou s’est appuyé sur ses relevés comptables et ses propres estimations. « J’ai noté de mémoire combien de bottes j’avais stocké. Avec l’expert, on a croisé ces données avec les barèmes et le cours du jour, et nos estimations correspondaient », explique-t-il.
En décembre, l’assureur a versé le solde de l’indemnisation, soit environ 150 000 euros, évalué en valeur à neuf pour les pertes de stock et de bâtiment. Pour ce dernier, 75 % ont été débloqués immédiatement, le reste étant conditionné à la présentation des factures de reconstruction. Seule la franchise, qui s’élève à 1 500 euros, est restée à la charge de l’éleveur.
Reconstruire et prévenir un nouvel incendie
Six mois après l’incendie, le bâtiment est reconstruit, seuls les aménagements intérieurs et le terrassement sont à finir. L’éleveur envisage d’investir dans des sondes connectées pour surveiller la température du fourrage. « L’ensemble des dix sondes coûte un peu moins de mille euros. C’est un investissement qui me permettra de surveiller de près le stockage en cas de doute et d’intervenir rapidement si nécessaire. »
Il insiste aussi sur l’importance de vérifier régulièrement ses garanties d’assurance. « Le coût des bâtiments a triplé en vingt-deux ans. Il faut s’assurer que sa couverture est suffisante », conclut-il.
La question
Faut-il recourir à un contre-expert ?
En 2002, Jean Barou avait fait appel à un contre-expert, un professionnel indépendant chargé de défendre les intérêts de l’assuré. Cette fois, il a choisi de s’en passer, estimant que les pertes étaient claires. « Un contre-expert aurait pu identifier d’autres pertes, mais son coût, entre 3 et 5 % du montant du sinistre, aurait été supérieur aux gains potentiels. Cependant, dans certains contrats, ce coût peut être pris en charge », précise-t-il. L’exploitant recommande toutefois aux agriculteurs confrontés à un sinistre important de ne pas écarter cette option. « Quand on vit un sinistre pour la première fois, on ne sait jamais trop comment cela va se passer. Avoir un contre-expert permet d’être accompagné et de s’assurer que tout ce qui peut être indemnisé le soit. »
Avis d’expert
« Les exploitants doivent mettre en place un minimum de prévention et de protection pour limiter le risque incendie »
En élevage, la présence de matières sèches facilement inflammables accroît fortement le risque d’incendie. Mettre en place un minimum de mesures de prévention et de protection permet d’en limiter la survenue et d’en réduire l’ampleur. Jean-Michel Geeraert, directeur du marché de l’agriculture et de la prévention chez Pacifica, filiale d’assurance dommage du Crédit agricole, partage son expertise.

« Les cinq principales causes d’incendie en exploitation agricole sont la défaillance électrique, le stockage des automoteurs à proximité de matières inflammables, les travaux à risque, la foudre et la combustion spontanée du fourrage. Pour chacune, il existe des bonnes pratiques à adopter.
Avant tout, il est essentiel de faire contrôler régulièrement son installation électrique par un professionnel agréé. La présence de panneaux photovoltaïques en toiture ajoute un étage électrique supplémentaire à surveiller, et il est préférable d’éviter de stocker du fourrage en dessous. De même, éloigner les engins motorisés (thermiques ou électriques) des zones de stockage doit devenir une habitude pour prévenir tout départ de feu. Lorsque engins de manutention, fourrages et animaux cohabitent sous un même bâtiment pour profiter d’une bonne température, respecter les distances de sécurité peut être complexe. Dans ce cas, l’installation d’un mur coupe-feu ou d’une plateforme en béton limite les risques en empêchant la propagation d’étincelles vers les matières inflammables.
Lors des travaux de réparation ou d’entretien, il est tout aussi crucial de prendre des précautions en gardant un extincteur à portée de main et en éloignant les matériaux combustibles. Associer prévention et protection permet non seulement de réduire le risque d’incendie, mais aussi d’en limiter l’ampleur. Faire appel à un organisme agréé pour implanter des extincteurs, installer un parafoudre en zone orageuse ou utiliser des sondes à fourrage pour alerter d’une surchauffe sont autant de mesures efficaces et abordables pour agir en amont.
Lorsqu’un exploitant adopte cette démarche préventive, son assureur en tient compte dans la tarification. Cette approche devient d’autant plus cruciale que, depuis 2020, la valeur unitaire des sinistres a fortement augmenté. Aujourd’hui, le coût de reconstruction d’un bâtiment est supérieur de 30 à 45 % à celui d’avant 2020, et cette tendance ne semble pas prête à s’inverser. Sans un renforcement des mesures de prévention et de protection, les cotisations d’assurance devront inévitablement augmenter. »