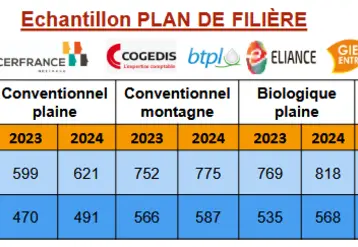Allo véto : les tiques, petites bêtes aux grosses conséquences pour les vaches laitières et les éleveurs
Les tiques sont responsables de la transmission de nombreuses maladies. Les conséquences peuvent être importants pour le troupeau mais aussi pour les éleveurs.

« Bonjour, j’ai une génisse au pré qui a le chignon à vif ! Je ne comprends pas ce qu’elle a fait. Il y en a une autre qui est aussi un peu abîmée. »
Sur cette génisse, c’est vraiment l’arrière du chignon, dans le petit creux, qui est touché : c’est sanglant, dépilé, la peau est très abîmée. Vu la localisation, il y a eu grattage, le traumatisme est exclu. On trouve quelques traces des responsables : de nombreuses tiques sont bien visibles sur l’autre génisse qui s’est moins grattée.
La gestion de la plaie est assez basique : nettoyage, désinfection, et application d’une pommade grasse pour favoriser la cicatrisation et limiter les mouches attirées par les suintements. D’autres symptômes sont aussi à rechercher : les tiques sont responsables de la transmission de nombreuses maladies.
La piroplasmose transmise par les tiques
La maladie la plus connue transmise par les tiques est la piroplasmose (ou babésiose, car causée par un protozoaire Babesia). C’est une maladie aiguë, avec fièvre, diarrhée en jet, urines couleur café, muqueuses pâles ou jaunâtres. Babesia se multiplie dans les globules rouges et les fait exploser, causant une anémie et une atteinte des reins et du foie. Si la prise en charge n’est pas assez rapide, le bovin peut mourir. Un traitement est indispensable mais la molécule a l’inconvénient d’avoir un délai d’attente très long : 6 jours sur le lait et 213 jours sur la viande.
Souvent, il y a une parcelle concernée par les cas de piroplasmose car les tiques sont porteuses dans cette parcelle seulement. Ces parcelles sont alors à favoriser pour les jeunes, de manière contrôlée, pour permettre le développement d’une immunité.
Erhlichiose aussi fréquente
Transmise par les tiques et causée par la bactérie Anaplasma phagocytophilum, l’erhlichiose est également fréquente. Cette bactérie s’attaque aux globules blancs. On observe des pics de fièvre et une baisse de production, ce qui n’est pas caractéristique et rend parfois le diagnostic difficile. Un signe spécifique est la présence de paturons enflés, mais ce n’est pas systématique. Des avortements sont possibles, ainsi qu’une baisse d’immunité favorisant d’autres pathologies (cellules, grippes…). Une immunité peut se mettre en place. Le traitement à base d’oxytétracycline n’est pas toujours très efficace. Les chevaux, les petits ruminants, et même l’homme peuvent être touchés.
Les tiques vont aussi être porteuses d’une autre anaplasmose, due à Anaplasma marginale, qui ressemble à la piroplasmose, sans les urines foncées, mais avec le même traitement ; et de la maladie de Lyme ou borréliose, où les animaux présentent de la fatigue, une baisse de production, de la fièvre, des arthrites, des boiteries. La fièvre Q, zoonose provoquant des avortements et plutôt transmise par voie aérienne, peut aussi être transmise par les tiques.
La lutte démarre
Comment se débarrasser des tiques ? C’est illusoire d’espérer les faire disparaître. On peut éviter leur prolifération avec un bon entretien des parcelles : broyage des parties en friche, débroussaillage. Pour limiter le contact, on conseillera de mettre un fil empêchant l’accès aux haies à deux mètres de distance.
Il existe des produits permettant de tuer les tiques, utilisables en application externe. Ces molécules ont des répercussions : contamination des eaux et des sols et impact sur tous les insectes, pas seulement les nuisibles. Leur utilisation doit donc être raisonnée. Les répulsifs ont moins d’effet secondaire, mais leur durée d’action est moindre.
Mise en garde
Des maladies aussi transmissibles à l’homme
L’éleveur doit être particulièrement attentif aux tiques, car cela peut avoir un impact aussi bien sur son troupeau que sur sa propre santé : la maladie de Lyme et l'erhlichiose touchent aussi les hommes.
Le saviez-vous ?
Les tiques sont des acariens, de 3 mm à 1 cm. Elles sont très présentes et actives du printemps à l’automne, mais potentiellement toute l’année, selon le climat. Il en existe plusieurs espèces en France, Ixodes ricinus étant la plus fréquente. Elles vivent en particulier dans les sous-bois et les haies. Larves, nymphes, comme adultes se nourrissent de sang sur des hôtes divers, et peuvent transmettre des pathogènes par leur salive lors de la morsure.