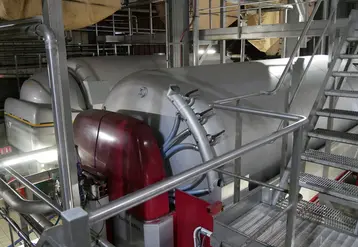" Penser à la sous-activité en cas d’aléas "
En cas de perte de récolte, Geoffrey Marquis, expert-comptable du cabinet TML, à Nîmes, prône la sous-activité. Un mécanisme comptable qui permet, dès l’année où la perte de récolte est constatée, de diminuer le résultat et donc l’imposition et les cotisations sociales sur cette même année.

Qu’est-ce que le principe de sous-activité ?
C’est le fait de déduire de son résultat une somme dont le montant est calculé à partir de deux chiffres : le montant de ses charges fixes de production et le volume de la production "non réalisée", autrement dit de sa perte de récolte. La sous-activité permet dès l’année de la perte de récolte de passer en perte le prix de revient des volumes non produits. Cette règle comptable reconnue sur le plan fiscal permet donc de déduire la perte dès l’année de la constatation de l’aléa climatique, sans être obligé d’attendre la vente du vin. Ce dispositif fiscal, encore peu connu en agriculture, est largement pratiqué dans l’industrie.
Comment évalue-t-on la sous-activité ?
La sous-activité est calculée à partir du volume de récolte que le viticulteur aurait pu espérer produire sur une année normale. Pour valider cette perte de récolte, il est indispensable de produire une preuve matérielle qui valide le volume récolté l’année du sinistre. Si la date de clôture de l’exercice est située avant la levée de la récolte, au 31 juillet par exemple, il peut être difficile de prouver la quantification de la perte de récolte. Dans ce cas, la preuve peut être établie notamment grâce à un comptage de grappes sur les ceps effectué au 31 juillet. Lors d’un aléa climatique, si un rapport d’expertise d’une compagnie d’assurances a été réalisé, le document vaut bien sûr preuve de cette perte de récolte. Si la clôture de l’exercice a lieu le 31 octobre, la perte de récolte devient plus simple à prouver puisqu’en général, la vendange a eu lieu. Cela dit, le viticulteur doit aussi prouver que cette perte est un élément indépendant de sa volonté et qu’il n’a pas modifié son processus de production en faisant, par exemple, des vendanges en vert.
À partir de quand parle-t-on de sous-activité ?
Rien n’est arrêté sur ce point mais chez mes clients, je le situe dès 15 % de perte de récolte. Dans la pratique, j’évalue le volume de production "normalement" attendu à partir des 7 ou 10 dernières années, en ôtant les années exceptionnelles. À partir de là, on obtient le rendement de référence et on calcule le pourcentage de perte de récolte sur l’année du sinistre.
Comment évalue-t-on les charges fixes ?
L’analyse des charges concernées est très importante car la notion de charges fixes est primordiale. Elle ne doit en effet pas être interprétée de manière trop restrictive en ne considérant que les amortissements. En réalité il suffit d’exclure les charges qui sont variables avec le niveau de production. Quand un viticulteur rentre une demi-récolte, il a quasiment les mêmes charges que lors d’une récolte entière. Mais les charges peuvent être moindres sur les temps de travaux en vert et sur les frais liés à la vinification.
Pourquoi ce concept est-il peu connu en viticulture ?
En cas de perte de récolte, le monde agricole utilise plutôt un autre mécanisme, celui de la provision pour dépréciation. Mais dans certains cas, ce mécanisme a des limites. Le concept de sous-activité s’avère alors plus intéressant. Cela dit, il ne s’applique pas toujours. Pour les producteurs au micro-BA (bénéfice agricole), la perte de récolte ne peut être constatée que lors de la vente des vins. Pour le viticulteur soumis au réel simplifié (BA) qui a opté pour la valorisation de son stock en fonction du cours du jour moins l’abattement de 30 %, la sous-activité est déjà comprise. Le concept de sous-activité est donc adapté aux structures qui sont au réel normal et au réel simplifié, mais qui n’ont pas choisi la valorisation simplifiée.