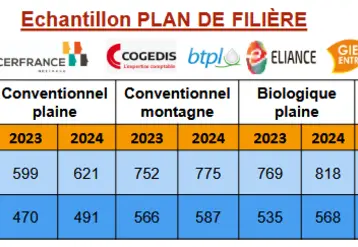TOUT DOUX SUR LES TRANSITIONS ALIMENTAIRES
Les changements alimentaires entraînent des désordres
dans le rumen, susceptibles d’altérer la qualité
de la digestion et de nuire à la santé de l’animal.

organique par jour produit dans le rumen environ
3,5 kg d’acide acétique, 1,7 kg d’acide propionique,
0,8 kg d’acide butyrique, 535 litres de méthane
et 1 187 litres de dioxyde de carbone…
Chez les ruminants, 80 % de la digestion se fait dans le rumen. Le reste est effectué au niveau intestinal. Des millions de micro-organismes (bactéries, champignons et protozoaires) vivent dans la vaste cuve de fermentation qu’est le rumen. Micro-organismes et bovin vivent ainsi dans le cadre d’une association à bénéfices réciproques appelée symbiose. Nourrir la vache c’est donc avant tout nourrir la flore microbienne de son rumen. Dans le milieu ruminal, propice à leur activité, ces microbes sont capables de dégrader la cellulose et l’hémicellulose, principaux constituants des fourrages. Ils peuvent également dégrader d’autres composants de la ration tels que les protéines et l’amidon. « Pour que les micro-organismes aient une activité optimale, il faut des conditions ruminales stables, même si il existe des variations au cours de la journée et notamment des fluctuations des pH après le repas », explique Jocelyne Flament, enseignant-chercheur à Agrocampus (Rennes).
De fait, le temps d’adaptation nécessaire à la flore digestive pour être en mesure de digérer les rations proposées est plus important qu’avec une digestion intestinale. Les micro-organismes apprécient la stabilité du milieu ruminal. Ce dernier offre des conditions idéales de développement grâce à une température maintenue entre 39 et 40 °C, une atmosphère dépourvue d’oxygène et un pH constant entre 6 et 7. Les acides provenant de la digestion sont neutralisés par les sels basiques de la salive — dont la production est activée par le mécanisme de rumination — et l’ammoniac provenant de la dégradation microbienne des matières azotées. L’activité des micro-organismes est également maintenue grâce à l’arrivée régulière de fourrage très finement broyé et le brassage permanent assuré par les contractions de la paroi du rumen.
Certains fourrages peuvent être ruminés plusieurs fois et ce n’est que progressivement que les aliments passent dans les compartiments digestifs suivants : le feuillet et la caillette. Le temps de séjour dans la panse varie selon les régimes, de un jour et demi pour l’herbe jeune à plus de cinq jours pour la paille dont la dégradation est plus longue. La population microbienne du rumen est complexe et diverse, adaptée à la ration et spécialisée dans un type de substrat. Les bactéries amylolytiques dégradent l’amidon alors que d’autres, cellulolytiques par exemple dégradent la cellulose. Quel que soit le régime alimentaire, la diversité des espèces microbiennes reste la même mais leur équilibre diffère.Avec une ration riche en fibre, les micro-organismes qui dégradent la cellulose se multiplient davantage et leur population finit par prédominer. Si la ration est riche en céréales, ce sont les micro-organismes dégradant l’amidon qui prédominent par leur nombre.
Par conséquent, il importe d’effectuer graduellement tout changement dans une ration, afin que les populations microbiennes du rumen puissent s’adapter. D’autant que la vitesse de multiplication des microorganismes est variable. Le risque est de voir certaines espèces prolifèrer et d’autres diminuer, voire disparaitre, altérant ainsi plus ou moins sévèrement la qualité de la digestion des matières organiques et les performances de l’animal. Plus généralement, tout changement brusque d’alimentation modifie les conditions de vie des micro-organismes, perturbe leur multiplication et peut nuire à l’animal. Les acides gras volatils (AGV) produits par les micro-organismes du rumen, capables de dégrader la cellulose des fourrages, constituent la principale source d’énergie des ruminants. Ces AGV sont au bovin ce que le glucose est à l’homme.
Ils sont absorbés au niveau de la muqueuse qui tapisse l’intérieur du rumen. Cette dernière est garnie de nombreuses excroissances, appelées papilles, qui augmentent la surface de contact avec les aliments. Moins on alimente l’animal, plus la taille des papilles diminue. « Cette situation est courante pendant des périodes où les besoins des animaux sont faibles, comme le tarissement, lorsque le rumen n’est pas suffisamment rempli », remarque Philippe Brunschwig, de l’Institut de l’élevage. En réponse à la réduction des apports, les populations microbiennes diminuent, et avec elles, la synthèse des produits terminaux (AGV et ammoniac), ce qui réduit l’activité d’absorption de la paroi du rumen.
STIMULER LES PAPILLES
« Cette situation est acceptable tant que les besoins de l’animal sont réduits, note Philippe Brunschwig. Mais lorsqu’au moment du vêlage, les besoins de la vache laitière augmentent brutalement, le rumen ne peut répondre à la demande immédiatement. Maintenir un bon niveau d’activité bactérienne en veillant à toujours remplir le rumen est le gage d’une adaptation rapide au vêlage. En résumé, si le réservoir de la vache doit toujours contenir le maximum de carburant, pendant les phases où les besoins sont modérés on pourra se contenter d’un carburant moins raffiné et moins énergétique que le kérosène ! » Il s’agit en outre de maintenir un volume de panse suffisant à un stade où le veau et le placenta tendent à réduire l’espace disponible. L’appétit de la vache au vêlage est en jeu avec le risque de ne pas être capable de satisfaire ses besoins en début de lactation et de plonger dans un déficit énergétique qui peut être synonyme de cétose. ■ Sandra Roupnel
SOMMAIRE DU DOSSIER
Page 31 : Ménager la flore du rumen
Page 33 : Petit veau deviendra ruminant - De la naissance au sevrage
Page 34 : « Une transition réussie dure trois semaines » Patrick Besnier, vétérinaire NBVC
Page 40 : « Nous essayons d’éviter les changements » - A l'EARL des Trois Ruelles, dans la Meuse
Page 42 : « Je régule la consommation d’herbe » - Chez Michel Painchaud, en Ille-et-Vilaine
Page 44 : « J’élève les veaux sans à-coups » - Élevage Derrien, dans le Finistère