Calculer son coût de production, oui mais tous de la même façon !
L'Institut de l'élevage, dans le cadre du dispositif partenarial Inosys Réseaux d’élevage, a développé en 2009 une méthode nationale compatible avec celle du réseau IFCN(1). Petite piqûre de rappel.
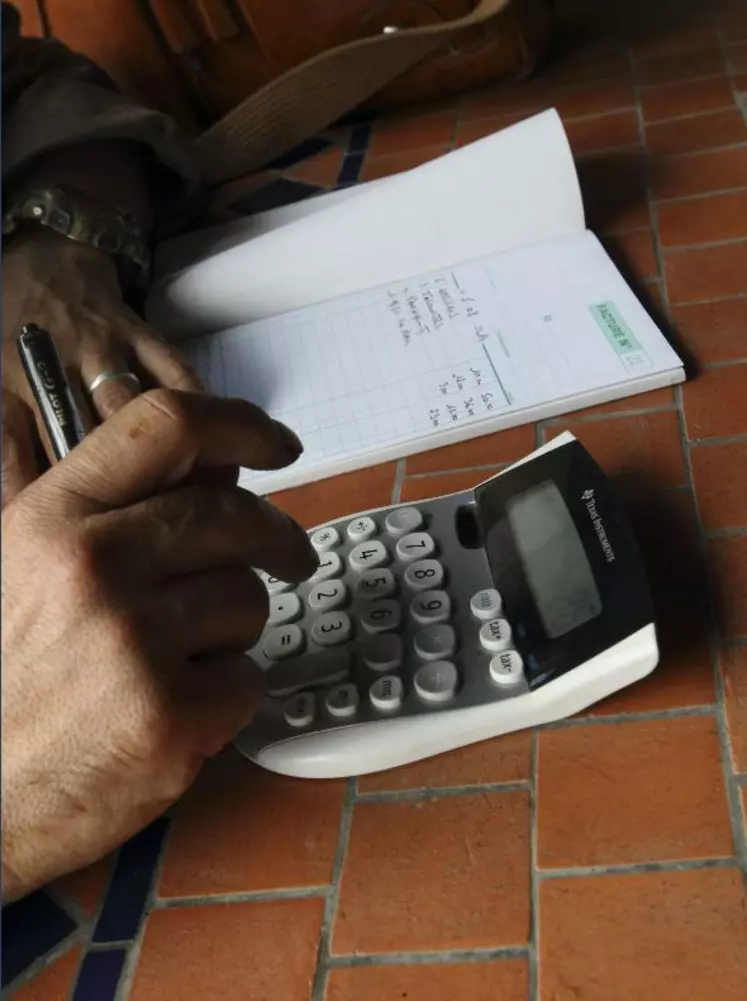
« L’approche coût de production consiste à mettre en regard toutes les charges et tous les produits liés à la production laitière. » L’énoncé paraît simple. Mais, souvent mis en avant, le coût de production peut se calculer de plusieurs manières. Alors au moment de calculer, il faut faire des choix. « Le calcul du coût de production soulève un grand nombre de questions méthodologiques, explique Jean-Luc Reuillon, du service économie des exploitations de l’Institut de l’élevage. Même si chaque fois plusieurs réponses sont possibles, des choix sont nécessaires. Nous avons choisi la compatibilité avec les méthodes internationales. Le plus important est de rendre comparables les résultats des exploitations entre elles ou avec des références ».
Définir le périmètre de l'atelier lait
La question du périmètre des charges et produits pris en compte dans le calcul est un préalable. En effet, en France, beaucoup d’exploitations laitières ne sont pas spécialisées et le contour de l’atelier lait doit être soigneusement défini. Concrètement, le coût de production englobe la production laitière, l’élevage des génisses de renouvellement, la vente des réformes et des veaux, et la production fourragère et de céréales intra consommées à leur coût de production.
Des clés de répartition pour affecter les charges
En exploitation diversifiée, calculer les charges affectées à l’atelier laitier reste un défi. Si les charges opérationnelles sont en général assez faciles à répartir, il en va différemment pour les charges de structure ! L’Institut de l’élevage a travaillé sur des clés de répartition des charges stables dans le temps et généralisables pour répartir de la façon la plus juste possible les charges entre les ateliers de l’exploitation. « À partir de cœfficients basés sur des unités physiques (animaux, hectares) et calculés à partir des fermes du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage, on peut déterminer le pourcentage de charges à affecter aux différents ateliers », explique Thierry Charroin, de l’Institut de l’élevage. Et ces cœfficients s’adaptent à différentes situations : plaine, montagne, atelier viande, cultures de vente.... Par exemple, calculons les charges de mécanisation d'une exploitation de plaine lait et engraissement de bœufs à partir de veaux laitiers et avec 20 hectares de céréales vendues. L'utilisation des clés permet d'affecter 73% des charges de mécanisation à l'atelier lait, 8% à l’atelier viande et 19% aux cultures vendues. « Depuis 2009, le jeu de cœfficients s’est affiné, on a intégré de nouveaux types de production (agriculture biologique, cultures industrielles, irrigation,…), pour une répartition des charges plus pertinente pour les systèmes de polyculture élevage », précise Thierry Charroin.
Rémunérer le foncier, les capitaux et le travail
Du côté des charges, les charges courantes sont celles donnant lieu à des flux monétaires annuels (aliments, frais d’élevage, salariés, carburant....). Les amortissements représentent les charges d’investissement en matériel et bâtiments utilisés pour la production laitière, étalés dans le temps. Les charges supplétives sont le résultat d’un calcul visant à rémunérer les facteurs de production que l’exploitant met à la disposition de son entreprise. Il y a donc les terres en propriété (rémunérées au prix du fermage moyen de l’exploitation ou de la région), les capitaux propres (rémunérés à la valeur du taux annuel du livret A), et le travail que les exploitants consacrent à l’atelier. Ce calcul des charges supplétives a pour objectif de pouvoir comparer tout type d’exploitation, par exemple des éleveurs qui sont propriétaires et d’autres en fermage.
Ne pas oublier les produits de l'atelier !
En face des charges, les produits affectés à l’atelier laitier sont le lait vendu, le produit viande de l’atelier (veaux de huit jours, réformes, génisses), les autres produits (vente d'embryon...) et les aides.
(1) International Farm Comparison Network
La méthode présentée ici est celle que nous utilisons tous les mois dans les articles de la rubrique Rentabilité de Réussir Lait. Le manuel complet expliquant les choix méthodologiques et les calculs est disponible sur le site de l'Intitut de l'élevage : www.idele.fr.
L'épineuse question de la rémunération de l'exploitant
Il est possible de poser la question de la rémunération de l'exploitant de deux façons :
1 - Quel prix du lait pour rémunérer mon travail au niveau de rémunération que je me fixe ? C'est le prix de revient. Il permet de connaître le prix du lait nécessaire pour rémunérer à un niveau donné la main-d'œuvre (MO) exploitant consacrée à l’atelier lait. « Dans les méthodes de calcul internationales, notamment à l’IFCN, le prix de revient est l’indicateur privilégié pour les comparaisons », explique Jean-Luc Reuillon. Par exemple, dans le graphique ci-contre, l'éleveur souhaite se rémunérer à hauteur de 1,5 Smic. Le prix de revient est donc égal au coût de production de l'atelier calculé avec une rémunération de la MO exploitant à 1,5 Smic, moins les produits joints et les aides, soit 321 euros pour 1000 litres.
2 - À combien mon atelier lait rémunère-t-il mon travail ? C'est la rémunération de mon travail permise par le produit après rémunération des capitaux propres et du foncier en propriété. Elle mesure la part des produits qui reste pour rémunérer la main-d’œuvre que les exploitants consacrent à l’atelier une fois couvertes toutes les autres charges. Dans l'exemple du graphique ci-contre, la rémunération du travail permise par le produit est égale aux produits de l'atelier moins le coût de production (hors rémunération du travail de l'exploitant), soit 62 euros pour 1000 litres, ce qui multiplié par la productivité du travail par UMO (240 000 l/UMO) donne 14 880 euros bruts par an par UMO exploitant consacrée à l'atelier.
" Par convention, la main-d’œuvre exploitant est rémunérée sur une base proche du salaire médian français, soit 1,5 Smic brut par UMO. Cette rémunération doit aussi couvrir les charges sociales de l’exploitant."











