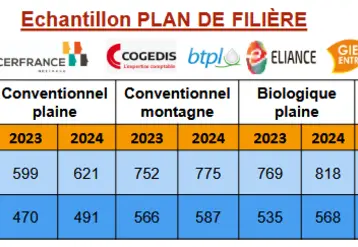La lutte renforcée contre la tuberculose bovine porte ses fruits en Normandie
L’Orne et le Calvados, qui ont renforcé leurs efforts de lutte contre la tuberculose bovine, font part de leur expérience. La maladie semble contenue, mais les résultats restent fragiles. Sur le terrain, les éleveurs jugent le dispositif sévère et perfectible.
L’Orne et le Calvados, qui ont renforcé leurs efforts de lutte contre la tuberculose bovine, font part de leur expérience. La maladie semble contenue, mais les résultats restent fragiles. Sur le terrain, les éleveurs jugent le dispositif sévère et perfectible.

Avec un foyer de tuberculose bovine dans le Calvados et un second dans l’Orne, la Normandie affiche un bon résultat cette année 2025 (chiffres arrêtés au 1er septembre). Mais la lutte est sévère contre cette zoonose à éradication obligatoire. « Sur le terrain, il y a des incompréhensions et des oppositions d’éleveurs concernant les mesures de lutte, qui peut aller jusqu’à l’abattage total du troupeau. C’est pour cela que nous avons organisé ce colloque », a introduit Jonathan Lenourichel, président du GDS du Calvados, lors de la journée du 9 septembre dédiée à la lutte contre la tuberculose bovine, organisée par le GDS du Calvados et le GTV de Normandie. Sont intervenues la DGAL, l'Anses, la DDPP ... de quoi faire le point sur la situation en France et plus particulièrement en Normandie.
Une lutte intense en Normandie
Rappelons qu’en France, la lutte repose sur une quarantaine d’actions, dont la surveillance en abattoir de chaque bovin abattu, la prophylaxie (test de dépistage) obligatoire dans les troupeaux situés en zone de surveillance, les enquêtes épidémiologiques (tests complémentaires) dans les élevages où le test de dépistage est revenu positif ou douteux, l’abattage total ou sélectif du troupeau, la surveillance de la faune sauvage et la mise en place de mesures de biosécurité en élevage.
En Normandie, en 2023, « l’Orne et le Calvados ont décidé d’aller plus loin pour éradiquer la tuberculose bovine en coordonnant leurs actions », a rappelé Raphaël Fayaz-Pour, de la DDPP du Calvados. Les actions de la feuille de route nationale ont été renforcées, comme l’identification des exploitants qui n’auraient pas réalisé le dépistage obligatoire. Et derrière, des mesures coercitives telles que le retrait des cartes vertes, des suites pénales… sont mises en place. En août, la DDPP a ainsi contraint un éleveur de 300 bovins à réaliser sa prophylaxie : « cette action administrative est une première de par son ampleur ».
Améliorer encore les tests

Un des gros problèmes dans la lutte contre la tuberculose bovine, c’est la fiabilité des tests sur animaux vivants. « Aucun test n’est parfait. Il y a des faux positifs et des faux négatifs. On ne peut que se rapprocher d’une bonne fiabilité », plante Maria-Laura Boschiroli, de l’Anses. Le test de dépistage positif ou douteux doit être complété avec des analyses sur prélèvements (PCR, histologie) qui nécessitent l’abattage de l’animal suspect ; c'est ce qui est appelé l'abattage diagnostic. Durant cette enquête, l’élevage suspecté d’infection est sous APMS (arrêté préfectoral de mise sous surveillance). L’éleveur vit alors dans l’angoisse des résultats, les entrées et sorties de ses animaux sont bloquées et il est interdit de consommer ou de vendre des produits au lait cru. L’enjeu est donc d’améliorer la fiabilité des tests et de réduire le délai d’arrivée des résultats. En Normandie, avec une filière laitière importante dont une partie valorise du lait cru, cet enjeu est vital.
De leur côté, le GDS et la DDPP de Normandie font le même constat, estimant que « l’utilisation du test Interféron gamma (IFG) a permis de réduire le nombre d’abattages inutiles et de raccourcir la durée de l’APMS de plusieurs jours ». La PCR est aussi une méthode relativement rapide pour valider ou infirmer un cas suspect. « Aujourd’hui, une APMS peut être levée en dix jours. Sur le Calvados, les résultats arrivent vite », a estimé Erwan Lozevis, responsable qualité chez Lactalis. La recherche est en cours pour améliorer encore les tests.
Plus de surveillance de la faune sauvage
Surveiller et contrôler la faune sauvage est aussi un levier, car elle peut constituer un réservoir de la bactérie Mycobacterium bovis. Depuis deux ans, « l’activité de piégeage des blaireaux a augmenté », a indiqué Stéphane Bernier, de la fédération de chasse du Calvados, qui participe à la surveillance des blaireaux, cerfs et sangliers et au nettoyage des garennes. La faune sauvage normande semble peu contaminée. « Sur 893 blaireaux piégés, 6 se sont révélés infectés par la tuberculose bovine. Sur 361 blaireaux retrouvés morts, les analyses n’ont révélé aucun animal infecté », a détaillé Raphaël Fayaz-Pour, de la DDPP. Mais la population de sangliers croît. Depuis 2021, des buvards sont distribués pour effectuer un test rapide. « À ce jour, il n’y a pas de cas détecté de cervidé, ni de sanglier », indique Stéphane Bernier.
Déployer des mesures de biosécurité
« La mise en place de mesures de biosécurité, pour éviter l’entrée, la circulation et la sortie des éléments pathogènes, est la mesure la plus difficile et longue à déployer », a estimé Doriane Moreaux, de GDS France. Il s’agit par exemple d’installer des doubles clôtures ou de réorganiser un parcellaire avec une alternance de cultures et de pâtures pour éviter le contact entre deux troupeaux voisins de pâture. Ou de réaliser des installations pour éviter le contact avec la faune sauvage. Depuis 2021, l’audit et la formation à la biosécurité sont obligatoires en zone de surveillance. Des aides existent pour s’équiper.
Si le nombre de cas a baissé depuis quatre ans, les acteurs normands ne s’estiment pas au bout du tunnel. « La maladie peut faire un saut dans le temps, prévient Arnaud Triomphe, du GTV Normandie. Car la bactérie Mycobacterium bovis peut rester longtemps tapie au fond des ganglions avant de se développer quand l’immunité de l’animal s’affaiblit, et la bactérie se montre très résistante dans l’environnement. »
Carte en illustration principale : En France, 80 foyers ont été confirmés en 2025 (chiffres arrêtés au 1er septembre). Les Pyrénées-Atlantiques (21 foyers), la Dordogne (15 foyers), la Corse (14 foyers), les Landes (6), la Charente (5), la Côte d’Or (4) et la Haute-Vienne (4) sont les départements les plus touchés. La Normandie en compte deux.
Le saviez-vous ?
La tuberculose bovine, due à la bactérie Mycobacterium bovis, est transmissible à l'homme, par contacts rapprochés et fréquents. « La tuberculose bovine est classée à éradication obligatoire par l'Union européenne pour éviter cette contamination, rappelle Fabrice Chevalier, de la DGAL. La réglementation est efficace puisqu'elle permet de maîtriser cette maladie, avec un très faible nombre de cas humains dûs à M. bovis. »
Mise en garde
Le statut indemne de la France est menacé, même si depuis 2022 le nombre de foyers de tuberculose bovine en France ne dépasse pas 100 foyers par an. Dans l'Union européenne, un pays est indemne quand les élevages infectés représentent moins de 0,1% des élevages bovins du pays. En France, le ratio est de 0,06 à 0,07% depuis 8 ans. Plus le nombre d'élevages baisse, plus il est dur de rester sous le seuil de 0,1%.
Les éleveurs demandent moins d'abattages totaux et de meilleures indemnisations
Abattage sélectif, meilleures indemnisations ... Les attentes exprimées par les éleveurs présents au colloque du 9 septembre étaient nombreuses.

Les éleveurs qui subissent un abattage total suite à la détection d'un cas de tuberculose bovine dans leur troupeau attendent des évolutions dans la gestion de cette maladie. S'ils entendent que leur sacrifice sert une cause collective, ils demandent à être davantage écoutés et soutenus. « Il faut davantage envisager l'abattage partiel », ont également plaidé plusieurs éleveurs de vaches laitières et allaitantes présents lors du colloque.
L'abattage sélectif - qui est une dérogation à l'abattage total - présente des intérêts : pour le moral des éleveurs, pour conserver une génétique, face au manque de disponibilité en animaux pour repeupler les élevages. Mais les intervenants soulignent qu'en l'état actuel des outils de surveillance et de lutte, l'abattage sélectif peut difficilement se développer davantage sans faire prendre un risque aux cheptels, aux éleveurs, à la population humaine et aux filières.
Améliorer l'indemnisation
« Pour être en mesure de mettre en place un protocole d'abattage sélectif, il faut : pouvoir discrimer des lots d'animaux sur le plan sanitaire ; que l'élevage mette en oeuvre des mesures de biosécurité (double clôture, protection de l'alimentation ...) et disposer de matériel de contention pour réaliser les tests de contrôle régulièrement », rappelle la DDPP.
En outre, la DGAL rappelle que l'abattage sélectif peut « avoir de lourdes conséquences si à chaque contrôle un animal ressort positif. Parfois, l'abattage sélectif ne fait que repousser l'échéance d'un abattage total. » A chaque test positif, un APMS (Arrêté préfectoral de mise sous surveillance) est appliqué à l'élevage pour mener des tests complémentaires. En production laitière, durant cette période de suspiscion, le lait ne doit pas être consommé cru. Le lait est pasteurisé ou stérilisé avant transformation, ou détruit.
Les éleveurs ont aussi demandé que l'indemnisation soit revalorisée au regard de la hausse des prix des animaux et de la viande. Et qu'enfin, la fiscalité soit adaptée. C'est une vieille demande : défiscaliser les montants perçus par les éleveurs victimes d'abattages.