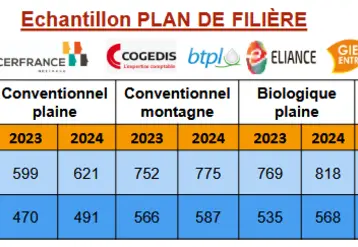De nouvelles pistes pour lutter contre les strongles digestifs
Comment choisir les troupeaux et les vaches pour lesquels un traitement strongylicides pourrait améliorer la production laitière ? Réponses grâce à une étude récente de l’Inra-Oniris.
Comment choisir les troupeaux et les vaches pour lesquels un traitement strongylicides pourrait améliorer la production laitière ? Réponses grâce à une étude récente de l’Inra-Oniris.


Un traitement raisonné est d’autant plus complexe à mettre en place pour les vaches que ces dernières expriment rarement des symptômes contrairement aux génisses. En revanche, l’infestation peut avoir un impact sur leur production laitière. « Le gain de production après un traitement n’est pas systématique. Traiter tous les troupeaux et toutes les vaches n’est pas une bonne solution surtout si l’on veut éviter l’émergence de résistance chez les parasites », rappelle Nadine Ravinet d’Inra-Oniris.
Le défi est donc d’identifier des indicateurs permettant de détecter les troupeaux à risque et les vaches ayant une plus forte probabilité de gain de production post-traitement. Ce travail a été mené grâce à un essai avec traitement à la rentrée et évaluation du gain de production post-traitement en période de stabulation.
Dans cette étude portant sur plus de 6 200 vaches, il a tout d’abord été constaté que, tous troupeaux confondus, les vaches répondant le mieux au traitement antiparasitaire étaient celles qui avaient vêlé en cours de saison de pâturage et ayant le plus faible niveau de production dans leur troupeau (par rapport aux vaches de la même parité) : en moyenne + 1 kg de lait/VL/j contre +0,3 kg/VL/j pour l’ensemble des vaches traitées. « Mais pour augmenter la probabilité d’améliorer la production laitière d’une vache après traitement, il faut d’abord repérer les troupeaux à risques », explique Nadine Ravinet. Pour cela, les résultats de cette étude ont permis de retenir trois indicateurs simples : la part d’herbe pâturée dans la ration, le Temps de Contact Effectif avec les strongles au pâturage avant le premier vêlage (TCE) puis dans une moindre mesure le dosage des anticorps anti-Ostertagia dans le lait de tank (DO).
L’importance de la part de l’herbe pâturée
« Le niveau d’herbe pâturée dans la ration s’est avéré être le meilleur indicateur pour effectuer un premier tri de troupeaux. La réponse en lait était en moyenne supérieure dans les troupeaux à niveau d’herbe pâturée élevé ou moyen, et nulle quand il était bas. » Ce niveau était considéré comme élevé lorsque l’herbe pâturée représentait au moins 75 % de la ration des vaches au printemps pendant au moins deux mois et au moins 50 % en été-automne pendant au moins deux mois. Il était moyen lorsqu’un seul des deux critères était respecté et bas si aucun ne l’était.
L’étape suivante a consisté à repérer, dans ces troupeaux à niveau d’herbe pâturée moyen ou élevé, les vaches qui répondaient le mieux à un traitement. Une nouvelle fois, ce sont celles qui avaient vêlé durant la saison de pâturage et ayant le plus faible niveau de production dans le troupeau. Mais, grâce au tri préalable des troupeaux, le gain de production pour cette catégorie de vaches a augmenté. « Il est passé de +1 kg/VL/j à +1,3 kg/VL/j. Le tri de troupeau permet donc bien d’optimiser les chances de gain de production », souligne Nadine Ravinet.
Un plus avec le temps de contact effectif simplifié
Puis, parmi ces deux catégories de troupeaux, la prise en compte du temps de contact effectif (lire dossier Parasitisme - Réussir lait n° 323) a permis d’affiner le tri. Pour simplifier le protocole dans les élevages, la chercheuse a utilisé un TCE simplifié(1). « Lorsque le TCE était faible (moins de 8 mois), le gain de production était en moyenne de +1,5 kg/VL/j, la catégorie de vaches répondant le mieux restant la même. »
En dernière intention, après avoir trié les troupeaux sur la base du niveau d’herbe pâturée et du TCE, la DO (supérieure à 0,8-0,9) pourrait constituer le dernier critère pour affiner le tri. Mais pour Nadine Ravinet, ce critère doit être utilisé avec prudence. « À ce dernier niveau de tri se basant sur la DO, les résultats sont un peu moins fiables car obtenus sur un petit nombre de troupeaux. Plus on affine le tri, moins on a de troupeaux. Si on retient 42 % des troupeaux en tenant compte uniquement du niveau d’herbe pâturée dans la ration, ce pourcentage passe à 14 % en ajoutant le TCE et seulement à 6 % avec la DO en plus. »
Autre précision importante : « L’ordre d’utilisation des critères influence la qualité du tri. Si vous prenez la DO ou le TCE plutôt que la part de l’herbe pâturée dans la ration comme premier critère, le tri est moins bon. »
(1) Le TCE a été simplifié. Il a pris en compte la durée de pâturage à laquelle a été soustraite seulement la durée de rémanence du produit de traitement. Les données de complémentation des génisses au pâturage et de sécheresse étaient en effet peu fiables.La moitié des vaches traitées à la rentrée à l’étable
Plus de 6 200 vaches issues de 123 troupeaux du Grand Ouest, du Nord-Est, de l’Est et d’Auvergne ont servi de support à l’étude. « La répartition géographique a permis de tenir compte des différentes pratiques d’utilisation de l’herbe », précise Nadine Ravinet. La moitié des vaches ont été traitées à la rentrée à l’étable avec de l’Eprinomectine injectable produite par Ceva Santé Animal, partenaire de l’étude. « Le temps d’attente de cette molécule est nul pour le lait et la formulation injectable permet, contrairement au pour-on, de faire un traitement sélectif », souligne la scientifique pour expliquer le choix du traitement.
Les vaches les moins résilientes
Théoriquement, les vaches à traiter seraient les vaches moins résistantes (capacité de l’animal à contrôler la population de parasites qu’elles hébergent) et/ou moins résilientes (capacité des vaches à maintenir leur état de santé et de production en dépit de l’infestation). Les vaches répondant le mieux au traitement avaient vêlé en cours de saison de pâturage et étaient faibles productrices dans leur troupeau par rapport aux vaches de la même parité. Il s’agissait donc de vaches moins performantes que les autres au pâturage lorsqu’elles débutent leur lactation en contact avec les parasites, donc probablement les vaches les moins résilientes.