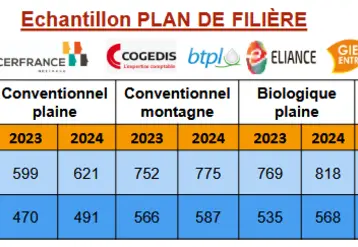Additifs anti-méthane : entre promesses et réalité scientifique pour l'élevage laitier
Les additifs alimentaires pour réduire les émissions de méthane entérique des vaches laitières suscitent un intérêt croissant. Entre solutions déjà éprouvées, pistes prometteuses et espoirs encore à confirmer, où en est réellement la science ?
Les additifs alimentaires pour réduire les émissions de méthane entérique des vaches laitières suscitent un intérêt croissant. Entre solutions déjà éprouvées, pistes prometteuses et espoirs encore à confirmer, où en est réellement la science ?

« Il y a un vrai essor des nouveaux compléments alimentaires pour réduire les émissions de méthane entérique des vaches laitières », plante Raphaël Boré, chargé de projet en alimentation et référent émission de méthane entérique à l’Idele, lors de la journée Grand Angle Lait du 3 avril 2025.
L’enjeu est de taille : « Le méthane représente 45 % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture en France », estime l’Inrae dans son dossier Quels défis pour des élevages durables ? d’août 2024. Face à cette réalité, la recherche s’intensifie et les fabricants d’aliments multiplient les initiatives pour proposer des solutions. Le Bovaer, le premier produit autorisé en 2022, a ouvert la voie à une nouvelle génération d’additifs à incorporer dans les rations des animaux.
Pour clarifier les niveaux d’efficacité et le degré de validation scientifique de ces produits, Raphaël Boré propose une classification en trois catégories : les additifs efficaces et bien documentés à l’auge (le 3-NOP et les nitrates de calcium) ; ceux à l’efficacité prometteuse mais encore en cours d’évaluation (les algues Asparagopsis) ; et enfin, les compléments à l’efficacité plus variable et à la documentation encore limitée (tanins, huiles essentielles, saponines, microalgues, biochar…).
| Des compléments alimentaires pour réduire les émissions de méthane entérique éprouvés, d’autres à expertiser | ||||
| Les compléments efficaces et bien documentés à l’auge | Efficacité prometteuse mais peu d'études | Les compléments à efficacité variable et peu documentés | ||
| 3-NOP | Nitrates de calcium | Algues Asparagopsis | Extraits de plantes : tannins, huiles essentielles, saponines, microalgues, Biochar | |
| Potentiel de réduction des émissions de CH4 entérique par jour | -15 % à -40% | -15 % à -25% | Jusqu'à 60% | 0% à 5% Réponses très variables |
| Effet sur la production laitière et l'ingestion des vaches | Pas d'impact avéré | Pas d'impact avéré | Diminution de l'ingestion et de la production laitière | Non connu |
| Mode d'action | Inhibition d’une enzyme produite par les archées méthanogènes et responsable de la synthèse de méthane | Captage de l’H2 (dihydrogène) pour éviter son utilisation par les archées méthanogènes pour produire du méthane | • Réduction des fermentations ruminales en inhibant les micro-organismes • Inhibition d’une enzyme produite par les archées méthanogènes et responsable de la synthèse de méthane | A préciser |
| Mode de distribution aux vaches | Mélangé dans la ration (600 à 900 mg/kg MS) directement dans la mélangeuse, incorporation au minéral ou à un aliment du commerce | Mélangé dans la ration (1,6 % de la MSI) directement dans la mélangeuse, incorporation au minéral ou à un aliment du commerce | Mélangé dans la ration (0,5% à 1% de la MSI) directement dans la mélangeuse (lyophilisé et broyé) | Mélangé à la ration (dose à préciser) ou bloc à lécher ? |
| Coût par vache et par jour pour une ration de 23kg/MS/jour | 0,28 € | 0,30 € | Non connu | Non connu |
| Source : à partir de l'Institut de l'élevage, Grand Angle Lait 2025 | ||||
Les additifs efficaces et bien évalués à l’auge
Deux additifs se distinguent par une réduction significative et régulière des émissions de méthane, sans effets défavorables observés sur les performances zootechniques des animaux.
Le 3-NOP (3-nitrooxypropanol) promet une réduction de 15 à 40 % des émissions de méthane. Il ne présente pas d’effets connus sur l'ingestion des vaches, ni sur la production laitière. Ses résultats sont étayés par la littérature scientifique, avec plus d’une vingtaine de publications recensées, explique le chargé de projet .
Avec là aussi un solide socle d’études scientifiques pour appuyer les résultats, les nitrates de calcium affichent un potentiel de réduction allant de 15 à 25 %.
Les algues rouges aux résultats prometteurs mais encore incertains
Parmi les pistes en cours d’étude, les algues rouges de type Asparagopsis suscitent un intérêt croissant, notamment du fait de leur origine naturelle, contrairement au 3-NOP ou aux nitrates de calcium qui sont des molécules de synthèse. Elles pourraient, selon certaines publications, réduire les émissions de méthane jusqu’à 60 %. Une promesse séduisante, mais qui reste à confirmer.
« Leurs effets sont moins bien documentés, tempère Raphaël Boré. Dans plusieurs essais in vivo, une baisse de l’ingestion et de la production laitière a été observée, liée à l’impact des algues sur les fermentations ruminales. »
L’efficacité à préciser des extraits de plantes
D’autres substances sont également à l’étude pour leur potentiel anti-méthane : tanins, huiles essentielles, saponines, microalgues ou encore biochar… Si certains résultats obtenus in vitro en laboratoire semblent encourageants, leur transposition en conditions réelles d’élevage reste incertaine.
« Ce sont surtout des essais en laboratoire, avec peu de recul encore, témoigne Raphaël Boré. Leurs mécanismes d’action ne sont pas toujours bien compris. Il n’y a pas d’explication sur les raisons pour lesquelles cela fonctionne. La baisse des émissions de méthane y est souvent plus causée par un effet cocktail que par une action spécifique. Il y a encore un vrai besoin d’expertise. »
Pâturage : un défi pour l’efficacité des additifs
« Il a peu d’études sur l’efficacité des compléments alimentaires pour réduire les émissions de méthane au pâturage », regrette Raphaël Boré, chargé de projet en alimentation à l’Idele. La distribution aux vaches y étant moins continue qu’en bâtiment, la baisse promise des émissions pourrait être amoindrie.
Pour le 3-NOP, des essais menés par le Teagasc en Irlande montrent une efficacité réduite lorsqu’il est administré uniquement lors des deux traites quotidiennes. Dans ce cas, son efficacité n’atteindrait que 6 %, contre les 15 à 40 % affiché lorsqu’il est intégré à la ration distribuée à l’auge. « Pour être efficace, le 3-NOP doit accompagner chaque prise alimentaire », précise l’expert.
Pour une action adaptée au pâturage, de nouveaux formats doivent être envisagés, comme des blocs à lécher enrichis en additifs, permettant une ingestion progressive et continue tout au long de la journée.