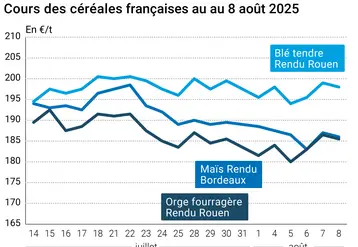OGM Les biotechnologies gagnent du terrain
Le séminaire Eurofins, qui s’est déroulé récemment à Paris, a réuni des scientifiques du monde entier pour un bilan sur les biotechnologies, leurs utilisations et leur avenir

À l’occasion du séminaire international annuel Eurofins (groupe français de biotechnologie), l’Isaaa (International service for the acquisition of agri-biotech applications) représenté par son président James Clive, a tenu à étayer son positionnement par le biais de récentes conclusions émanant de travaux scientifiques. Cette quinzième session des 22 et 23 février dernier semblait tomber à point pour cette organisation, qui a souhaité dresser une vue d’ensemble des cultures transgéniques dans le monde, dix ans après les premières commercialisations. « L’humanité va consommer deux fois plus de denrées alimentaires dans les prochaines années que ce que l’homme n’a consommé depuis le début la naissance de l’agriculture », a affirmé James Clive, dont les idées et la vision du monde sont loin d’être ambiguës. Pour cet homme, si au début des années 90 les essais puis la commercialisation d’OGM provoquaient de fortes réticences, — et notamment du scepticisme à ce que les pays en voie de développement en Asie, Amérique Latine ou Afrique puissent accéder à ce type de cultures —, la période 1996-2005 a montré une adoption rapide et sans précédent de ces cultures, dans les PVD comme dans les pays industrialisés.
Pour une agriculture plus durable ?
Depuis 1996, ce sont ainsi quelque 577 Mha de cultures génétiquement modifiées qui ont été cultivées à travers le monde. Elles sont présentes dans 22 pays à l’heure actuelle. L’année 2006 a vu une augmentation de 13 % des cultures, soit +100 Mha. Les OGM sont semble-t-il déjà bien cultivés dans plusieurs PVD. L’Afrique du Sud a triplé ses surfaces de maïs OGM. Au total, deux tiers des OGM, soit 300 Mha, sont implantés dans les PVD. D’après les chiffres avancés par James Clive, l’impact écologique des OGM est manifeste (à noter que ces informations proviennent du « secteur public », comme il le dit lui-même, « au cas où des détracteurs souhaitent contester les données issues de sociétés privées…») : les cultures OGM auraient ainsi permis de « sauver » 125.000 t de pesticides et d’herbicides ; pour l’année 2005, de réduire de 4 millions le nombre de véhicules sur les routes (les OGM nécessitant entre autres moins d’intrants), contribuant par là-même à la réduction des émissions des gaz à effet de serre ; d’économiser les ressources en eau, grâce aux plantes tolérantes à la sécheresse. À ce sujet, le président de l’Isaaa estime que « les gènes les plus primordiaux dans les prochaines décennies seront ceux permettant de vaincre la sécheresse ».
Sur le plan de l’alimentation, « les récoltes d’OGM ont permis de sauver des millions de vies en Inde », note James Clive. Et d’assurer par ailleurs que « les biotechnologies réduisent la pauvreté dans le monde ». Les profits des producteurs d’OGM seraient de 27 milliards de dollars (dont 13 Md$ pour les PVD), sur la période 1996-2005. Cela étant, ces chiffres ne permettent pas de rendre compte des disparités, surtout au niveau de l’accession aux OGM par les PVD.
Le rôle potentiel des OGM à l’avenir, avec la question de l’énergie
Au Brésil, « géant silencieux à bien des égards, » le président Luis Inacio Lula da Silva aurait décidé d’allouer 500 M$/an pour les biotechnologies ; ladite somme serait entre autres octroyée pour les « 100 Mha pouvant encore être consacrés aux biocarburants ». Nous y voilà. Si l’un des grands défis concerne bel et bien l’alimentaire (carences, famines), l’enjeu énergétique n’en paraît pas moins colossal. Et là encore, face aux raréfactions des ressources pétrolières et aux tensions internationales qui en découlent, les États-Unis comptent bien continuer à miser gros sur les moyens pour développer les biocarburants. M. Clive est catégorique : blé, canne à sucre, colza ou autres betteraves transgéniques « permettront d’accroître la production en termes de volume ». En s’attendant à une demande continuellement croissante, le président envisage à l’avenir « un doublement des pays qui utiliseront les biotechnologies en 2015 » pour répondre aux impératifs de production et de croissance. Nous l’aurons compris, ou comme le résume si implacablement le président de l’Isaaa, « le plus gros risque concernant les OGM serait le risque de ne pas en produire !»
Toutefois, les conclusions de James Clive sont nuancées sur un point : les cultures transgéniques ne doivent pas remplacer les cultures conventionnelles. Au contraire, « il faut veiller à ce que tous les pays puissent faire un choix et permettre la coexistence, et surtout l’équilibre des cultures OGM et non-OGM ». Thèse reprise à l’unisson par Simon Barber, président de l’Association européenne des entreprises de biotechnologies (EuropaBio).
Coexistence… Pour Simon Barber, la problématique est bien plus d’ordre économique que technique. Car la coexistence doit se faire non seulement sur le terrain, mais également en aval des filières (centres de collecte, entreprises de transformation, distribution). Ainsi, « les modalités permettant une coexistence sans risques doivent être efficaces, mesurées et validées ».
À l’heure actuelle, les validations sont permises par des règles de coexistence, des modalités de gestion ainsi que la mise en œuvre de la traçabilité et de l’étiquetage, en accord avec la réglementation. Depuis la fin 2006, cinq normes ISO (International standard organisation) ont été publiées à ce sujet. Elles concernent la détection des organismes génétiquement modifiés et les produits dérivés. L’accréditation des laboratoires est basée sur l’application de la norme ISO 17025 relative à la détection des OGM.
Les cinq nouvelles normes ISO seront également utilisées comme base pour l’accréditation.