À la recherche des histoires singulières des derniers déportés
Convoi 77, c'est le nom du dernier grand convoi de déportés parti de Drancy vers Auschwitz-Birkenau le 31 juillet 1944. Une association œuvre à retracer l'histoire de ces 1 306 victimes de la barbarie nazie, en impliquant collégiens et lycéens.
Convoi 77, c'est le nom du dernier grand convoi de déportés parti de Drancy vers Auschwitz-Birkenau le 31 juillet 1944. Une association œuvre à retracer l'histoire de ces 1 306 victimes de la barbarie nazie, en impliquant collégiens et lycéens.

Le convoi 77, parti de Drancy, sera le dernier à acheminer hommes, femmes et enfants vers le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau
Victimes d'une rafle, dénoncés par un voisin, trahis par un ami, pris au beau milieu d'une opération de résistance, ou simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme des milliers d'hommes et de femmes avant eux, ignorant pour la plupart leur destination, le 31 juillet 1944, 1 306 personnes, dont 324 enfants, des juifs en majorité, ont été contraints de monter à bord des wagons plombés.
Dirigée par Georges Mayer, l'association Convoi 77 ambitionne de retracer à l'échelle européenne la biographie de ces 1 306 derniers déportés. En effet, pour l'immense majorité d'entre eux, le point de départ se résume au nom, prénom, date de naissance, date et lieu de l'arrestation ou de la dernière adresse connue. Un bien maigre bagage pour retracer la complexité d'une vie.
Ainsi, l'association Convoi 77 propose à des élèves (des collégiens de troisième et des lycéens essentiellement) accompagnés par leurs enseignants, d'enquêter sur les déportés qui sont nés ou ont vécu dans leur ville ou village.
Si l'objectif est bel et bien de combler les blancs de ces histoires personnelles, en traitant et en croisant les sources d’abord, puis en rédigeant une biographie finale, le travail rend la transmission et le devoir de mémoire très concret.
L’association donne aux enseignants les toutes premières archives : dossiers du SHD de Caen, archives de Bad Arolsen, documents émanant de la Préfecture de police. Les enseignants se lancent ensuite dans la recherche d’archives complémentaires.
526 biographies de déportés ont déjà été publiées
Sur les 1 306 déportés du dernier convoi, les historiens Sandrine Labeau et Alexandre Doulut ont retrouvé 1 119 dossiers de régularisation d’état-civil ou de demande de reconnaissance du statut de déporté au SHD-DAVCC (Service Historique de la Défense – Direction des Archives des Victimes des Conflits Contemporains).
Ils ont numérisé 30 000 documents qui sont mis à la disposition des participants du projet. Ces dossiers contiennent souvent au moins un acte de naissance et un certificat de décès. Mais aussi parfois des certificats de mariage ou des photographies. Ils sont alimentés à la fois par les informations données par les familles qui ont besoin de documents et par les propres recherches documentaires des agents du Ministère des Anciens combattants.
« Tous ces dossiers permettent d’accéder aux lieux de naissance, à certaines adresses et à des liens de parenté. Cela permet de recomposer une partie de l’histoire personnelle des déportés », indique Sandrine Labeau. Les informations sont parfois maigres, mais chaque déporté a au moins une fiche. Une première étape dans la reconstitution de la trajectoire de vie de chacun.
« Le travail des élèves permet d'humaniser celles et ceux qui ont été réduits à un simple matricule. En recherchant leur histoire singulière, les élèves deviennent acteurs de la transmission de l'histoire de la Shoa », explique Georges Mayer.
Lire aussi Un musée national dédié aux rapatriés d'Indochine va bientôt ouvrir à Noyant-d'Allier
À ce jour, 526 biographies ont été publiées, 358 sont en cours d'étude, et vingt pays sont associés au projet. Sur le site de l’association, on peut évidemment accéder à chaque biographie mais aussi à la liste actualisée des déportés ne disposant pas encore de biographie.
« Pour des raisons de simplicité, mais aussi pour encourager l’ancrage local du projet, nous préconisons aux enseignants de choisir un déporté qui a vécu ou a été arrêté dans la commune ou la région de la classe. Mais cela n’a rien de contraignant, bien entendu », précise le président de l'association.
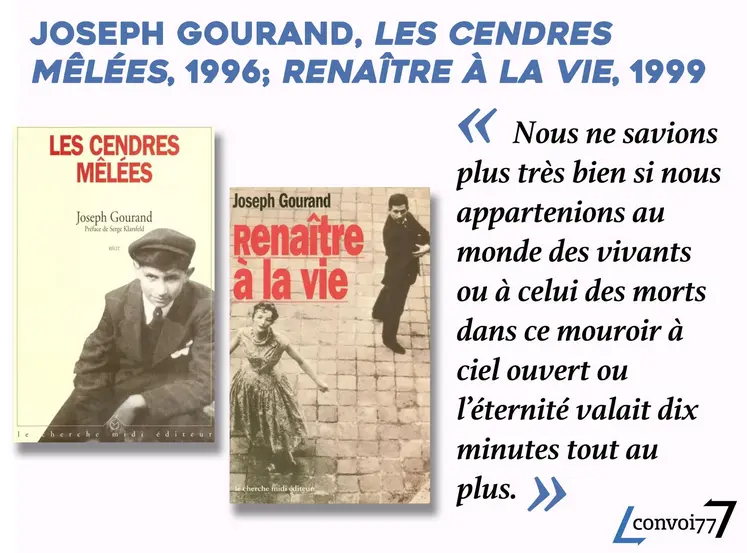
250 rescapés du Convoi 77 parmi lesquels Yvette Lévy
En cette fin juillet 1944, la situation est particulièrement instable.
Les Alliés, qui ont débarqué depuis le 6 juin, progressent vers la capitale. Le 20 juillet, un attentat contre Hitler et une tentative de putsch ont échoué ; les responsables de la Gestapo, arrêtés par les militaires de la Wehrmacht, sont relâchés.
Aloïs Brunner, commandant du camp de Drancy, profite de la confusion pour poursuivre jusqu’au bout sa folie meurtrière. Il envoie ses commandos dans les maisons de l’UGIF de la région parisienne, qui hébergent les enfants juifs fichés par les nazis, et « rafle » des centaines d’enfants, dont 18 nourrissons. Le 31 juillet 1944, le convoi 77, dernier grand convoi de déportés de Drancy, emporte vers le camp d’extermination d’Auschwitz 986 hommes et femmes, et 324 enfants. Sur les 1 306 déportés, 836 sont, dès leur arrivée à Auschwitz le 5 août, dirigés vers les chambres à gaz.
Seulement 250 déportés (157 femmes et 93 hommes) auront survécu aux travaux forcés, aux sévices, aux expériences pseudo-médicales et aux privations à la fin de la guerre, en mai 1945. Yvette Lévy a 17 ans quand elle est embarquée dans le convoi 77. C'est l'une des rares survivantes.
Résistante engagée, plusieurs fois décorée, Yvette Lévy a consacré sa vie à témoigner de l’horreur et à transmettre la mémoire de la Shoah

À 98 ans, elle se souvient avec précision de son arrivée à Auschwitz : « On était à peu près 80 dans le wagon, avec un seau pour les besoins et un autre pour de l’eau. Le voyage a duré trois jours. On est arrivé en pleine nuit à la gare de Birkenau. Les SS nous ont fait descendre et nous ont séparés : les jeunes à droite, les autres à gauche. 150 à 180 femmes ont été sélectionnées, les 896 autres sont parties directement à la chambre à gaz. On nous a fait rentrer dans une baraque et on nous a demandé de nous déshabiller. Nous, on ne voulait pas.
Les SS criaient « Schneller ! » (en français : « Plus vite ! »), et on s’est retrouvé « à poil » devant les autres qui ont été sélectionnées. Je ne m’étais jamais déshabillée devant mes camarades, ça a été la honte. Puis, on a été tondues. Ça, c’était le moment le plus difficile. Tu as beau pleurer, une fois que tes cheveux sont par terre, ils ne remontent pas. Après, on nous a lancé une chemise, une culotte, une robe et des sabots. Les petites avaient des robes jusqu'aux pieds, les grandes en avaient des mini, on a essayé de les échanger. On n’avait plus de cheveux, plus rien. C’était l’enfer ». L'enfer sur terre.
Pour aller plus loin « L'éclaireuse de Birkenau : Si je parle, c'est pour la mémoire des enfants assassinés », Yvette Lévy Dreyfuss avec Philippe Trétiack, édition Taillandier, sept. 2022.











